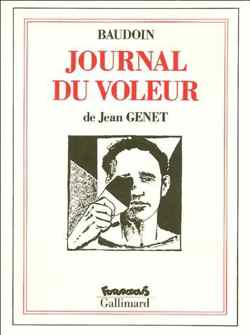"S’il se vante, je l’abaisse; s’il s’abaisse, je le vante; et le contredis toujours, jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il est un monstre incompréhensible."
Pascal, Pensées
"Dieu: mon tribunal intime.
La sainteté: l’union avec Dieu.
Elle sera quand va cesser ce tribunal, c’est-à-dire que le juge et le jugé seront confondus."
Genet, Journal du voleur
Depuis le lieu paradoxal qu’est le Journal du voleur de Jean Genet, il est possible de penser l’étrange alliance entre ce que Jacques Derrida appelle dans Donner la mort "l’irresponsabilité orgiaque" - en reprenant le mot de Patocka - et l’extrême responsabilité, exigée là même où elle fait défaut, où il aurait fallu l’inventer, de l’individu face au secret qui le constitue en tant que promis à la mort, à sa mort. On pourrait dire de l’irresponsabilité orgiaque qu’elle relève d’une "expérience du sacré ou de l’enthousiame fusionnel", qu’elle met en scène "cela même qui brouille la limite entre l’animal, l’humain, le divin et ne va pas sans affinité avec le mystère, l’initiatique, l’ésotérique, le secret ou le sacré", à la différence de la responsabilité du moment proprement religieux de la culture, le moment chrétien. Ce moment serait celui de la responsabilité d’un moi libre, librement assujetti "au tout autre infini qui le voit sans être vu." La religion chrétienne aurait constitué cet autre mystère, ce mysterium tremendum, qui garde le secret de sa propre historicité comme héritage du platonisme. Le secret d’un secret: qu’en elle le platonisme se trouve refoulé. Et aussi l’orgiasme, qui reste incorporé dans le platonisme. Dans ce contexte, il ne s’agit pas seulement de faire une histoire de la religion, mais aussi de faire une "généalogie du sujet disant ’moi’, de son rapport à lui-même comme instance de la liberté, de la singularité, et de la responsabilité, du rapport à soi comme être devant l’autre". Patocka montre ainsi qu’il est un impensé du christianisme, concernant la personne, lieu et sujet de toute responsabilité.
Or Genet touche à cette personne dans le Journal du voleur, car il désire être ce lieu du paradoxe où il faut se regarder comme soi-même et comme un autre. Les deux choses à la fois: indifférenciation, fusion et singularité, responsabilité d’un sujet libre qui se découpe du monde par le contour de sa propre mort, sa propriété. Genet y écrit ces lignes troublantes sur son rapport à la matière, au vivant en général, à ce tout autre qui peut prendre l’aspect indécidable d’un sourire d’alligator:
"De la planète Uranus, paraît-il, l’atmosphère serait si lourde que les fougères sont rampantes; les bêtes se traînent écrasées par le poids des gaz. A ces humiliés toujours sur le ventre, je me veux mêlé. Si la métempsycose m’accorde une nouvelle demeure, je choisis cette planète maudite, je l’habite avec les bagnards de ma race. Parmi d’effroyables reptiles, je poursuis une mort éternelle, misérable, dans les ténèbres où les feuilles seront noires, l’eau des marécages épaisse et froide. Le sommeil me sera refusé. Au contraire, toujours plus lucide, je reconnais l’immonde fraternité des alligators souriants."
Je souligne quelques mots: mêlé, ma race, immonde fraternité. Ces mots trahissent un désir extravagant, cosmique, i(m)-monde, d’être loin de ce qu’on appelle l’humain, le désir d’un devenir autre, voire de devenir un autre, sans se confondre avec ce envers quoi on ressent une fraternité désirante. Ces mots accomplissent et détruisent à la fois la construction chrétienne de la personne, en la reportant au moment orgiaque où elle trouve son horizon d’altérité, à partir duquel seulement il est possible d’établir sa propriété.
Soi-même comme un autre, tel serait le projet radical de Genet, ce qui s’y jette, la gêne qu’il peut provoquer, y compris pour la littérature établie. C’est aussi par cet aspect qu’on a pu parler de sainteté à propos de Genet, quand on sait que les saints avant d’être canonisés (et c’est un bon mot pour la littérature) sont surtout gênants, difficiles à classer, toujours suspects d’hérésie par rapport à la parole officielle, à la limite de l’inconscience ou de l’irresponsabilité, leurs extases indécidables pouvant faire figure d’enthousiame fusionnel de type orgiaque. On n’est pas loin ici de la Tentation de saint Antoine, par exemple, du "démon" de la fusion dans la matière. Et on y retrouve peut-être aussi la source de cette aventure autobiographique du Journal du voleur, l’oscillation qu’elle va chanter: "Mon trouble semble naître de ce qu’en moi j’assume à la fois le rôle de victime et de criminel." Tout se passe comme si la personne était le lieu même du sacrifice, ou plutôt sa scène, comprise comme l’ensemble affolant de la victime, du sacrificateur et du lieu de l’action nommée "sacrifice". Ou "crime", on ne saurait ici se rassurer. Car ce serait évidemment un crime qu’un sacrifice offert à un dieu qui risque, s’il n’existe pas, de faire du sacrifice un crime injustifiable.
Dans La littérature au secret, texte qui se rattache à la problématique de Donner la mort, le secret du sacrifice d’Isaac, imposé par Dieu à Abraham, ce secret exigé par le rapport au tout autre infini, infinie hésitation entre sacrifice et trahison, entre devoir absolu et crime absolu, folie absolue, va fournir à Derrida l’occasion d’inventer une fable, la fable de l’origine abrahamique de la littérature comme histoire du secret et du pardon impossible. Selon cette fable :
"(…) la littérature hérite, certes, d’une histoire sainte dont le moment abrahamique reste le secret essentiel (et qui niera que la littérature reste un reste de religion, un lien et un relais de sacro-sainteté dans une société sans Dieu?), mais elle renie aussi cette histoire, cette appartenance, cet héritage. Elle renie cette filiation. Elle la trahit au double sens du mot: elle lui est infidèle, elle rompt avec elle au moment même d’en manifester la "vérité" et d’en dévoiler le secret."
La littérature serait donc une affaire de secret. Non pas d’un secret d’ordre épistémique, mais d’une sorte d’impératif du secret, ou plutôt d’un performatif du secret, où l’essentiel n’est pas que quelque chose soit cachée, tue ou non sue, mais qu’il y ait du secret. Et que ce secret puisse à tout instant être trahi, tout en étant lui-même une trahison par rapport à la généralité. La littérature, comme la religion, impliquerait un devoir de responsabilité envers la réponse donnée à l’appel du tout autre, un devoir de rapport à une certaine folie, proprement fictionnelle, fabuleuse. Le mystère de la religion serait ainsi une affaire fabuleuse, à la fois parce qu’il constitue une aventure extraordinaire, troublante, mais aussi parce qu’il est traversé par une fable.
Qu’est-ce que tout cela peut bien vouloir dire ici, pourrait-on se demander alors, par rapport à Genet? Reprenons d’abord l’analyse sartrienne. Comme on sait, Sartre inscrit Genet dans une entreprise existentielle ainsi formulée: "on m’a accusé, je suis donc coupable, j’accepte la faute, je surenchéris, je chanterai le crime, je me ferais le poète du crime". Et à la longue, selon Sartre, il en arrive par sa performance radicale à démystifier les valeurs mêmes de cette société qui l’a accusé, tout en désirant d’être vu et reconnu par elle.
À ce point précis je ferai intervenir une notion née de ma lecture de Donner la mort. Car si Derrida y parle d’irresponsabilité orgiaque et de responsabilité religieuse, comme des notions imbriquées, ne pourrait-on pas essayer de mettre ensemble ces deux notions pour mieux comprendre le "cas" Genet, cette chute? Le mot cas doit s’entendre ici non pas dans un contexte clinique (bien qu’un certain traitement de la question du désir permette de rapprocher l’univers de Genet du discours psychanalytique) mais surtout dans un contexte juridique (qui semble être prioritaire chez Sartre). Le cas Genet donc. Mais là, qu’il me soit permis d’introduire encore deux dimensions du mot, qui existent en portugais, ma langue, cette langue qui ne m’appartient pas, évidemment... Cas désigne le récit, un histoire qu’on raconte. Cas c’est aussi le trouble, comme quand on dit semeur de trouble, "créateur de cas". J’ignore si la langue française pourrait accepter ou accueillir ces deux acceptions. Mais elles sont éclairantes par rapport à Genet. Comment donc le juger? Puisque le cas est ici une affaire. C’est ce que semble se demander Sartre tout au long de son long ouvrage. Genet est accusé, on doit le défendre. À l’origine, il n’est pas responsable de son crime. Il en devient responsable, mais de l’avoir accepté, aimé, bandé pour lui, chanté. En agissant ainsi, il finit par maîtriser son destin, en le choisissant, en le voulant. C’est pourquoi il est fort et faible à la fois. La responsabilité chez Genet serait donc évidemment de type existentiel.
Pour Genet, pour son cas, qui nous livre à la fois le désir, le juridique, le récit, le trouble, ne serait-on pas en droit, en jouant sur et du texte de Derrida, en le faisant jouer sans trop détourner les règles du jeu, espérons-le, ne serait-on pas en droit de parler d’une paradoxale responsabilité orgiaque? Une responsabilité tout autre que celle pensée par Sartre, justement. Une responsabilité liée au désir, à un certain désir. Cette responsabilité orgiaque consisterait ici d’abord et surtout à assumer son chant. C’est-à-dire à assumer le paradoxe de la propriété et de l’impropriété de ce chant, à "prendre" la source de ce chant comme quelque chose de très propre et de très étranger à "soi", en assumant en même temps l’autonomie de ce chant par rapport aux choses chantées. Arrêtons-nous un moment sur la nature de ce chant: il est une célébration de la divinité du monde, ou de la mondanité du dieu; il se résorbe dans une auto-célébration, une auto-affection qui apparaît comme le plus puissant des affects:
"Envisageant le monde hors de moi, son indéfini, sa confusion plus parfaite encore la nuit, je l’érigeais en divinité dont j’étais non seulement le prétexte chéri, objet de tant de soin et de précaution, choisi et conduit supérieurement encore qu’au travers d’épreuves douloureuses, épuisantes, au bord du désespoir, mais l’unique but de tant d’ouvrages. Et peu à peu, par une sorte d’opération que je ne puis que mal décrire, sans modifier les dimensions de mon corps mais parce qu’il était plus facile peut-être de contenir une aussi précieuse raison à tant de gloire, c’est en moi que j’établis cette divinité - origine et disposition de moi-même. Je l’avalai. Je lui dédiai des chants que j’inventais. La nuit je sifflais. La mélodie était religieuse. Elle était lente. Le rythme en était un peu lourd. Par lui je croyais me mettre en communication avec Dieu: c’est ce qui se produisait, Dieu n’étant que l’espoir et la ferveur contenus dans mon chant."
S’il s’auto-déifie en avalant Dieu, et que du fond de sa gorge monte un sifflement ou un chant, c’est le monde qu’il crée avec son chant, en l’exposant à une mort irréparable. De même pour le démiurge du Timée, pour son rapport au monde qu’il a fait, à propos duquel Serge Margel écrit: "Le monde, dans l’universalité de son tout, aurait été mimétiquement produit comme un objet votif, comme un objet voué à l’offrande, au don et au sacrifice. C’est ce que nous appelerons le tombeau du dieu artisan." Cette lecture de Platon communique étrangement, obliquement, avec la galaxie de Genet, avec la "galactologie" élaborée dans la lecture derridienne (la voûte étoilée, la voix lactée, le lait, le sperme). Comme le dieu, comme la mère, Genet poète et mime donne à la mort la gloire qu’il fabrique, qu’il érige: "Lait de deuil. Sa tombe, il n’aime que ça."
Son chant est donc tragique, eschatologique, scatologique, lié aux métamorphoses, aux passages entre vie et mort, plaisir et souffrance, aux affects primordiaux, au corps, à ses liquides. Chant des profondeurs. Et des surfaces aussi. Glas. (Je m’arrête ici un moment pour déplorer à mon tour l’insuffisance de mon texte par rapport à "l’imprenable", celui du texte de Genet mais aussi désormais celui de Glas, cette mer-veille de poésie, d’élaboration poétique de la lecture. Double insuffisance, qui bande ma lecture, qui l’est, la nourrit. Ce qui s’y déploie, c’est "mon" désir, le désir sans doute de me lire dans ces textes, de me mirer dans la glace du voleur qui, comme Baudelaire, n’est pas un mauvais vitrier. Quitte à être prise à la glu de ce Glas. Se mesurer à ce glas-là, c’est se méduser. Mais je continue.)
Et si cette nouvelle responsabilité, qui s’allie à un secret, à sa sécrétion même, revenait aussi à affirmer l’antériorité du chant par rapport à l’acte, au crime? Le secret (épistémique) de Genet selon Sartre, c’est qu’à force de décrire et de magnifier les choses, il finit par les détruire. L’écriture de Genet irréalise la chose, le monde, c’est ce que démontre l’analyse sartrienne. Mais ne pourrait-on pas retourner, revirer, regarder autrement la thèse sartrienne? Ne pourrait-on pas penser que le chant précède le crime? Qu’il le précède en ce sens que le crime ou l’acte se font comme en réponse à l’appel de ce chant, pour le faire arriver, justement? Que le chant soit cet appel, ce désir, origine d’avant l’origine, depuis laquelle on peut seulement s’inventer une origine? Et une responsabilité? Questions sans doute impertinentes. Mais qu’on doit pouvoir se poser. Pour essayer de penser "l’étrange antériorité", l’antériorité absolue de ce chant. Comment sinon comprendre un morceau comme celui où Genet chante le crachat de Stilitano, blanc et épais, qu’il fait danser devant sa bouche, "une si belle matière (…) toile d’araignée précieuse, tissu qu’en secret je nommai le voile du palais."
Nous nous trouvons là en présence d’un secret. D’un secret de la nomination, d’un secret du désir. D’une mise en scène du secret, si l’on veut, puisque ce secret est avoué, confessé au lecteur. Dans ce passage, il serait difficile de préciser ce qui comparaît d’abord, mais j’affirmerais que le tissu, la matière, la toile, ces sécrétions, ne sont précieux que parce qu’ils peuvent être nommés en secret du très-doux nom de voile du palais. Cela dit sans l’intention de trop insister ici sur la symbolique du voile, pour des raisons de temps et du fait aussi qu’elle a été trop bien analysée ailleurs, pour que je m’y mette à mon tour. Retenons simplement que le voile, c’est ce qui cache sans cacher, ce qui révèle en cachant et cache en révélant l’objet auquel il barre l’accès. Il le tient séparé. À distance. Il détourne la vision, il fabrique du sacré. En ce sens, il est à la fois le résultat et le processus d’une sécrétion, comme ces couches de soie - de soi:
"En moi-même je rentre. Je m’y installe un endroit délicieux et féroce d’où je regarderai sans la craindre la fureur des hommes. J’espère le bruit du canon, les trompettes de la mort, pour disposer une bulle de silence sans cesse recréée. Je les éloignerai encore par les couches multiples, et toujours plus épaisses, de mes aventures d’autrefois, mâchées, remâchées, bavées autour de moi, filées et enroulées comme la soie du cocon."
Le voile marque le secret, le rend re-marquable, il partage ainsi la nature du texte de fiction. La fiction n’est sans doute ni plus ni moins qu’un pli, un voile de langage mis contre la nudité de l’être - ce qui ne veut pas dire sa vérité, dans le journal de ce farceur. Là, devant la scintillation du crachat de Stilitano, devant ce palais, cette voûte, ce "ciel de la bouche" (comme on dit encore en portugais), l’émoi de Genet est de pouvoir chanter, nommer en secret. Le chant fait aimer la chose chantée, mais l’anéantit dans le même geste. Le corps, le monde, semblent n’exister que par la folie de ce langage qui les inscrit dans un chant qui précède leur apparition. Et leur mise à mort: "Celui qui nomme, dénomme - le grand dénominateur officie tout près de l’échafaud, au moment où ça tombe."
La trahison par rapport à cet objet aimable n’est donc pas exclue, au contraire, elle fournit l’horizon esthétique de la nomination: "C’est qu’elle est belle si la trahison nous fait chanter." Dans cette phrase quelque peu énigmatique par sa formulation, sa tournure, sa torsion, d’abord on nous dit "elle est belle", pour seulement après la nommer, la trahison, enchaînée à la condition de cette beauté, à ce "si" qui la ligote. La trahison a une dimension morale, bien sûr, à propos de laquelle Genet s’explique:
"C’est peut-être leur solitude morale - à quoi j’aspire - qui me fait admirer les traîtres et les aimer. Ce goût de la solitude étant le signe de mon orgueil, et l’orgueil la manifestation de la force, son usage, et la preuve de cette force. Car j’aurai brisé les liens les plus solides du monde: les liens de l’amour. Et quel amour ne me faut-il pas où je puiserai assez de vigueur pour le détruire."
Comme à Abraham, "Il lui faut haïr et trahir le plus aimable." C’est l’ouverture de la responsabilité, l’aporie qui inscrit la foi dans une logique de la promesse. La foi, la fable de la foi, doit pouvoir prendre en compte la folie de cette promesse menaçante. C’est par amour qu’on brise les liens de l’amour, telle est l’inquiétante formule vers laquelle coule le désir de Genet, qui fait de la sécrétion son secret. C’est donc par fidélité à son secret que Genet peut mener ce qu’il appelle sa "recherche esthétique autant que morale" et ériger la trahison en catégorie productrice de sens et de beauté.
On pourrait mettre en rapport l’idée de parjure, telle qu’elle est exposée dans Donner la mort et surtout dans Le monolinguisme de l’autre, avec les scintillations du mot trahison dans le Journal du voleur. Genet y témoignerait ainsi plutôt que d’une conscience sacrificielle, rituelle, "archaïque" (selon l’incontournable lecture de Sartre), d’une foi illimitée, hyperbolique dans la langue. Car "le parjure même, le mensonge, l’infidélité supposeraient encore la foi dans la langue; je ne peux mentir sans croire et faire croire à la langue, sans accréditer l’idiome." Foi hyperbolique: plus je mens (y compris le mensonge dit "de la fiction"), plus je fais valoir ce formidable attachement à la langue, la croyance en ses pouvoirs. Cette foi sous-tiendrait ce qu’on pourrait ici, à en croire Genet, appeler une poétique, placée au coeur de sa prose autobiographique. Cette prose est hantée par la poésie, celle de Mallarmé, comme le souligne Sartre, mais aussi celle de Rimbaud, dont il ne parle guère, pour des raisons sur lesquelles il conviendrait peut-être de s’interroger un jour. Genet écrit: "Féroce et pur j’étais le lieu d’une féerie qui se renouvelait." On entend presque venir "le temps des assassins", ce mélange troublant de douceur et de violence:
"J’offris donc aux bagnards ma tendresse, je les voulus nommer de noms charmants, désigner leurs crimes avec, par pudeur, la plus subtile métaphore (sous le voile de quoi je n’eusse ignoré la somptueuse musculature du meurtrier, la violence de son sexe)."
"J’ai voulu, dit encore Genet à propos des objets et des êtres réputés vils, "qu’ils aient droit aux honneurs du Nom." On trouve ici la dimension proprement poétique de son texte, où le nom et le pardon se confondent, les honneurs du nom marquant une promesse, là où se pardonner, pardonner l’autre et se consoler se retrouvent. Mais ici comme ailleurs, le pardon se définit en négatif, il se retranche de la généralité: il n’est ni "excuse", ni "justification", ni "indulgence", ni "pitié". "Pardonner, c’est consacrer le mal qu’on absout comme un mal inoubliable et impardonnable." Genet a du talent pour le pardon:
"Je voudrais être mes vieux camarades de misère, les enfants du malheur. J’envie la gloire qu’ils sécrètent et que j’utilise à des fins moins pures. Le talent c’est la politesse à l’égard de la matière, il consiste à donner un chant à ce qui était muet."
Pardonner, c’est donc autre chose, c’est tout autre. Pardonner implique le don d’un chant. C’est ce qu’il faudrait comprendre de la lèpre comme figure du mal qui trouve en lui-même sa consolation, son pardon, son chant:
"La lèpre, à quoi je compare notre état, provoquerait, dit-on, une irritation des tissus, le malade se gratte: il bande. Dans un érotisme solitaire la lèpre se console et chante son mal. La misère nous érigeait. A travers l’Espagne nous promenions une magnificence secrète, voilée, sans arrogance."
Partout des secrets, des sécrétions, des voiles. Si l’immonde devient monde par le langage, par le chant, il ne s’agit pas d’une simple entreprise de réhabilitation ou de renversement des valeurs, du négatif en positif et l’inverse. Il s’agirait plutôt ici de la mise en scène de l’origine imaginaire, à la fois sombre et radieuse, du chant. Du chant ou de la poésie, de "ce que - à défaut d’autres mots - je nommerai la poésie", de la poésie entendue comme paléonyme, encore un, comme Europe ou culture, par exemple, mots qu’il faut garder, "pour ce que nous (nous) rappelons ou ce que nous (nous) promettons." Et Genet avance un mot qui semble encore plus ancien, le lyrisme, un mot qui bande. La lyre, c’est l’instrument, la poésie comme chant, et c’est ce que revendique Genet quand il veut parler de ce qu’il fait:
"J’utiliserai les mots non afin qu’ils dépeignent mieux un événement ou son héros mais qu’ils vous instruisent sur moi-même. Pour me comprendre une complicité du lecteur sera nécessaire. Toutefois je l’avertirai dès que me fera mon lyrisme perdre pied."
C’est à cause du caractère archaïsant de ce chant (car l’orgiaque est là, l’excès, le démonique, le mystère païen, la menace d’indifférenciation, la métamorphose, la dissolution, la fusion - "perdre pied") que Sartre peut développer ses justes observations à propos du caractère sacré de certains agencements symboliques du texte de Genet. Selon Sartre, l’objet en vient à être dépouillé de sa réalité de chose et devient par là une non-chose, une chose vide ou sacrée, donc un symbole. Tout comme Genet lui-même, sans doute: la voix qui parle dans ce Journal n’est-elle pas celle d’un mort? C’est Sartre qui le dit:
"Ses ouvrages sont remplis de méditations sur la mort: la singularité de ces exercices spirituels, c’est qu’ils ne concernent presque jamais sa mort future, son être-pour-mourir; mais son être-mort, sa mort comme événement passé."
Ce qui conférerait une extraordinaire intensité à ces pages où il s’acharne à dire la nudité de l’être, en la voilant pour mieux la révéler, depuis le lieu spectral de la parole d’un mort vivant.
Le Journal du voleur apparaîtrait alors comme le journal d’un mort, d’un survivant, comme toute autobiographie sans doute, mais d’un survivant qui, selon un chant scandé par la trahison, se rapproche et s’éloigne de lui-même, des autres survivants, de l’autre en tant que survivant, des objets de son amour menacés de destruction par cet amour même, par ce chant d’amour. Je vous cite une parenthèse de Genet:
"(Prétextes à mon irisation - puis à ma transparence - à mon absence enfin,- ces garçons dont je parle s’évaporent. Il ne demeure d’eux que ce qui de moi demeure: je ne suis que par eux qui ne sont rien, n’étant que par moi. Ils m’éclairent, mais je suis la zone d’interférence. Les garçons: ma Garde crépusculaire)."
C’est une auto-hétéro-biographie du désir du condamné à mort, double désir, double bande, le désir pour le condamné à mort et le désir de cet autre condamné à mort qu’est Genet en tant que sujet transi par son secret. En un certain sens, ce qu’on appelle la vie est alors plus vivant que jamais, plus érotique, plus frémissant, et aussi plus absent, plus loin, encore moins là, au seuil qui irréalise ces deux modalités impossibles de l’être, vie et mort confondues dans le chant autobiographique de Genet, ce rejeton de lui-même, ce rejeton de sa Genèse.
Mais celui qui écrit "L’enfant mélodieux/Mort en moi bien avant que ne me tranche la hache", est-ce "seulement" le secret de sa mort qu’il met ainsi en scène indéfiniment dans son Journal? Ce serait déjà beaucoup. Toutefois, il ne s’agit pas de la mort de son innocence; nous assistons plutôt à cette mort représentée par éparpillement des membres ("melos") empêchant tout rassemblement dans l’unité de l’autobiographié. Mélodieux, il faudrait mettre cela littéralement en rapport avec chant et lyrisme, plutôt qu’avec innocence (comme dans la lecture sartrienne). Car il n’y eut bien sûr jamais d’innocence. L’innocence perdue est une ruse du sujet autobiographique. Le schéma "liturgique" indiqué par Sartre, le thème de la perte du paradis de l’enfance, n’explique pas l’antériorité du chant. Celui-ci constitue une espèce d’avant-premier chant, comme Derrida avait parlé ailleurs d’une "avant-première langue", langue du désir, chant du désir. Il n’y eut jamais d’innocence au sens d’absence de dette (Unschuld). "Comme toujours, c’est le désir qui engendre la faute. Il est la faute." Le désir engendre une dette qu’il aura toujours déjà fallu assumer. Chanter est déjà coupable (au sens de ce qui peut être coupé).
Revenons à la responsabilité orgiaque. La critique la plus puissante du christianisme, nous dit Derrida dans Donner la mort, devrait interroger le rapport entre croyance et crédit, ce rapport qui instaure une "disproportion structurelle, dissymétrie entre le mortel fini et responsable d’une part, la bonté du don infini d’autre part. On peut penser cette disproportion sans lui assigner une cause révélée ou sans la faire remonter à l’événement d’un péché originel, mais elle transforme inévitablement l’expérience de la responsabilité en culpabilité (…)"
Le christianisme ne ferait que tourner à la ronde infernale d’une dette insolvable où la justice finit par se détruire elle-même, se niant et se conservant dans ce qui semble l’excéder - la grâce (Gnade) comme privilège des plus puissants (c’est à peu près la critique de Nietzsche). Contre la dette et le calcul, contre l’intérêt de ceux qui prêtent ou donnent aujourd’hui pour voir multiplié demain ou après-demain ce qu’ils ont engagé, que ce soit l’argent, ou l’Esprit, encore une fois c’est la figure du don qui semble fournir une réponse adéquate (c’est à peu près la critique de Baudelaire). Le don sans calcul qui s’oppose à ce modèle, qui tranche sur lui, n’est pas chrétien en tant que tel, il serait chrétien seulement dans la mesure d’un christianisme à venir, hérétique, comme celui dont Patocka dessine l’histoire, pour en relancer la courbe.
La littérature, qui s’apparente au secret abrahamique de la responsabilité religieuse, porte aussi la marque de cette parenté:
"De l’étrange filiation que nous lui soupçonnons, en mémoire de tant de pères et de fils, en mémoire de tant et tant d’hommes prêts, sans jamais y parvenir, et peut-être sans jamais y croire, à se donner la mort à mort, elle garderait au moins ce trait que nous nommerons d’après Baudelaire: elle peut toujours apparaître comme "littérature homicide et suicide". Histoire des hommes et non des femmes. Histoire des "semblables". Histoire de la fraternité, histoire chrétienne. "- Hypocrite lecteur, - mon semblable, - mon frère!""
Est-ce la raison pour laquelle Genet (il n’est sans doute pas le seul) "sonne le glas" de la littérature? Parce que ce qu’il fait ne peut pas être appelé littérature sans la révision du concept? Ici s’ébauche peut-être - et peut-être doit-elle rester une ébauche - une paradoxale justice hérétique qui refuserait la grâce. Qui choisirait l’immonde fraternité d’un alligator souriant. Qui ne veut pas d’une grâce qui ne s’accorde pas aux reptiles, à ceux qui rampent.