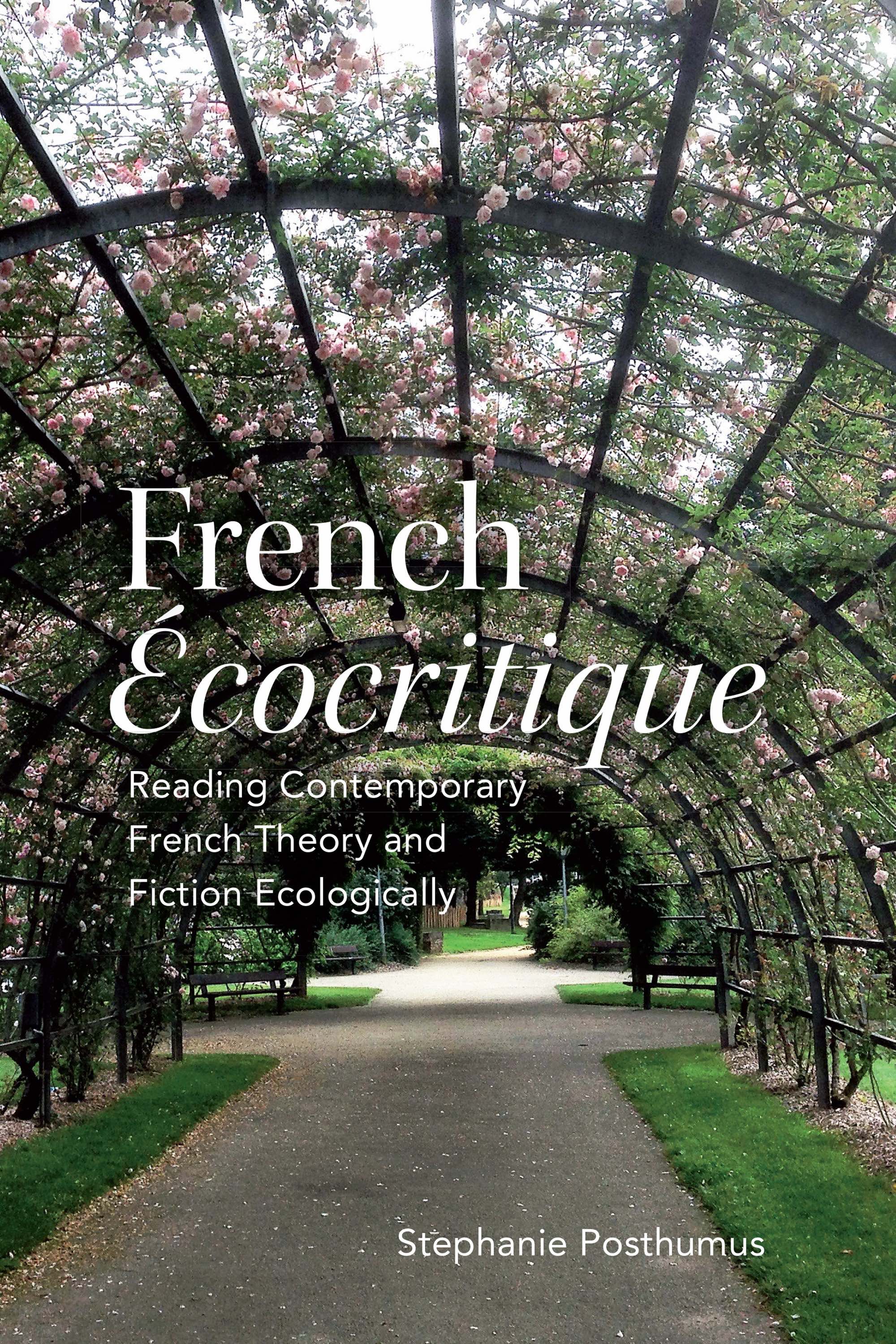À la lecture du terme « écocritique », le lecteur non averti (cette discipline ayant encore du mal à se frayer un chemin dans le milieu scolaire et populaire francophone) pourrait être tenté d’associer l’ouvrage de Stéphanie Posthumus à un plaidoyer pour de nouvelles pratiques écologiques. Mais l’auteure ne laisse aucune possibilité pour réduire son travail à un compte-rendu des problèmes environnementaux. Dès les premières pages (et ce sera répété tout au long du livre) l’emphase est mise sur l’humain, mais pas dans une perspective anthropocentrique, et sur sa relation avec son environnement. Elle pose les contours de son travail en se définissant par opposition à plusieurs concepts. Luc Ferry lui sert ainsi de point de départ tant pour introduire le contexte écocritique français que pour poser les bases de ce qu’elle réfute. En tant que penseur français connu, L. Ferry a influencé les prémisses de la pensée écocritique française, et son influence (négative) explique en partie la difficile émergence de la théorie littéraire sur ce sujet. Plusieurs clefs de lecture de French Ecocriticism sont à trouver dans sa relation avec Le nouvel ordre écologique de L. Ferry : S. Posthumus appelle à sortir de l’humanisme universel et prône une approche écocritique « culturellement située » (2017, 5). Elle réaffirme aussi de façon régulière l’indissociabilité de la langue et de la culture, une relation d’interdépendance à prendre en considération dans l’élaboration d’arguments qui se prévalent d’une portée globale. Justifiant sa démarche à travers cette construction dichotomique, S. Posthumus écarte d’emblée l’humanisme séculier et libéral incarné par L. Ferry, ainsi qu’une pensée catégorisante qui sépare la nature de la culture.
L’auteure s’attachera donc à créer des arguments et des concepts évitant le piège d’un humanisme universel anthropocentrique, en appuyant des concepts mouvants et souples, des processus, des devenirs et des transformations. Ses quatre chapitres présentent chacun un couple théoricien / romancier afin de mettre en lumière les quatre concepts précédemment mentionnés.
Comment peut-on construire une « subjectivité écologique » et en quoi est-elle essentielle pour inclure l’environnement dans une définition de soi ? C’est la question qui sous-tend le premier chapitre, et pour y répondre S. Posthumus se base sur le concept d’écosophie créé par Arne Næss et développé par Guattari, couplé à un choix de romans de Marie Darrieussecq. Guattari cherche à mettre en place un paradigme éthique et esthétique à travers trois écologies : l’écologie mentale (en lien avec la psyché humaine), l’écologie sociale (tous les processus sociétaux), et l’écologie environnementale (pour nos rapports à la nature). La spécificité de sa démarche, qui recoupe la pensée de S. Posthumus, est de considérer la subjectivité comme un processus en mouvement. Comme l’auteure, il rejette l’idée d’une identité fixe, d’un soi qui serait transcendant. C’est une des balises que l’on peut relever dans French Ecocritique, lorsqu’on y cherche le propos de l’écrivaine plus que celui des textes étudiés : si l’on veut repenser l’humain et ses rapports à ce qui l’entoure, il est primordial de ne pas mettre de côté la matérialité et l’immanence de l’expérience humaine (en tant qu’expérience animale, aussi). Ce point fait écho à l’idée de mettre fin à l’exception humaine, que l’on retrouvera au cours de la lecture. Il est aussi lié à sa construction en opposition à L. Ferry, puisque la séparation entre nature et culture est centrale dans sa pensée, alors que l’immanence et l’instabilité de la subjectivité dans la philosophie de Guattari et dans les romans de Darrieussecq éliminent cette séparation : il y a nécessairement incarnation de l’expérience. C’est cette instabilité dans la fiction (la romancière utilise le genre de l’autofiction, qui brouille les conventions littéraires), pourtant axée sur des expériences à échelles individuelles, qui fait émerger le concept de subjectivité écologique. L’alliance entre théorie et fiction apparaît essentielle pour faire le lien entre le local et le global, l’abstrait et le concret.
Les textes utilisés permettent à la fois à S. Posthumus d’élaborer de nouvelles théories, mais aussi tout simplement d’illustrer sa pensée. L’écosophie de Guattari fait ainsi écho aux concepts qui encadrent le livre : tout comme les sphères constituant la pensée écocritique (mentale, sociale, environnementale), les concepts de l’auteure sont co-dépendants et prennent tout leur sens dans cette relation de dépendance.
Ce premier chapitre permet à Posthumus de mettre sa démarche sur pied : elle procédera par une brève présentation de ses auteurs (les « portraits »), avant de se concentrer sur la partie théorique, puis sur la fiction, pour finir par joindre les deux. Le processus a le mérite de lui permettre de clarifier sa pensée et ses arguments.
Poursuivant sur le même modèle, l’auteur s’interroge sur ce que signifie « to live ecologically » (2017, 10), qui lui permet de construire le concept d’« ecological dwelling » que je traduirai par « habitat écologique ». Fidèle à ses ambitions et à ses convictions, elle insiste à nouveau sur le fait que son propos (tout comme son corpus) ne se cantonne pas à des idées d’actions concrètes pour résoudre les problèmes environnementaux. J’insiste moi-même sur ce point (et la façon dont est construit le livre me poussera à y revenir), mais c’est peut-être ce qui permet le plus à l’auteure de se distinguer dans son domaine, tout en revendiquant l’intérêt littéraire de son argumentation. Ainsi, il ne s’agira pas ici de discuter de la mise en place de maison autosuffisante. L’habitat écologique renvoie, tout comme la subjectivité écologique, à la matérialité de l’expérience humaine, qui passe avant tout par le corps et par la façon dont il perçoit, reçoit et interagit avec son environnement ; que ce dernier soit naturel ou culturel, puisque la distinction entre les deux n’a plus de valeur. Au plan théorique, S. Posthumus fait appel à Michel Serres et à son idée de « contrat naturel ». Serres utilise la figure du paysan (très présente dans l’imaginaire français) pour illustrer une forme de symbiose et de co-dépendance à l’échelle locale, sur laquelle il prend appui pour construire un « habitat écologique » à échelle globale. L’échelle individuelle est aussi mise en avant dans les romans à l’étude, puisque Marie-Hélène Lafon peint la difficulté de la vie rurale et la menace qui pèse sur l’identité paysanne, à travers des histoires personnelles. Elle écrit de façon réaliste, sans nostalgie, tout en montrant comment la vie est « composed, renewed and regenerated » (2017, 10), s’inscrivant ainsi dans l’idée de transformation prônée par S. Posthumus. C’est aussi ce qui lie le philosophe et la romancière, puisque tous deux ont pour visée de repenser notre relation à la terre à travers la figure du paysan. Dans les deux cas également, le cœur du propos se trouve dans l’incarnation de l’expérience. Le lecteur est complètement plongé dans un monde de sensations à travers la littérature de M-H. Lafon ; Serres présente la terre comme un corps qui est en échange constant avec son environnement (dans lequel sont inclus les humains). Au final, Serres comme Lafon mettent l’emphase sur l’incarnation du langage : tous deux présentent et expérimentent le langage en tant que lieu où l’on raconte, en tant qu’habitat écologique : « the French language represents an oikos for both Lafon and Serres, and so becomes one of ways in which they live and convey a sense of embodiment » (2017, 164). Cela reflète également l’utilisation de la langue qu’a Posthumus, puisqu’en choisissant d’écrire en anglais, tout en gardant certains concepts ou citations en français, elle dévoile le processus langagier comme étant imbriqué dans la culture et indissociable de pratiques matérielles. La prise en compte de l’environnement passe, dans tous les cas, par la langue : « the reader becomes aware of the richness of the french language, its ability to go beyond abstract and universal concepts and describe the thick vicosity of the real world without necessarily imposing order on it » (2017, 92).
Cet ancrage dans le monde matériel se poursuit et se renforce dans le troisième chapitre, qui aborde la question de la politique à mettre en place afin d’englober le non-humain. Suivant toujours ses deux fils rouges, S. Posthumus soutient que les « ecological politics » doivent être critiques de l’environnementalisme tout en proposant un nouveau paradigme écologique qui éviterait le piège d’un combat entre humanisme et anti-humanisme (piège dans lequel L. Ferry s’engage). L’auteure s’inscrit dans la pensée philosophique de Bruno Latour, selon lequel le non-humain doit prendre place dans les systèmes culturels, s’y incarner, sans pour autant attribuer de valeur intrinsèque à la nature, contrairement à ce que fait la tradition anglophone. Réfutant également la séparation entre nature et culture et entre les « matters of facts from matters of concern » (2017, 102), le philosophe appuie la particularité francophone tout en s’opposant à L. Ferry. L’ensemble de ces postulats se retrouve dans les romans de Jean-Christophe Rufin, dont l’œuvre est analysée dans ce chapitre. Les fictions de Rufin critiquent également l’environnementalisme anglophone tout en posant la question de la représentation du non humain dans les systèmes démocratiques contemporains.
Le concept d’écologie politique s’impose comme un moyen efficace de répondre à des problématiques globales à travers les particularismes français en matière de relation à la nature et à l’environnementalisme. Il est aussi important de noter que c’est le premier passage du livre ouvertement critique du capitalisme. L’auteure semble avoir attendu d’aborder de front la question de la politique pour attaquer notre système économique, et même si ce désaveu transparait à chacun de ses arguments, l’exprimer ouvertement s’inscrit dans l’argumentation de ce troisième chapitre. En effet, le système capitaliste se prête particulièrement bien au « greenwashing », qui consiste à se donner bonne conscience en écologisant quelque peu les pratiques actuelles. Or cela ne change pas le système en profondeur, et sans ce changement, sans cette sortie du capitalisme, le « monde commun » auquel aspire l’auteure ne peut être mis en place. C’est ce qui la fait pencher du côté de la pensée de B. Latour plus que de celle de J-C. Rufin. Si ce dernier est également critique vis-à-vis du capitalisme, il prône un retour à l’humanisme universel ; B. Latour argumente en faveur d’une politique écologique qui insérerait le non humain au système démocratique, tout en sortant du capitalisme : « by giving voice to a common world, they reveal a path toward deeper systemic change than simply “greening” current “economic” pratices » (2017, 124).
Le concept de « politiques écologiques » permet d’imaginer des bouleversements sans précédent qui apparaissent aujourd’hui comme essentiels : en intégrant le non-humain aux questions politiques (la création d’un parlement de « choses » que demande Latour), de plus en plus de voix – donc d’intérêts – sont amenées dans la « polis ». Le non-vivant ne peut plus être laissé de côté et l’on sort plus facilement d’un humanisme anthropocentrique. Enfin, cela permet d’imaginer une porte de sortie du capitalisme. Il est nécessaire de s’arrêter sur le terme d’imagination, qui recentre la question sur le littéraire. En effet, la conception de nouveaux mondes passe inévitablement par le récit, l’histoire en tant que fiction. La littérature, les romans sont primordiaux pour concevoir des changements aussi importants que ceux mentionnés, pour que le lecteur ressente et expérimente ces nouveautés : « the novels create room for ecological readings that identify other ways of viewing and experiencing the world, that bring an awareness of political ossues to the text rather than reducing the text to a single political message » (2017, 125).
L’importance de l’expérience d’écriture et de lecture est au centre du quatrième et dernier chapitre, qui couvre le concept de « fins écologiques ». L’humain y est abordé principalement en tant qu’homo literatus. Les romans de Michel Houellebecq, connu pour ses vues assez pessimistes, présentent différentes visions post-humaines, ou du moins de l’humanité telle que nous nous la représentons aujourd’hui. Ce chapitre se concentre également sur le rôle que peuvent jouer ces fins éventuelles dans l’imaginaire collectif. Se pencher sur la probable extinction de l’espèce humaine est une expérience de pensée certes désagréable, mais qui permet aussi de resituer l’humain en tant qu’entité biologique, faisant partie de la vie sur terre. Dans cette conception, l’exception humaine est définitivement évacuée, et sans tomber dans des visions apocalyptiques (les romans étudiés n’explorent pas cette voie, mais plutôt celle de la transformation de la vie humaine, allant jusqu’à aborder la question du clonage). M. Houellebecq comme Schaeffer (qui vient appuyer la partie théorique de ce chapitre) imaginent la fin écologique des humains en tant qu’êtres d’exception. Cependant, avec une vision plus matérielle de l’humain, le risque court de tomber dans le réductionnisme biologique, et c’est sur ce point que les chemins empruntés par les deux auteurs diffèrent. Là où Schaeffer « articulates a non dualistic view of the nature culture continuum » (qui, comme on le sait, est chère à la pensée de Posthumus) Houellebecq « illustrate a problematic determinism according to which humans and animals are bound to the « laws of nat » (2017, 128). Ces questions entrent dans le contexte plus large du posthumanisme, qui se divise en deux branches : l’une rendant compte du binarisme humain / machine ; l’autre éliminant le binarisme humain / animal, avec pour but de repenser notre responsabilité éthique vis-à-vis des animaux. Or cette notion d’animalité est particulièrement présente dans le contexte français. Schaeffer l’intègre à la question de l’éthique en écrivant en faveur d’une considération accrue des faits scientifiques et sociaux, de la prise en compte des contextes d’études, pour aboutir à une vision non binaire et non dualiste de l’homme et des animaux. La notion de vivant fait également son apparition, précisément pour qualifier cette absence de distinction entre l’humain, l’animal et leur environnement. Pour le théoricien, l’évolution doit être repensée comme étant basée sur d’autres principes que la sélection naturelle, et doit être vue comme non théologique. Cette position apparaît comme un autre jalon permettant de poser la question de notre survie terrestre.
Pourtant, Houellebecq présente la sélection naturelle comme un principe inévitable, et réduit l’humain à ce qu’il a de pire. Si cette conception est remise en cause dans le livre, ses romans n’en sont pas moins judicieux pour analyser la question de la littérature. S. Posthumus fait ressortir de son analyse deux conceptions opposées, mais dont l’opposition s’avère significative : d’un côté ressort une croyance humaniste dans la littérature, considérée comme essentielle à la condition et à l’expérience humaine, et d’un autre côté l’auteur n’hésite pas à mettre en scène un monde post-humain dans lequel la littérature n’a plus sa place : « they reveal a productive tension between a posthumanist view of humans as part of the natural world and a humanist rethinking of the role of literature and stories in the larger context of humans as species » (2017, 156). La littérature se place, dans ce contexte, comme l’exception humaine par excellence, mais une exception qui n’est ni biologique ni immuable. La vision de Houellebecq nous permet de nous projeter dans un futur exempt de nouvelles histoires, de nouveaux récits, et celle de Schaeffer propose un élargissement de ces notions. Il se positionne en faveur d’une vision plus englobante, qui permettrait de regrouper sous le terme de récit les films, les jeux vidéos, l’écriture numérique… bref, les productions fictionnelles contemporaines, hors de l’écriture papier.
Cette dernière vision, qui conclura la notion de fins écologiques, entre dans l’idée d’une vision comparatiste, et permet d’élargir les possibilités d’expériences et de réception du monde.
S. Posthumus conclut son livre par un résumé de son approche, qui reprend les grandes idées que nous avons suivies : « While critical of the humanistic self, my ecocritical approach includes the human without resurrecting the universal (white, male) human subject. It does so by emphasizing processs of subjectivity, examining the modes of embodiment, opening politics up to the agency of non-humans, and accepting science as a way of making forms of life matter, as a way of « rendering » certain material processes and not other » (2017, 159). Sa démarche a le mérite immense d’ouvrir la voie vers de nouvelles approches littéraires, tant théoriques que fictionnelles, tout en agrandissant le rôle que ces disciplines peuvent et doivent jouer dans le contexte actuel de crises écologiques et sociales (et plus précisément dans l’optique d’une approche comparatiste). Cependant, l’étude reste centrée sur un corpus principalement composé d’hommes blancs, et s’appuie sur des particularismes culturels français, donc traditionnellement mis en avant dans les études. Mais S. Posthumus est consciente de ces faits, qu’elle souligne elle-même, et il faut garder en tête que ces caractéristiques françaises sont un pont permettant de rendre compte de phénomènes à l’échelle globale.
La littérature reprend donc une place centrale dans la manière de penser l’humain et pourrait s’avérer salutaire dans un futur proche, en tant qu’outil de projection et de diffusion d’expériences. Si allier la théorie et la fiction de manière aussi méthodique se révèle extrêmement productif, on peut questionner le fait d’écarter aussi radicalement l’environnementalisme et les outils pratiques qui permettraient à l’humanité de prendre un immense virage. Repenser la subjectivité, repositionner l’humain en tant qu’entité biologique, élaborer de nouvelles visions posthumanismes englobant le non vivant, tout cela doit prendre vie et corps dans des expériences concrètes.
Bibliographie
Posthumus, Stephanie. 2017. French Ecocritique: Reading Contemporary French Theory and Fiction Ecologically. University of Toronto Romance Series. Tortonto: University of Toronto Press.