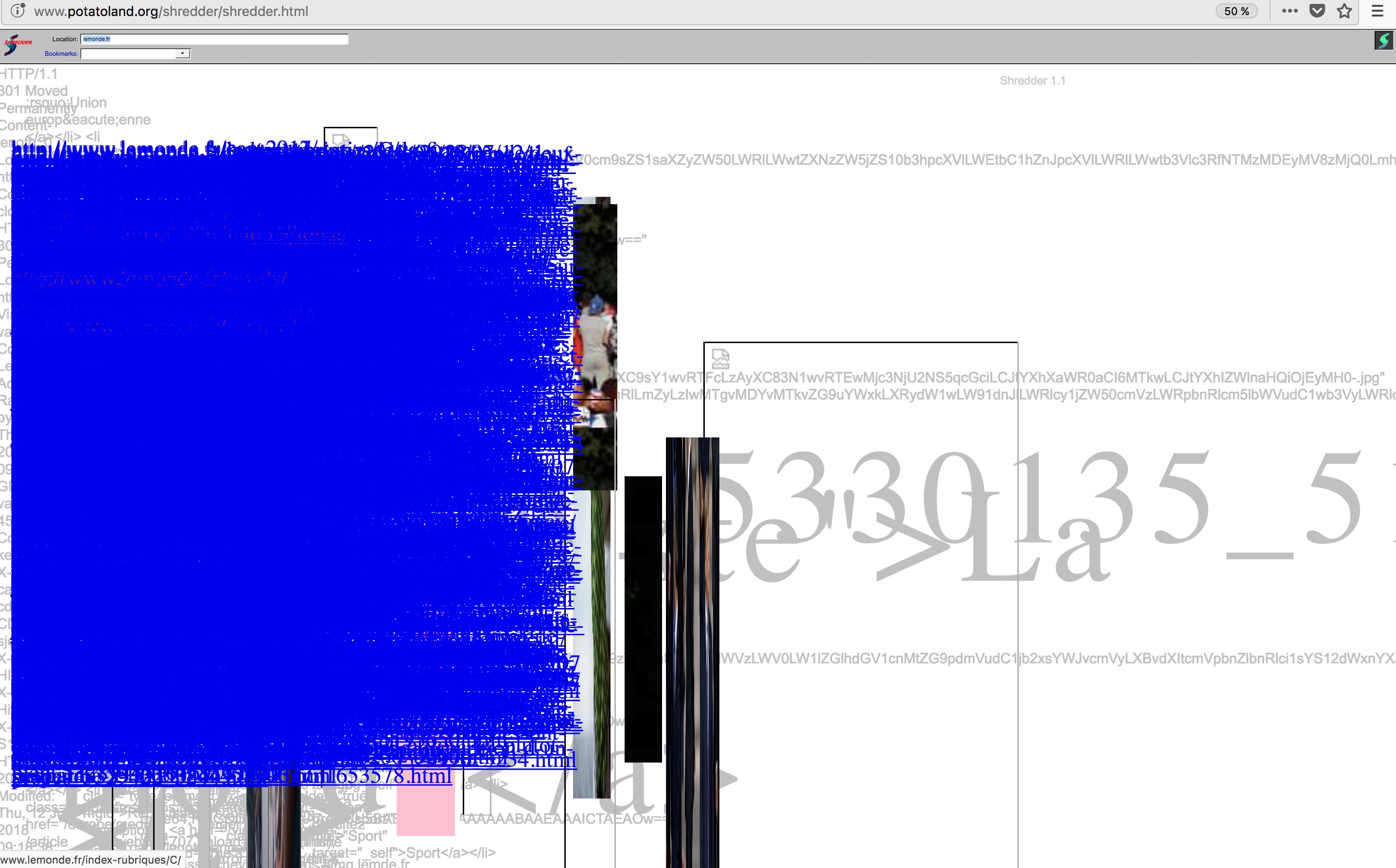Dans le monde actuel, du fait des applications de plus en plus nombreuses, offertes par diverses machines (téléphone, ordinateur, télévision), les pratiques mobilisant le virtuel deviennent omniprésentes. Toutefois, le virtuel reste assez mal circonscrit. La plupart du temps, soit il est dévalué pour être considéré comme peu de choses face au poids du réel, se présentant alors comme une chimère, soit, au contraire, le virtuel est tenu pour l’équivalent de la réalité, soit encore, et avec l’appui d’Aristote, il est défini comme un fait en puissance. Dans certains cas encore, il se présente comme le modèle idéal de la réalité. Enfin, il est souvent envisagé comme un concept lorsqu’il est censé expliquer le réel ou posséder des vertus interprétatives. En conséquence, on ne peut que constater d’emblée combien son rapport à la réalité est élastique puisqu’il relève tantôt de la fiction tantôt du réel.
Son domaine propre reste également indéterminé, le virtuel oscillant entre le sensible — la fiction — et l’intelligible — lorsqu’il est hissé au rang d’un concept. Sans compter enfin l’imaginaire auquel on l’associe pour vanter ses vertus ou, au contraire, avertir de ses dangers, à travers tout un ensemble de représentations. Ainsi du slogan « grâce à internet, cet homme est un poète » qui présente le virtuel comme un sésame, ou inversement, le contrôle généralisé auquel il conduirait et qui se manifesterait par l’impossible oubli dans un monde où tout ce qui procède du calcul est par définition en mémoire.
Aussi, le virtuel agrège-t-il des significations diverses et variées1 qui laissent très souvent de côté sa face cybernétique pourtant au cœur des images et des environnements virtuels, par exemple, ou encore du cyberespace et d’internet. Ce flou définitionnel et théorique invite à déconstruire le virtuel notamment en observant comment cette notion s’est constituée, construite ou reconstruite et, en particulier, au contact de quels édifices théoriques. En guise d’introduction à cette généalogie ou à cette épistémologie du virtuel, j’explorerai dans un premier temps la définition du virtuel, telle que l’énonce le philosophe M. Serres, qui résonne étrangement avec mon analyse du virtuel comme notion-valise. Je définirai, dans un second temps, le virtuel cybernétique pour montrer ensuite combien les pratiques artistes du virtuel ont su en saisir remarquablement la singularité. Dans un troisième temps, je reviendrai à la notion de virtuel pour la resituer dans la philosophie d’Aristote d’abord, dans celle de G. Deleuze ensuite, parce que l’une et l’autre sont très mobilisées dans les analyses qui entendent circonscrire le virtuel au cœur des pratiques sociales actuelles. Enfin je conclurai sur l’analyse d’A. Cauquelin qui se confronte, en philosophe, au virtuel cybernétique.
Le virtuel, une notion-valise
Le virtuel apparaît si déconcertant que la comparaison et l’étymologie se trouvent fréquemment sollicitées pour tenter de le cerner. Mais la philosophie n’est pas en reste comme d’ailleurs l’épistémologie des sciences ou encore la physique qui sont, elles aussi, mobilisées. C’est la perspective étymologique que suivent, notamment, Ph. Quéau, et plus récemment M. Serres. Ainsi, celui-ci accorde une importance à sa racine latine, la vertu, à tel point que le titre de son intervention, lors d’une séance à l’Académie, la reprend2.
Le virtuel a d’abord, rappelle-t-il, le statut d’un adjectif dérivé du substantif vertu qui signifie principe. Aussi et comme la vertu, virtuel est-il un principe qui renvoie à un « il est possible » ou à un potentiel. Virtuel est également, et nécessairement, cause de, ou origine d’un effet. Aussi, est-il l’équivalent de la puissance, c’est-à-dire encore du « il peut » qui n’oblige jamais au passage à l’acte ou laisse l’acte en suspens. M. Serres écrit ainsi à propos du verbe pouvoir qu’il s’agit d’un « mot d’où dérive potentiel, pas toujours en acte, en puissance souvent, autrement dit virtuel. » (2012, 3).
Mais ce n’est pas tout, à l’adjectif virtuel défini comme principe du possible, comme cause de tout effet et comme puissance, s’ajoutent encore le fictif, l’imagination, l’illusion, le divertissement onirique. Imagination sur laquelle M. Serres insiste pour l’identifier comme la pièce maîtresse de la connaissance et des vérités humaines, « d’autant plus réelle qu’elle est virtuelle »3. Et M. Serres d’ajouter que virtuel a valeur d’« épistémologie exacte des sciences humaines molles » (2012, 7). Dès lors et en conséquence, n’est-ce pas le tenir pour un concept ? Dans ce très court texte, on observe ainsi la puissante attraction du virtuel qui, tout à la fois, a le statut d’un concept, mais renvoie aussi à la fiction et à l’imagination. Reste néanmoins dans l’ombre sa face cybernétique.
Cette dernière est évoquée brièvement comme « possibles […] mais [cette fois] dans les formes, les choses et le monde » (Serres 2012, 8). Ce sont les « explosions issues de l’algèbre combinatoire, l’éventail […] des probabilités […] les géométries, les programmes et les algorithmes, pour les mathématiciens ; […] la théorie du chaos […] pour les astrophysiciens… » (Serres 2012, 8), M. Serres, in fine, ne prend toutefois guère la mesure de sa spécificité en définissant le livre et le roman comme les plus antiques techniques du virtuel, Facebook étant leur équivalent moderne actuel4. Bref, si le virtuel est semblable à « une pluie infinie des possibles » (Serres 2012, 8), il reconnaît néanmoins que pour les sciences dures, le virtuel est de l’ordre du nécessaire et non du contingent ou de l’aléatoire5, et conclut sur l’association du virtuel et du réel qu’il juge comme une heureuse combinaison pour comprendre et connaître6. En se gardant d’opposer l’un et l’autre, M. Serres ouvre ici une voie de recherche féconde à explorer.
Toutefois, comment sortir de cet embrouillamini quand le virtuel agrège autant de significations différentes ? Celui-ci tenant à la fois du concept, de l’imagination et des sciences dures, et en particulier de la cybernétique. Comment notamment saisir sa spécificité au cœur des applications informatiques dont nous usons continûment avec internet, ou encore au cœur de la réalité augmentée et de la RV 7? Son domaine n’est-il pas celui des calculs, de la modélisation, des algorithmes ? Les artistes qui l’expérimentent n’en montrent-ils pas la spécificité ?
Virtuel et cybernétique
Tandis que le virtuel — en jeu dans les pratiques et les usages des objets de communication et de leurs applications — se rapporte au calcul (c’est même son domaine roi), ce dernier n’a, paradoxalement, pas droit de cité. Rien, en effet, n’est presque jamais dit sur la matrice logico-mathématique, sur la modélisation ou sur les algorithmes qui, principiellement, en constituent le fondement. Tout se passe comme si matrice, modèle, algorithme étaient gommés, voire niés ou déniés. On retrouve ici ce qu’observent certains anthropologues du monde contemporain à propos de la technique, l’impératif de la garder voilée et de la masquer afin de la naturaliser. Dès lors, toute critique se voit hypothéquée, et toute compréhension du fait technique écartée, voire interdite. En déduire que cet « impensé » devient le socle de représentations diverses et variées associées au virtuel et qu’il autorise toute sorte d’emprunts à des théories philosophiques pour le circonscrire reste alors une hypothèse plus que plausible.
Le virtuel technologique, dirais-je, ou encore le virtuel cybernétique, pour le différencier du virtuel philosophique, dont l’histoire est chargée, demeure rarement pris pour ce qu’il est, de même que ce qu’il autorise. On le confond par exemple avec le numérique, soit avec un codage binaire de données, ou avec l’interactivité. On l’associe à toute sorte d’objets ou à leurs usages : qu’il s’agisse d’internet, du multimédia ou encore des jeux vidéo. Bref, sa définition technique demeure imprécise. Alors que la cybernétique est l’assise du virtuel technologique, la littérature accorde assez peu d’attention aux algorithmes8, par exemple, qui décrivent, via une série d’opérations, la fonction ou la tâche que l’ordinateur exécute. Si l’ordinateur mémorise, calcule et « choisit » une voie plutôt qu’une autre, l’algorithme, lui, est essentiel pour résoudre le problème posé en décrivant la méthode à suivre.
Ce que la cybernétique autorise surtout est l’expérimentation proprement virtuelle d’un modèle mathématique de n’importe quel système et non pas du système lui-même (Colonna 1993, pp. 79-95). Ce dernier a donc été modélisé puis programmé, mais il suppose préalablement d’avoir été théorisé à partir de l’observation de phénomènes ; la programmation permet ainsi le calcul des équations du modèle. À titre d’exemple, à partir d’expériences ou de mesures de la chute d’un corps dans le vide, est déduite une équation différentielle permettant de situer, selon deux grandeurs, l’état d’un objet dans le vide à un instant t. On peut ensuite programmer cette équation, ou ce modèle, de telle sorte qu’on puisse effectuer un nombre considérable de mesures et valider ou non le modèle de cet objet.
Le virtuel ne renvoie donc pas à une représentation d’un objet ou d’un système, mais à leur modélisation, objet ou système dont on connaît les lois scientifiques. Il se rapporte ensuite à la programmation informatique et aux algorithmes qui expriment les opérations ou équations de tel ou tel modèle entré dans le programme — les algorithmes conditionnant toute expérimentation du modèle. Le virtuel permet en conséquence et entre autres choses de tester la validité d’une modélisation, y compris lorsque l’expérimentation d’un système est impossible à réaliser (Colonna 1993, 82) in vivo dirait le biologiste.
Calculs et série d’opérations, voilà ce que recouvre le virtuel, et ce sont ainsi les échanges entre données ou entre nœuds et points d’un programme informatique qui le caractérisent. En somme, le virtuel se définit comme un système d’échanges de données sous forme numérique, des échanges en somme réglés par un modèle et via un programme, et transitant via des impulsions électriques de faible intensité (les microprocesseurs). Ce sont donc, et en d’autres termes, les échanges qui principiellement sont constitutifs du virtuel. Dès lors, ce ne sont guère les images, les sons ou, encore, les textes qui sont virtuels, mais plutôt les échanges dont ils sont issus. Des échanges, des opérations, des calculs insaisissables par les sens et qui resteraient invisibles sans un travail de mise en forme. Aussi, l’invisibilité est-elle ici au service de la visibilité ou apparaît-elle comme une condition du visible. Tel s’offre le virtuel technologique ou le virtuel cybernétique que les artistes explorent en travaillant les et sur les échanges.
Des mises en forme du virtuel ou de la relation comme forme9
À les regarder de près, les pratiques artistes du virtuel ne dévoilent-elles pas sa nature, en mettant l’accent sur les échanges, avec un travail de mise en forme — confirmant ici l’hypothèse d’un art qui ne montre pas seulement mais pense ? Telles apparaissent, à titre d’exemples, quelques œuvres comme Satellite Art Project de K. Galloway et S. Rabinowitz, Very Nervous System (ou VNS) de David Rokeby, ou Shredder de M. Napier.
Très tôt, dès les années 50, les artistes se sont intéressés aux échanges et aux performances que ces derniers permettaient. Des échanges qui retiennent leur attention même si, comme c’est le cas avec Clavecin bien tempéré, une œuvre de Nam June Paik, ou avec Satellite Art Project, le virtuel n’est pas à proprement parler encore exploré. Pour emprunter à P. Bayard l’un de ses concepts, Satellite Art Project ne plagie-t-elle pas par anticipation les pratiques artistes actuelles du virtuel ? On ne comprend bien cette œuvre de K. Galloway et S. Rabinowitz qu’à travers d’autres œuvres postérieures. Bref, on ne saisit qu’après coup que ce sont les échanges qui sont premiers et au cœur de l’œuvre, leur performance figurant ou exprimant ces derniers.
À la façon de Nam June Paik, avec son installation Clavecin bien tempéré trans-océanique qui voyait deux pianistes, éloignés de plusieurs milliers de kilomètres, interpréter une œuvre de J. – S. Bach10, K. Galloway et S. Rabinowitz mettent en scène ou plutôt mettent en forme des relations entre deux groupes de danseurs, situés à des milliers de kilomètres l’un de l’autre. De quoi s’agit-il avec Satellite Art Project, titre de l’œuvre réalisée en 1977 ? Non pas d’une sonate de Bach, comme dans la pièce de Paik que l’auditeur écoute depuis son transistor, mais d’une chorégraphie à regarder sur l’écran d’un moniteur. Une telle image animée reste bien singulière. En effet, l’image visible sur les écrans est composée de deux sources, situées de part et d’autre du globe terrestre, que les échanges satellitaires réunissent ou juxtaposent. Ainsi, cette image est-elle la forme prise par ces échanges.
Concrètement, le satellite transmet des images d’un lieu géographique vers un autre : images du groupe de danseurs américains situé à New York transmises à Moscou et que les danseurs soviétiques regardent ; images du groupe de danseurs moscovites vers New York pour les danseurs américains ; chaque danseur accorde alors ses mouvements sur ceux du danseur localisé à des milliers de kilomètres grâce à la retransmission ; les échanges satellitaires permettent ensuite de juxtaposer deux sources (ou modèles) physiquement éloignées.
Dès lors, les danseurs des deux groupes se voient rassemblés « dans » une image, de telle sorte que cette image se comporte comme un lieu, disent les artistes. Une telle image reste en effet inédite parce que la chorégraphie visible sur les écrans n’a lieu nulle part et parce qu’elle n’existe qu’à travers les échanges. Autrement dit, elle n’a pas de modèle ou échappe à la représentation. Une chorégraphie qui, pour ainsi dire, n’a pas de lieu propre et dont l’origine se situe dans les échanges de données satellitaires. Des échanges satellitaires qui, bien qu’invisibles, sont au service d’une image, ici, sous les traits d’une chorégraphie. Ou encore des échanges qui prennent cette forme chorégraphique. Si les artistes parlent d’image-lieu pour définir cette image si remarquable et ainsi la conceptualiser, J.-L. Boissier de son côté évoque plus volontiers l’image-relation pour définir l’image virtuelle. Ainsi avec Satellite Art Project, les deux artistes montrent-ils la spécificité des échanges, ici les échanges satellitaires, et expriment-ils la singularité de l’image qu’ils autorisent, une image sans modèle, contrairement aux images habituelles retransmises par satellite, telles les images d’une rencontre sportive.
Avec Very Nervous System (ou VNS) créé en 1986, D. Rokeby, lui aussi, s’intéresse aux échanges mais cette fois en explorant la programmation informatique. Il s’agit ici d’un dispositif qui comprend une série de capteurs et un programme de traitement des données recueillies sur la base d’une modélisation. Quiconque se déplaçant à proximité de VNS voit ses mouvements être à l’origine de séquences sonores. Des séquences dont l’intensité, la variation, le timbre dépendent littéralement des déplacements. Elles supposent toute une série d’opérations : la saisie des mouvements par des capteurs, la transformation de ces déplacements physiques en données aptes à être traitées par un programme informatique, enfin la représentation de ces données sous une forme sensible, selon la modélisation. Le virtuel est donc la pièce maîtresse de l’œuvre à la fois pour la saisie des déplacements physiques et pour leur traduction en séquences sonores. D. Rokeby exploite ainsi les spécificités de l’informatique, saisir les mouvements physiques et construire des modèles, pour travailler in fine sur la relation entre monde virtuel et monde concret. Ce sont les rapports entre corps et programme qui se trouvent ici explorés et que les séquences sonores rendent sensibles, c’est-à-dire accessibles ou perceptibles. Des séquences qui montrent la nature relationnelle du virtuel via ce travail de mise en forme des échanges qui supposent opérations et calculs invisibles. Avec VNS, l’artiste canadien lie le système d’échanges virtuels à ses résultats et dévoile en conséquence la nature du rapport entre le virtuel et le concret, un rapport conditionnel quand l’invisible (les échanges virtuels) est condition de l’audible (les séquences sonores).
Les échanges virtuels sont ainsi conditions des images, des sons, des textes visibles sur les écrans des computers. Sans eux, aucune apparition et disparition sur les écrans ne sont possibles sous une forme ou sous une autre. C’est notamment ce qu’invite à comprendre Shredder conçu en 1998 par M. Napier qui joue ici avec la programmation. Avec cette pièce, un changement infinitésimal opéré sur le code de programmation conduit à décomposer n’importe quelle « page » de la version électronique d’un journal accessible sur internet, celle-ci devenant alors illisible. Si Shredder montre la « fragilité » de la programmation, elle dévoile également combien les échanges virtuels, invisibles par définition, sont conditions du visible et in fine du sensible. Une telle pièce, comme les précédentes, ne conduit-elle pas alors à apprécier autrement le rapport du virtuel à la réalité concrète ? Autrement, c’est-à-dire sans les opposer mais plutôt en envisageant leur nécessaire lien, le virtuel conditionnant le sensible, ou le perceptible. L’un comme l’autre in fine se complétant ou se mélangeant. Telle est entre autres choses ce que les artistes expriment, pensent ou théorisent.
Virtuel et philosophies
Si la nature « relationnelle » du virtuel reste le plus souvent voilée, excepté dans les pratiques artistes qui l’explorent, si le virtuel cybernétique est également ignoré, sauf par les artistes, en contrepoint la philosophie joue sa partition dans les analyses qui tentent de le circonscrire — et d’autant plus qu’il devient quasi omniprésent à travers la multiplicité de ses usages et de ses pratiques. La philosophie apporte-t-elle alors et en quelque sorte sa caution, offre-t-elle un gage de sérieux, ou propose-t-elle des outils conceptuels pour le penser ? Qu’en est-il vraiment ? Le virtuel des philosophes est-il de la même nature que le virtuel cybernétique ? L’un et l’autre ont-ils le même rapport au possible, à l’actuel et au réel, par exemple ? Sont-ils ou non entièrement déterminés ? Et surtout dans quel contexte émerge le virtuel, où le situer dans les systèmes philosophiques, que cherche-t-on à comprendre, qu’exprime-t-on à l’aide de cette notion ?
La différence radicale entre puissance et possible
Tout se passe comme si l’accroche philosophique quasi « inflationniste » répondait à l’insuffisance des approches techniques du virtuel. On rapporte ainsi le virtuel à ses synonymes, à ce qui est déjà connu ou encore à ce qui a été débattu par les philosophes, c’est-à-dire au possible, à l’inactuel, à la puissance pour penser ensuite, notamment et éventuellement, son rapport à la réalité concrète. Dans ce cas, et fréquemment, le virtuel est situé à l’origine de cette dernière pour en être en quelque sorte l’embryon ou le germe. Aristote d’abord compte parmi les philosophes mobilisés11 pour argumenter en faveur de la thèse selon laquelle virtuel et puissance sont tout un, bien que jamais il ne prononce le terme virtuel12. Le philosophe grec en effet s’est intéressé, dans le cadre d’abord de sa Physique, à l’acte et à la puissance pour penser, par exemple, l’articulation entre matière et forme puis, dans Métaphysique, à la puissance, à l’impuissance, au possible et à l’impossible ainsi qu’à leur rapport respectif13. Une métaphysique qui se rapporte à la science des causes premières et dans laquelle le philosophe interroge et cherche leur spécificité. Une telle science des causes n’ignorant d’ailleurs pas la science des applications. Science première, ou philosophie première, dans laquelle Aristote énonce les causes, les principes et les éléments des substances14 et dans laquelle sont repris pour partie les éléments principaux et essentiels qu’il a développés ailleurs, et en particulier, la théorie des quatre causes.
Dans une telle perspective de la recherche des causes premières, dans laquelle Aristote questionne ce qui est cause de l’être mathématique, de l’être physique et de l’être divin, la puissance et son rapport à l’acte, autrement dit encore le couple puissance/acte vient incontestablement au premier plan. Selon lui, quatre causes des êtres, ou de ce qui est, sont discernables : cause matérielle, cause motrice, cause formelle et cause finale. La puissance se rapporte, notamment, à la cause motrice pour rendre compte du mouvement de toute chose, c’est-à-dire de son point de départ ou de son origine. Ainsi, le bronze ou le bois ne sont-ils pas responsables de leur propre changement ? Ni le bronze ni le bois ne font respectivement la statue ou le lit15. Aussi, faut-il trouver l’origine de cette transformation, une cause nécessairement extérieure ou qui suppose une intervention extérieure au matériau lui-même. La puissance concerne également tout aussi bien la cause matérielle que la cause formelle quoique dans un sens différent pour saisir la transformation de toute chose. La matière par sa capacité ou sa puissance à subir ou à ne pas subir un changement : le bois est ainsi un lit ou un arbre en puissance. Quant à la forme, elle peut être ou ne pas être informée de la matière. De sorte que si la matière subit un changement, la forme, elle, est soit présente, soit absente. Enfin, la puissance concerne l’accomplissement ou le mouvement vers ce qu’il convient.
Si jusque-là penser l’analogie entre virtuel et puissance est plausible, parce que le virtuel a le statut d’une cause et parce qu’il précède toute chose, comme la puissance, l’analogie devient plus incertaine ensuite. En effet, Aristote distingue également toujours ce qui est en puissance et ce qui est en acte relativement aux quatre espèces de causes. En d’autres termes, il différencie cause en puissance et cause en acte. Ainsi, du constructeur, cause en puissance de la construction et du constructeur construisant comme cause en acte de la construction.
Il précise enfin les différences entre puissance et impuissance, puissance et possible, enfin impuissance et impossible. L’impuissance d’abord qui est une privation de puissance (l’impuissance à engendrer un enfant d’un homme) ou la suppression d’un principe (l’impuissance à engendrer un enfant d’un eunuque). L’impuissance peut aussi être dite en rapport avec le possible et l’impossible. L’impossible étant « ce dont le contraire est nécessairement vrai »16. Que la terre, par exemple, ne soit pas ronde est impossible, car son contraire — être ronde — est nécessairement vrai. Quant au faux, lui, il n’est pas identique à l’impossible. Si je suis assise, il est faux de dire que je marche, mais marcher ne m’est pas impossible.
Quant au possible, il signifie « ce qui n’est pas nécessairement faux […] ce qui est vrai […] ce qui peut être vrai »17, mais ces possibles ne se confondent pas avec la puissance qui reste « un principe susceptible de produire un changement dans autre chose ou
Enfin, un possible qui ne se réalise pas n’est pas un impossible. Des choses, on les dit possibles ou impossibles, selon qu’elles sont d’une certaine forme ou ne sont pas et non pas, selon un principe de changement19. L’apparente opposition du possible avec l’impossible reste ainsi trompeuse. Bref, malgré les apparentes similitudes, possible et impossible ne sont donc pas équivalents respectivement à la puissance ou à l’impuissance.
Si la théorie aristotélicienne s’impose presque « naturellement », c’est parce que le plus souvent, le virtuel en jeu dans les pratiques des objets de communication est associé au possible, au potentiel, ou à la puissance. Qu’un « événement » surgisse – sur les écrans des ordinateurs et on en déduit alors que sa possibilité s’est concrétisée, à la façon de ce qui peut ou ne peut pas se réaliser dans le monde concret. Dans une telle perspective, le virtuel est tenu pour une cause première et également pour l’équivalent d’un germe à l’origine de la réalité concrète qu’il contient en puissance. L’un, le virtuel, et l’autre, la réalité concrète, dépendent ainsi du hasard et restent soumis en conséquence à un « il est possible que ». Pour filer la métaphore, nous serions face au virtuel, comme des jardiniers face à leur potager, un virtuel qui se plierait sans cesse aux aléas, aux caprices météorologiques, au probable et au possible, bref un virtuel incertain.
Avec ce mode d’existence commun ou partagé, ils apparaissent ainsi comme « incomplets », c’est-à-dire in fine comme possédant le même degré d’indétermination, ou encore comme non nécessaires, voire comme accidentels. Du point de vue logique, un tel raisonnement frise l’absurde. Comment en effet tenir pour indéterminé l’acte une fois réalisé ? Comment encore reconnaître comme incomplet ce dernier et selon quels principes ? Quant au contraire de la nécessité, comment peut-il se rapporter indifféremment à l’un et à l’autre ? Ne faut-il pas interroger les prémisses d’une telle démonstration pour mettre en cause le possible commun à ces deux mondes, réel et virtuel, qui les régit ? Ne faut-il pas enfin distinguer puissance et possible si l’on se réclame de la philosophie d’Aristote ?
Une puissance postérieure à l’acte
Mais Aristote n’arrête pas là son raisonnement à propos de la puissance. Car il distingue encore entre plusieurs points de vue. Si « la puissance se dit du principe de mouvement ou de changement qui est dans autre chose ou <dans la même> en tant qu’autre 20 », mouvement, changement ou puissance ne concernent que les choses. Et ce principe du mouvement « soit […] reste à l’état de simple puissance, soit […] se montre en une complète réalité 21 ». Du point de vue de la génération, le mouvement est par définition incomplet puisque l’acte n’est pas encore réalisé. La puissance ou le mouvement incomplets ne se confondent donc pas avec l’acte. Et si des actes supposent toujours le mouvement, d’autres ne le supposent pas. Quoi qu’il en soit, le mouvement et la puissance sont ici antérieurs à l’acte.
En revanche, du point de vue de l’énoncé ou de la connaissance, l’acte devient antérieur à la puissance. Car « ce qui a la puissance au sens premier [s’attache exclusivement à la] possibilité de passer à l’acte. Par exemple j’appelle capable de bâtir ce qui a la puissance de bâtir, capable de voir ce qui a la puissance de voir […] l’énoncé et la connaissance de l’acte précèdent la connaissance de la puissance. 22 » Aussi, la puissance reste-t-elle subordonnée à l’acte puisque l’acte doit être réalisé pour que celle-ci soit identifiée ou connue comme telle.
Aristote précise encore que l’acte est antérieur à la puissance et à tout principe de mouvement ou de repos par la substance et, dans un certain sens, par le temps. Il ne l’est donc pas uniquement du point de vue de l’énoncé. Un acte antérieur à la puissance par la substance, comme l’homme qui est antérieur à l’enfant ou l’être humain à la semence, parce que l’homme possède la forme, et l’autre non. Un acte antérieur à la puissance parce qu’il est un accomplissement, la puissance étant conçue en vue de cet accomplissement. La puissance vient donc a posteriori de l’acte. Enfin, antériorité de l’acte également vis-à-vis de la puissance par le temps, parce qu’on ne peut pas être un bâtisseur en puissance si l’on n’a pas déjà bâti, ni être musicien en puissance sans avoir déjà joué d’un instrument. Par conséquent, la puissance suppose préalablement l’acte23.
Dès lors, la définition de la puissance par Aristote, une puissance postérieure à l’acte, et une puissance qui ne se confond pas avec le possible, contrarie-t-elle la thèse, selon laquelle, le virtuel est nécessairement antérieur au réel, celui-ci prolongeant celui-là ; de même l’idée, selon laquelle, le virtuel semblable à un germe ou à un embryon est cause des choses de la nature ou des organismes vivants ; enfin celle qui veut que le virtuel soit une réalité possible ou en suspension. Suivre Aristote présente ainsi quelques risques pour cerner le virtuel cybernétique qui reste complètement adossé à la logique mathématique.
Le virtuel deleuzien : une réalité non actuelle entièrement déterminée
D’autres philosophes sont mis à contribution pour défendre la thèse selon laquelle virtuel et réel sont de même nature, le premier étant nécessairement à l’origine du second et pour décrire le virtuel comme offrant de multiples possibles en attente d’actualisations. Parmi eux, G. Deleuze parce qu’il soutient que « le virtuel ne s’oppose pas au réel, mais seulement à l’actuel 24 ». On conçoit alors que la tentation soit vive et s’impose presque d’emblée d’identifier le virtuel deleuzien au virtuel technologique, lequel s’actualise au gré des activations de chaque programme dont les possibilités sont quasi infinies.
Toutefois, Deleuze ajoute que « loin d’être indéterminé, le virtuel est complètement déterminé » (1968, 270). Une telle précision, néanmoins omise par ceux qui analysent le virtuel technologique,25 conduit ensuite Deleuze à différencier le virtuel du possible. Bien qu’il soit tentant de les confondre, souligne-t-il, tout pourtant les éloigne26. D’abord parce que le possible s’oppose au réel, ensuite parce que le possible suppose « une forme d’identité dans le concept » (Deleuze 1968, 273) alors que le virtuel l’exclut, enfin parce que le possible est conçu comme l’image du réel, en quelque sorte un produit fabriqué après coup ou rétroactivement, à l’inverse de l’actualisation du virtuel qui « se fait toujours par différence, divergence ou différenciation » (Deleuze 1968, 273).
Après avoir souligné l’opposition du virtuel à l’actuel, G. Deleuze écrit que « le virtuel possède une pleine réalité, en tant que virtuel. […] La réalité du virtuel consiste dans les éléments et rapports différentiels, et dans les points singuliers qui leur correspondent. La structure est la réalité du virtuel. Aux éléments et aux rapports qui forment une structure, nous devons éviter à la fois de donner une actualité qu’ils n’ont pas, et de retirer la réalité qu’ils ont. Loin d’être indéterminé, le virtuel est complètement déterminé » (1968, pp. 269-270).
Dès lors, se réclamer de Deleuze pour penser le virtuel technologique et pour plaider en faveur de sa pleine réalité tout en considérant qu’il fonctionne au possible reste une démarche hasardeuse et quelque peu expéditive, voire sauvage. Dire d’abord que le virtuel possède une pleine réalité ne signifie pas que cette réalité soit de la même facture que la réalité du réel physique, concret. Ensuite, dès lors que le virtuel est déterminé, il ne peut pas signifier un « en puissance » ou « un possible » puisque le possible par définition est indéterminé. Enfin, parce que n’est jamais mentionnée la perspective de Deleuze qui discute du virtuel pour s’intéresser aux Idées, à leur détermination, à la pensée de la différence et à celle de la répétition ou de l’identique et non pas au virtuel technologique.
N’est-il pas nécessaire en effet pour éviter tout contresens de revenir au contexte dans lequel s’inscrivent ses propos sur le virtuel. Avec Différence et répétition, G. Deleuze discute des théories philosophiques de la différence, toujours dans la perspective d’échapper à la pensée binaire, une image triste de la pensée. Penser la différence pour elle-même, et notamment sans l’opposer ou la subordonner à l’identique, tel est le motif de Différence et Répétition. En conséquence, Deleuze formule une théorie du/des problème(s) selon laquelle les solutions aux problèmes dépendent de leur formulation ou de celles de la question à résoudre. Ainsi au chapitre IV, note-t-il, que l’Idée « est une multiplicité, une variété » (Deleuze 1968, 236) qui suppose trois moments : l’un où elle est indéterminée, l’autre, déterminable, le dernier enfin où elle renvoie à l’idéal d’une détermination (Deleuze 1968, 220). En d’autres termes, à l’indéterminé correspond un principe de déterminabilité, au réellement déterminable correspond celui de détermination réciproque, enfin à l’effectivement déterminé celui de détermination complète (Deleuze 1968, 222), écrit-il, en s’adossant à la théorie mathématique du calcul différentiel27, pour circonscrire la différence et la pensée de la différence. La théorie des problèmes (Deleuze 1968, 233) s’inscrivant dans le prolongement de cette théorie mathématique, lesquels problèmes sont résolubles non parce qu’ils sont vrais, mais parce qu’ils incluent les conditions de leur résolution. Autrement dit, la résolubilité d’un problème dépend de la forme de ce dernier. En somme, c’est dire que tout énoncé contient le germe de sa solution (Deleuze 1968, 233), souligne-t-il, à partir de la méthode élaborée par le mathématicien Abel, selon lequel, plutôt que chercher au hasard si une équation est résoluble en général, il vaut mieux « déterminer des conditions de problèmes qui spécifient progressivement des champs de résolubilité ».
Si, et Deleuze le souligne, l’Idée est une multiplicité, elle ne se confond pas non plus avec l’Essence (1968, 242). Elle est plutôt une structure ou un thème complexe, « une multiplicité interne, c’est-à-dire un système de liaison multiple non localisable entre éléments différentiels, qui s’incarne dans des relations réelles et des termes actuels » (Deleuze 1968, 237). On comprend que de tels propos sèment le trouble chez les lecteurs et les conduisent à associer aux Idées, en tant que système de liaison multiple, le virtuel ou la modélisation informatique ou encore le réseau internet. Néanmoins, la multiplicité — qui définit l’Idée — ne désigne pas « une combinaison de multiple et d’un, mais une organisation propre au multiple en tant que tel, qui n’a nullement besoin de l’unité pour former un système. » (Deleuze 1968, 236). Il y a ainsi des « différences de multiplicités, et [une] différence dans la multiplicité [qui] remplacent les oppositions schématiques et grossières » (Deleuze 1968, 236). Une telle précision écarte toute confusion possible entre Idée et virtuel technologique. Il s’agit ici pour Deleuze d’interroger les conditions de la différence afin d’éviter de la prendre pour ce qu’elle n’est pas, une ressemblance et, inversement, afin de ne pas la subordonner à l’identique. Ainsi, est-ce dans ce contexte que Deleuze mentionne que « la virtualité de l’Idée n’a rien à voir avec une possibilité » (Deleuze 1968, 247). Il précise que le virtuel est le caractère de l’Idée (Deleuze 1968, 273) et, un peu plus loin, que « l’Idée est réelle sans être actuelle, différentiée sans être différenciée, complète sans être entière », bref, elle est à la fois distincte et obscure (Deleuze 1968, 276). On voit bien là l’inintérêt de Deleuze pour le virtuel cybernétique préférant articuler le virtuel à la linguistique, à la mathématique via les intégrales, ou encore au vivant.
Deleuze note enfin à propos de la structure qui caractérise l’Idée que « sa genèse ne va pas d’un terme actuel, si petit soit-il, à un autre terme actuel dans le temps, mais du virtuel à son actualisation, c’est-à-dire de la structure à son incarnation, des conditions de problèmes aux cas de solution, des éléments différentiels et de leurs liaisons idéales aux termes actuels et aux relations réelles diverses qui constituent à chaque moment l’actualité du temps. » (1968, 238).
Comprendre comment Deleuze pense le virtuel dépend en effet également de sa réflexion sur le temps. Les plus fins connaisseurs de la philosophie deleuzienne insistent sur ce point. Deleuze identifie en effet deux types de temps — chacun ayant sa propre réalité —, toujours dans la perspective d’échapper au dualisme, à une pensée linéaire du temps ou encore à une certaine idée de la causalité entre passé, présent, futur. Des inflexions qui changent malgré tout quelque peu la compréhension du virtuel et notamment de son rapport à l’actuel et qui éloignent davantage encore du virtuel cybernétique. Une pensée du temps qui fait la part belle au milieu, au pli ou encore aux mélanges et qui résonne avec le rhizome ou sa pensée du milieu… Si le virtuel n’est pas actuel, s’il n’est pas donné ni donnable, il est néanmoins réel. Le réel étant constitué d’une part actuelle et d’une part virtuelle, comme l’écrit F. Zourabichvili (2004, pp. 89-90), mais sans que le virtuel précède l’actuel ou le réel, il se situe plutôt à côté, comme inséparable de l’actuel, tel un incorporel. Enfin et selon, A. Sauvagnargues, le couple actuel/virtuel est la pièce maîtresse de l’ontologie deleuzienne et se substitue aux couples sensible/intelligible, existence/essence, réel/possible (2003, 22). Ainsi, note-t-elle, tandis que « l’actuel désigne « le présent », « l’état des choses », la réalité en tant qu’elle est actuellement donnée, le virtuel [renvoie, lui, à] tout ce qui n’est pas actuellement présent » (2003, 22). Rien de plus étranger au virtuel que l’actuel. Le virtuel en effet n’a jamais été actuel parce que le statut du passé est de ne jamais avoir été présent. Enfin, insiste-t-elle, le virtuel comme passé pur introduit ainsi un axe temporel après l’axe ontologique (Sauvagnargues 2003, 22). Bref, le virtuel s’inscrit dans un édifice complexe. Et, s’il est loin d’être univoque, il suit, comme tous les concepts deleuziens, une ligne de variation.
Après ces détours par la philosophie deleuzienne, le virtuel deleuzien s’écarte bel et bien du virtuel comme matrice logico-mathématique. Si avec Deleuze, le virtuel, dans toute sa multiplicité ou dans toutes ses dimensions, se définit au contact de la mathématique et pas seulement de la philosophie, il n’est jamais mis à l’épreuve de la cybernétique28.
Le virtuel cybernétique : l’invisible comme condition du visible
Confronter le virtuel à la cybernétique, telle est la voie suivie par la philosophe A. Cauquelin. Il s’agit alors de penser le rapport du virtuel à la réalité physique, ou de l’immatériel au matériel, c’est-à-dire d’évaluer la part de l’invisible et de l’immatériel dans le monde d’aujourd’hui, et leur rapport au visible et au matériel (2006, 16 et p. 10). Mais cerner in fine la nature de ce lien, lien qu’elle considère comme le concept clef dans la société actuelle, suppose de disposer d’outils conceptuels opératoires. Concepts opératoires qu’elle emprunte à la théorie des incorporels des stoïciens, pour les réactualiser afin de saisir l’articulation ou le passage entre visible et invisible auxquels confrontent le cyberespace, l’internet et, plus généralement, toutes les applications numériques ou multimédias que recouvre le virtuel.
Pour les stoïciens, en effet, l’univers n’est pas le tout. S’il est constitué du monde des corps, le tout se compose, lui, et de l’univers et du monde des incorporels qui l’enveloppe. Des incorporels au nombre de quatre — le vide, le lieu, le temps et l’exprimable — qui sont liés et qui sont respectivement condition, dans un jeu avec le vide, du lieu, du temps et de l’exprimé qui se rapportent, eux, au monde des corps. Que le lieu, le temps ou l’exprimé se retirent et le vide refait surface mais sans rien leur retrancher parce que les incorporels sont indifférents aux corps. Si les incorporels se distinguent des corps, s’ils en sont exclus ou s’ils n’affectent pas les corps, c’est parce qu’ils sont davantage des manières d’être ou des résultats des actions des êtres ou encore des faits situés à la surface de l’être. En conséquence, incorporels et corps ne s’opposent pas, les premiers conditionnant les seconds. C’est dire combien les incorporels sont nécessaires aux corps. Autre particularité, si le monde des corps est fini, le monde des incorporels, lui, est infini. Telle est ainsi la conception particulière du monde que les stoïciens développent, notamment, dans leur théorie physique.
Partant de ce cadre d’analyse, A. Cauquelin confronte les incorporels à l’art contemporain et, notamment, à l’art numérique, ou l’art du virtuel — et à la cyberculture. S’ils deviennent davantage compréhensibles face au cyberespace ou au virtuel, inversement, les incorporels sont des outils conceptuels opératoires pour comprendre le virtuel, son fonctionnement, sa relation à la réalité sensible et concrète, et pour en mieux cerner les traits. Le vide, par exemple, n’est-il pas sa « nature » propre quand le clic d’une souris suffit à faire apparaître et disparaître textes, sons, images ? Apparitions et disparitions se succèdent dans l’instant sans que rien ne leur soit retranché ou ajouté. Un tel mouvement incessant entre apparition et disparition ne montre-t-il pas dès lors que le vide est constitutif du cyberespace ou du virtuel ? Un vide nécessaire, ou conditionnel, parce sans lui, ces allers et retours répétés et infinis seraient compromis.
Le temps réel qui autorise l’instantanéité des apparitions/disparitions, ce temps propre de l’ordinateur ne suppose-t-il pas un temps vide nécessaire à ces mouvements ? Ce temps apte à être comblé n’appelle-t-il pas un temps vide ? À chaque consultation, ce cybertemps coïncide alors avec le temps présent vécu de l’internaute. Pourtant une telle simultanéité ne signifie pas correspondance entre ces deux types de temps. Le temps réel, ou le temps logique de la machine, exclut en effet la durée, la temporalité ou le temps fléché. C’est un temps qui ne vise rien seulement l’accomplissement simultané, souligne-t-elle, soit encore un temps découpé dans le temps infini de l’ordinateur. Ce temps infini, ce temps intemporel ou incorporel, étant alors condition du temps fini, l’interface reliant ces deux types de temps : le temps micro de l’ordinateur avec le temps présent ou vécu à l’échelle locale.
Quant à ce que les cybernautes appellent site, son instabilité et son impermanence ne conduisent-elles pas à apprécier le cyberespace comme un lieu sans spatialité, soit comme un lieu incorporel ? Ne s’agit-il pas avec le cyberespace d’un dispositif qui tout entier est une enveloppe occasionnelle (Cauquelin 2006, 106) permettant au lieu d’advenir en temps réel ou pour un temps donné ? L’interface étant le lien entre lieu incorporel et lieu ou le moment de bascule de l’un à l’autre.
Enfin, l’exprimable, semblable à un fond d’où se détacheraient des figures, ce vide exprimable permet cette fois au sens de s’installer et de s’exprimer sans qu’il en oriente les significations. Tel apparaît-il dans nos pratiques d’internet, au gré de nos navigations, un vide conditionnel, donc, de l’apparition/disparition des significations. Le cyberespace est alors un espace pour les significations et non pas un espace de la signification, écrit-elle, de la même façon que, selon la théorie logique des stoïciens, l’exprimable n’est pas le langage mais la condition de son apparition. Un monde virtuel, ou cyberespace, qui est ainsi, en d’autres termes, indifférent à l’exprimé. Il en est seulement la condition, c’est-à-dire encore que le programme conditionne l’apparition de ce qui est exprimé sous la forme d’images, de sons, de textes. Ainsi, des mots peuvent-ils apparaître sur les écrans sans aucune signification ou dépourvus de sens, une preuve de l’indifférence du programme à toute signification. Certaines pratiques artistes, comme celle de M. Napier, dévoilent d’ailleurs cette indifférence lorsqu’ils explorent le virtuel29. Dès lors, le virtuel apparaît comme un vide qui autorise apparitions comme disparitions, du temps, du lieu, des significations, sur les écrans. Plus encore, le virtuel est ce qui permet le passage vers le visible.
Ainsi, A. Cauquelin invite-t-elle via les incorporels à une mise à nu du cyberespace et du virtuel, pour mettre l’accent sur les échanges ou sur le mode d’échanges qui le caractérisent. Des échanges virtuels qui, bien qu’invisibles, sont des conditions du visible. Ce sont donc les échanges qui sont virtuels et dont sont issus tout ce qui apparaît comme tout ce qui disparaît sur les écrans des ordinateurs. Ainsi, images animées ou fixes, sons, textes ne sont-ils pas virtuels mais sortent temporairement les échanges de leur invisibilité… Et ce sont des artistes — comme j’ai tenté de le montrer dans la première partie — qui conceptualisent le virtuel dans leurs dispositifs…
En guise de conclusion provisoire, suivre certains philosophes reste une voie hasardeuse et risquée pour qui veut cerner et saisir le virtuel au cœur de nombre de nos pratiques cybernétiques. Un virtuel qui ne se situe pas dans le prolongement de la réalité concrète pas plus qu’il ne s’y oppose. Il se caractérise plutôt par son indifférence à cette dernière. Un rapport conditionnel lie enfin le premier à la seconde. Un virtuel qui ne se rapporte pas davantage à un possible envisagé alors comme une puissance à être, quand d’abord possible et puissance ne sont pas synonymes et quand ensuite la puissance aristotélicienne est postérieure à l’acte. Enfin, si pour Deleuze, le virtuel, comme la réalité, est entièrement déterminé, on ne peut pas l’envisager comme une infinité de possibles ni le définir comme une réalité en devenir… Bref, ces détours par la philosophie conduisent in fine à considérer que, davantage qu’une notion-valise, le virtuel — en oscillant entre philosophie, mathématique, physique — est un nœud théorique qui invite à poursuivre sa généalogie.
Bibliographie
Aristote, Marie-Paule Duminil, et Annick Jaulin. 2008. Métaphysique. Paris: Flammarion.
Boissier, Jean-Louis. 2008. La relation comme forme: l’interactivité en art. Genève; Dijon: Mamco ; Les presses du réel.
Breton, Philippe, et Serge Proulx. 2006. L’explosion de la communication: introduction aux théories et aux pratiques de la communication. Paris: La Découverte.
Cardon, Dominique. 2013. « Dans l’esprit du PageRank, Inside the mind of PageRank ». Réseaux, nᵒ 177 (mai):63‑95. https://doi.org/10.3917/res.177.0063.
Cauquelin, Anne. 2006. Fréquenter les incorporels : contribution à une théorie de l’art contemporain. Paris: Presses Universitaires de France.
Colonna, Jean-François. 1993. « Expériences virtuelles et virtualités expérimentales ». Réseaux 11 (61):79‑96. https://doi.org/10.3406/reso.1993.2404.
Daigneault, Jacques. 2006. « Le virtuel est-il un souci? » In Communautés virtuelles: penser et agir en réseau, 77‑91. Québec: Presses de l’Université Laval. http://books.google.com/books?id=eHG5AAAAIAAJ.
Deleuze, Gilles. 1968. Différence et répétition. Paris: Presses universitaires de France.
Lévy, Pierre. 2001. Qu’est-ce que le virtuel? Paris: Ed. La Découverte.
Proulx, Serge, et Guillaume Latzko-Toth. 2000. « La virtualité comme catégorie pour penser le social : L’usage de la notion de communauté virtuelle ». Sociologie et sociétés 32 (2):99‑122. https://doi.org/10.7202/001598ar.
Proulx, Serge, et Guillaume Latzko-Toth. 2006. « Le virtuel au pluriel : cartographie d’une notion ambiguë ». In Communautés virtuelles : penser et agir en réseau, 57‑77. Québec: Presses de l’Université Laval. http://books.google.com/books?id=eHG5AAAAIAAJ.
Rodionoff, Anolga. 2010. « Interroger le virtuel: architecture, territoires, création numérique ». Thèse de doctorat, Lieu de publication inconnu: Université de Paris VIII.
Rodionoff, Anolga. 2014. « Le virtuel : une notion-valise ». In Les territoires du virtuel mondes de synthèse (MMORPG), univers virtuels (Second life), serious games, sites de rencontre ..., 189‑202. Revue MEI 37. Paris: Editions L’Harmattan. http://www.harmatheque.com/ebook/9782343023748.
Rouvroy, Antoinette, et Thomas Berns. 2013. « Gouvernementalité algorithmique et perspectives d’émancipation, Faced with algorithmic governmentality ». Réseaux, nᵒ 177 (mai):163‑96. https://doi.org/10.3917/res.177.0163.
Sadin, Éric. 2015. La vie algorithmique : critique de la raison numérique. Paris: Éditions l’Échappée.
Sauvagnargues, Anne. 2003. « Actuel/Virtuel ». In Le vocabulaire de Gilles Deleuze. Les Cahiers de Noesis 3. Nice: Vrin.
Serres, Michel. 2012. « Discours sur la Vertu ». Académie Française. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0PjcbMmy-ioJ:medias.lemonde.fr/mmpub/edt/doc/20121206/1801085_3adb_af-discours-serres.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=ca.
Vitali-Rosati, Marcello. 2012. S’orienter dans le virtuel. Paris: Hermann.
Zourabichvili, Francois. 2004. Le vocabulaire de Deleuze. Le vocabulaire de. Paris: Ellipses.
Voir Anolga Rodionoff (2010, 2014), et Marcello Vitali-Rosati (2012). M. Vitali-Rosati s’est intéressé également aux diverses significations du virtuel, repérant son usage en philosophie, en physique et s’interrogeant sur sa signification lorsqu’il se rapporte aux technologies de l’information et de la communication.↩
Il s’agit de Discours sur la Vertu, jeudi 6 décembre 2012, Académie française, M. Serres, directeur de séance. 9 pages. M. Serres choisit la fable sous la forme d’un dialogue entre un Grand-Papa Ronchon, authentique représentant du monde ancien, celui du XXe siècle, et Petite Poucette, jeune fille de son temps, adepte de Facebook et des jeux électroniques notamment, pour conduire sa réflexion à propos du virtuel (2012).↩
M. Serres en effet en définissant le virtuel comme une puissance, l’identifie à une faculté, car « faculté signifie puissance de faire » ; faculté qui jadis, poursuit-il, se rapportait à l’imagination. La littérature dès lors, en tant que « récit indéfini des possibles », est semblable au virtuel (Serres 2012, 6).↩
Ainsi, Petite Poucette situe-t-elle Facebook dans le sillage des « romans, ces antiques techniques de la virtualité » (Serres 2012, 4).↩
M. Serres écrit ainsi que si l’Académie française et l’Académie des sciences sont fraternelles dans le virtuel, les académiciens de l’Académie des sciences « trient sans cesse [dans ces virtuels] l’impossible qui ne peut pas être, pour découvrir le nécessaire qui ne peut pas ne pas être, toujours étonnés […] devant l’évidence présence de la réalité contingente […] qui pourrait ne pas être. » (2012, 9). Il souligne ainsi ce qui différencie le virtuel cybernétique, la nécessité, du virtuel envisagé comme possibilité dans la vie quotidienne comme dans le domaine de la fiction.↩
Ainsi, écrit-il, « Virtuel et réel associés pour comprendre et connaître, voilà les trois couples vertueux des œuvres de l’esprit. » (Serres 2012, 9).↩
RV c’est-à-dire réalité virtuelle↩
Cependant quelques chercheurs se sont intéressés à l’algorithme, mais selon une perspective sociologique et politique, en particulier D. Cardon (dans le cadre d’une ANR « Politique des algorithmes » [ALGO-POL – NR 2012 CORD 01804], (2013, pp. 63-95) ; ou encore A. Rouvroy et T. Berns qui, eux, y ajoutent la dimension juridique (2013, pp. 163-196) ; dans un ouvrage récent, Éric Sadin s’y intéresse également à travers l’observation de multiples situations quotidiennes, pour s’inquiéter des conséquences démocratiques liées à l’essor de l’industrie des données (2015).↩
On doit à Jean-Louis Boissier le concept de relation comme forme (2008).↩
Clavecin bien tempéré transocéanique a été conçue et réalisée par Nam June Paik en 1963. Il s’agit de jouer, en commençant exactement à minuit le 3 mars (heure de Greenwitch), la Fugue N° 1 (en C major) du Clavecin bien tempéré de J. - S. Bach –- mais en jouant la partie pour la main gauche à San Francisco, et la partie pour la main droite à Shanghai ; les deux parties sont ensuite diffusées sur les ondes hertziennes, la pièce musicale étant alors complète.↩
Dans son chapitre « Virtuel et philosophie », M. Vitali-Rosati insiste sur les différents sens du terme grec dunaton, dont l’un signifie possible. Il indique ensuite que le virtuel est la traduction latine virtualis du terme grec dunaton. Sur les différentes significations de dunaton, (2012, pp. 21-29).↩
(Aristote, Duminil, et Jaulin 2008, Livre H, « Résultats de l’enquête sur la substance », 1, [1042a 3] 5)↩
(Aristote, Duminil, et Jaulin 2008, Livre Δ, « Puissance, impuissance, possible, impossible », 12, [1019b], 20-25). ↩
(Aristote, Duminil, et Jaulin 2008, Livre Δ, 12, [1019b], 30-35).↩
(Aristote, Duminil, et Jaulin 2008, Livre Θ, 1, [1046a], 5).↩
(Aristote, Duminil, et Jaulin 2008, Livre Δ, 12, [1019a], 15).↩
(Aristote, Duminil, et Jaulin 2008, Livre Θ, 8, [1049b], 15-20).↩
(Aristote, Duminil, et Jaulin 2008,Livre Θ, 8, [1049a]— [1050b]).↩
(Deleuze 1968, 269). Une telle citation est reprise à l’envi dans la littérature consacrée à l’élucidation du virtuel, par exemple, par P. LEVY (2001) ou par J. DAIGNAULT, dans un chapitre « Le virtuel est-il un souci ? » (Daigneault 2006).↩
Parmi lesquels, notamment : Pierre Lévy (2001) ; Serge Proulx et Latzko-Toth (2006 pp. 57-76) et (2000, 99‑122) ; Philippe Breton et Proulx (2006). Si S. Prouxl analyse le virtuel non sans une certaine charge critique, il reprend néanmoins l’idée, « fortement deleuzienne » écrit-il, d’une « hybridation du réel et du virtuel […] de leur interaction perpétuelle [de laquelle] jaillit un réel en constante “création et expérimentation” », (2000, 104) ; (2006, pp. 77-89 ) ; (Vitali-Rosati 2012).↩
G. Deleuze insiste en effet sur « le danger […] de confondre le virtuel avec le possible. Car le possible s’oppose au réel ; le processus du possible est donc une “réalisation”. Le virtuel, au contraire, ne s’oppose pas au réel ; il possède une pleine réalité par lui-même. Son processus est l’actualisation. » (Deleuze 1968, pp. 272-276).↩
Deleuze, dans ce passage, s’adosse à la théorie mathématique des différentielles ou calcul différentiel et à son/ses interprétations. Théorie qui ouvre à des questions comme : « les infiniment petits sont-ils réels ou fictifs ? » (1968, 228).↩
C’est d’ailleurs ce qui m’incite à relativiser les multiples citations du chapitre V de Dialogues, par tous ceux qui tentent de cerner le virtuel cybernétique, et ce d’autant plus que ce chapitre a été publié après la disparition de Deleuze.↩
Ainsi de Shredder de l’artiste Mark Napier, (Rodionoff 2010, pp. 305-306).↩