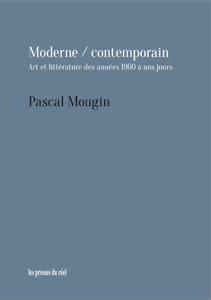Les pratiques « non littéraires » seraient-elles l’avenir de la littérature ?
Au-delà de toute polémique, cette question entend surtout refléter le tournant récent de la théorie littéraire francophone, qui se questionne au contact d’un corpus échappant aux classifications traditionnelles de la littérature. Transgressant les frontières du livre, du texte, voire de la narration, pour expérimenter des formes alternatives (hybrides, intermédiales, transmédiales, hypermédiatiques, numériques, exposées, performatives, etc.), ce corpus témoigne de la présence au sein même des pratiques littéraires d’un paradigme contemporain déjà bien institué et balisé dans le domaine de l’art. Longtemps délaissées par une critique quelque peu déboussolée ou même frileuse à leur égard, ces pratiques peu conventionnelles font aujourd’hui l’objet d’une attention croissante. Elles engagent ainsi un effort théorique qui tend à renouveller les études littéraires, désormais occupées par une double question : qu’est-ce que le « paradigme contemporain » ? Et, surtout, qu’est-ce que la littérature contemporaine ?
L’ouvrage de Pascal Mougin, Moderne/contemporain, publié en 2019 aux Presses du réel, s’inscrit dans cette réflexion aux côtés de travaux déjà menés ces dernières années dans l’espace francophone par Lionel Ruffel (2016), Magali Nachtergael (2018), Gaëlle Théval (2015), Bertrand Gervais (et plus largement l’ensemble de son laboratoire NT2), Gefen et Perez (2019), Alexandra Saemmer (2019), Gilles Bonnet (2017) et d’autres. La contribution de Mougin, qui sans aucun doute fera date, se démarque par son approche comparée du concept de contemporain en art et en littérature. D’une rigueur et d’une érudition remarquables, son étude montre comment les transactions successives qui se sont opérées tout au long du XXe siècle entre les arts et les lettres ont forgé un concept dont il est devenu urgent de se saisir pour repenser la littérature et, à plus forte raison, les études littéraires.
De l’art sans art à l’écriture sans écriture : de quoi le contemporain est-il le non ?
En 2011, dans son anti-manuel de création littéraire Uncreative Writing, Kenneth Goldsmith soutenait déjà que la littérature avait accumulé près d’un siècle de retard sur les pratiques artistiques, en ne s’appropriant que depuis peu les effets de la transition esthétique initiée par l’art moderne puis par l’art contemporain. Cette même hypothèse est au centre de la démarche de Pascal Mougin, dont le premier geste théorique consiste à repartir de l’histoire de l’art, notamment des arts visuels, pour penser le contemporain littéraire. Mais là où Goldsmith se plaît à provoquer, Mougin va plutôt avancer avec prudence, menant une enquête documentée et nuancée sur les relations qui unissent l’art et la littérature depuis le début du XXe siècle, pour en souligner les convergences autant que les limites. Une telle approche ne va en effet pas de soi, tant la comparaison entre les régimes visuels et textuels demeure un champ de mine théorique depuis la Renaissance au moins1. Il n’en reste pas moins que l’art a bel et bien pris une longueur d’avance sur la littérature, instituant un changement paradigmatique majeur dont les principales modalités se manifestent dans une large part de la production littéraire récente, tout en offrant un éclairage inédit sur des œuvres majeures du XXe siècle.
Désesthétisation, défétichisation, déspécification, désessensialisation… Le jargon critique du paradigme contemporain a tendance à se décliner sur une note négative plutôt trompeuse puisqu’il s’agit, en vérité, de libérer les pratiques artistiques des injonctions essentialistes propres à la modernité. Ainsi, parmi les caractéristiques majeures de ce paradigme contemporain, on relèvera d’abord le principe de performativité par lequel le lecteur/spectateur est désormais appelé à devenir le témoin d’une œuvre, impliquant de fait une « tendance à l’allographie de l’œuvre autographique » (2019, 17). La conséquence directe de ce devenir performantiel est la « défétichisation » de l’œuvre – achevant d’achever, si l’on peut dire, la perte de l’aura théorisée par Benjamin il y a un siècle. Dans le domaine de l’art tout particulièrement, ce changement paradigmatique entraînera un important bouleversement institutionnel : la médiation avec les artistes ne passe plus tant par la vente d’un produit culturel (que l’on pourrait posséder ou tout simplement contempler dans un musée) que par une série de performances, de rencontres, de lectures, etc. Les instances légitimantes (institutions muséales, éditeurs, public) ont de fait tendance à conférer à cette forme d’art une dimension événementielle voire communicationnelle. Ainsi l’art ne se pense plus sans le « monde de l’art » (2019, pp. 24-25), si bien que la « concurrence [est] désormais plus sociale qu’esthétique » (2019, 26). Avec, évidemment, la nécessité de repenser le cadre légal qui structurait l’ancien modèle : sur quelle base reconnaître, légitimer ou même rémunérer les artistes ?
Si la théorie du contemporain semble à ce point aimer les préfixes privatifs, c’est parce que son paradigme peut se définir, justement, comme un large processus de dé-définition de l’art comme de la littérature. Avec pour conséquence de reconsidérer les critères d’attribution de l’« artistique » ou du « littéraire », et d’ouvrir à de plus larges corpus. Dans le domaine de la littérature, par exemple, la déspécification se sera d’abord manifestée au niveau générique, sous la forme de ce que Bruno Blanckeman a qualifié il y a quelques années de littérature « indécidable » (Blanckeman 2000). Mais là où l’argument de la déspécification devient particulièrement stimulant, c’est lorsque Mougin plaide pour la reconnaissance d’un tournant médiatique de la littérature (désormais intermédiale, transmédiale, etc.), qui engage à reconsidérer la suprématie du livre. L’ouverture à un corpus hors-le-livre amène à reconnaître un nouveau cadre d’expérience du fait littéraire, et replace le media imprimé comme un moment, un état du texte, parmi de multiples manifestations possibles. La dé-définition contemporaine amorce ainsi un travail salvateur de désessentialisation de la littérature, qui n’est cependant pas totalement assumée par la critique et la théorie, lesquelles doivent encore trouver les moyens de penser ces mutations. Car si Mougin insiste sur la nécessité de penser une littérature « implémentée ou énoncée dans un cadre ‘nouveau’ » (2019, 28), la question des limites conceptuelles du contemporain littéraire promet d’être particulièrement complexe : jusqu’où peut-on dé-définir et déspécifier le littéraire ? La littérature peut-elle, par exemple, se défaire du langage ?
Du triomphe à la contestation de la modernité esthétique : pour une histoire alternative de la littérature
Ces problématiques posées, revenons à l’enquête en cours. Dans la première partie de son ouvrage, Mougin réalise une analyse historique fouillée de la modernité esthétique notamment incarnée par Greenberg, avant de passer en revue ses nombreuses critiques qui serviront de terreau à l’avènement du contemporain. L’étude archéologique de ce concept complexe et pluriel donne lieu à une histoire alternative de la littérature dont des pans entiers ont été minorés, alors même qu’ils servent de fondement au courant contemporain. Historique, cette partie est aussi épistémologique. En opérant un retour sur les grands mouvements théoriques de la modernité et sur la structuration du « monde de l’art », Mougin pointe en effet du doigt des approches un peu trop délaissées par les littéraires (les travaux de McLuhan ou d’Austin, par exemple), mais dont d’autres disciplines auront davantage su tirer profit (comme les sciences de la communication).
Le contemporain se pense donc d’abord dans son opposition à une modernité esthétique qui, dans la première partie du XXe siècle, vient privilégier un « paradigme du nouveau » – largement conçu comme positif. Avec la modernité esthétique, l’art comme la littérature sont absolutisés ; le dissensus, sous la forme d’un « rapport conflictuel à la continuation », est érigé comme une valeur fondamentale. Paradoxalement, c’est dans le rejet des systèmes hiérarchisés des Beaux-arts et des Belles-lettres – et leur système esthétique finalement très peu débattu – que le modernisme va s’engager dans la voie de l’essentialisation des arts et des lettres. C’est alors le temps des débats, des querelles entre différentes écoles, différents collectifs qui prétendent tous, à coup de manifestes, défendre la « vérité » du fait littéraire :
La modernité, en inventant la littérature, achève de périmer la plupart des cadres d’interaction sociale dans lesquels s’étaient constitués les différents genres depuis l’antiquité jusqu’au XVIIIe siècle : le rituel collectif performé, dansé et chanté – à l’origine, de la poésie comme du théâtre –, l’art oratoire et toutes les formes d’éloquence – politique, judiciaire, religieuse, épidictique –, la conversation et l’art épistolaire enfin, qui furent les grands modèles des lettres aux XVIIe et XVIIIe siècles. (2019, 65)
C’est ainsi le début d’un devenir-texte de la littérature qui relevait jusque-là du discours.
La modernité esthétique se caractérise par une forte dimension religieuse. Elle prône la sacralisation et la singularisation de l’auteur (et, symétriquement, des artistes) qui conduira à proclamer l’autonomie du champ littéraire. « La littérature devient une littérature de littérateurs, pour littérateurs » (2019, 63), et se coupe des affaires de la société. Comme le précise l’auteur, qui ne développera cependant pas davantage la réflexion en ce sens, cette essentialisation s’appuie sur le media de prédilection de la littérature : le livre, puisque « l’idéal de la pureté du médium devient la définition même du modernisme » (2019, 53). De fait, il est important de différencier la modernité esthétique de la modernité historique, en ce sens où l’absolu littéraire vient justement s’opposer aux principaux apports de la modernité historique (ses valeurs capitalistes, ses nouveaux media, son industrie – à commencer par son industrie culturelle).
Absolutisme et essentialisation vont de pair avec une virtualisation du public, lequel se retrouve largement idéalisé et uniformisé, tel que Ruffel, et avant lui Fraser, l’avaient démontré dans leur critique d’Habermas (Ruffel 2016). La littérature s’absolutise en réaction à l’émergence et à l’affirmation d’autres modèles médiatiques et esthétiques, notamment la photo, le cinéma et la presse, entraînant un repli du fait littéraire sur les questions stylistiques. Dans le champ des études littéraires, c’est en même temps l’émergence d’une critique post-structuraliste, des théories de la réception, dans un vaste mouvement qui va de Proust à Roland Barthes. Au plan théorique en effet, l’essentialisme conduit à un anti-référentialisme, un fantasme d’intransivité (comme on le trouvera chez Foucault) qui engage une réflexion sur la langue, le langage comme médium. À cette occasion, la conception même du médium évolue : ce qui était autrefois un simple moyen de représenter devient désormais un « signifiant opaque » (2019, 78), entraînant un nouvel engouement pour les problématiques de la mimesis. Langue, fait linguistique et discours (en particulier le discours littéraire) sont en effet mis en crise jusqu’à flirter avec le spectre de l’indicible.
Si la modernité esthétique est une histoire avant tout américaine, comme le montre Pascal Mougin, il en va de même de sa contestation à l’origine des mouvements contemporains. La critique de cette essentialisation et de cette absolutisation de l’art comme du fait littéraire s’organise sur tous les fronts. Du côté des théoriciens, la contestation émerge d’abord du côté du Black Moutain College, nourri de la pensée de Dewey qui prône un « art comme expérience », avant de gagner les rangs des héritiers de Greenberg lui-même (Barbara Rose ou encore Rosalind Krauss, un peu plus connue en France). Du côté des praticiens, la contestation se fait encore plus vive : le pop art, Fluxus, le minimalisme et l’art conceptuel reposent sur une « disqualification » (Krauss) qui réévalue les critères de l’art et de la littérarité, prônant une ouverture disciplinaire, une revalorisation du médium ainsi que ce principe de despécification évoqué plus tôt. Notons enfin l’apport de la philosophie analytique (Weitz, Danto, Dickie, Goodman) qui œuvre à déplacer la question ontologique et donc nécessairement essentialisante (qu’est-ce que l’art ?), vers une analyse épistémologique (qu’est-ce le concept d’art ? À partir de quand y a-t-il art ?). Plutôt que de penser « l’art », on s’intéresse donc à ses conditions de production ou à son implémentation (ce moment où une œuvre est actualisée, performée, dans un contexte spécifique).
Pendant ce temps, en France, la modernité esthétique a du mal à percer. Tout d’abord parce que la notion même de modernité y est à la fois plus ancienne et, de fait, moins univoque. Mais aussi parce que, dans un contexte où l’anti-américanisme est particulièrement fort, y compris (voire surtout) dans les milieux intellectuels comme le rappelle Mougin, les idées en provenance d’outre-Atlantique sont regardées avec méfiance. Si la modernité esthétique ne va pas percer, ni chez les théoriciens ni chez les praticiens Français, sa contestation sera elle aussi logiquement moindre. Pourtant, et Mougin le montre très bien en se livrant à une véritable contre-histoire du fait littéraire, des avant-gardes poétiques (poésie action, concrète, visuelle) s’inscrivent déjà dans la contestation d’une littérature qui, de Proust à Barthes, s’est largement absolutisée. Ces avant-gardes ne pèseront pas bien lourd, pour autant, face aux mouvements se réclamant d’une littérature intransitive, textualiste (l’OuLiPo, le Nouveau roman) et centrée sur le livre (lequel n’est d’ailleurs guère remis en question). Les initiatives ne manquent pourtant pas – et sont d’ailleurs parfois portées par des artistes et écrivains reconnus, comme Antonin Artaud. Pourquoi sont-elles alors si méconnues ? Outre les problèmes liés à leurs conditions d’inscription (hors des livres, elles n’ont, en effet, laissé que peu de traces), Mougin note le silence d’une critique largement décontenancée par ces pratiques, qui n’entraient pas dans leur cadre d’analyse. Pour penser le contemporain, encore fallait-il pouvoir le dire…
La difficile reconnaissance du contemporain : le verrou institutionnel
Dans ce qui est désormais devenu un texte canonique des études intermédiales, André Gaudreault et Philippe Marion affirment qu’un media naît toujours deux fois : d’abord, comme un « prolongement de pratiques antérieures à son apparition auxquelles il a été inféodé dans un premier temps » (Marion et Gaudreault 2000), puis lorsque les pratiques originales qu’il a mises en œuvre acquièrent enfin une légitimité institutionnelle. Ce précepte médiatique s’applique assez bien au concept de contemporain, du moins dans son versant artistique. Lorsque le musée de Boston, fondé en 1936, se rebaptise en 1948 « Institue of contemporary Art » pour se consacrer entièrement à l’art contemporain – par opposition au MoMa, temple de l’art moderne – l’avènement de l’art contemporain est largement entériné. En littérature, cependant, la situation est plus complexe, et Mougin montre bien comment la naissance institutionnelle du contemporain va justement empêcher l’avènement complet d’une littérature contemporaine. En études littéraires, le contemporain est en effet prisonnier d’une tendance institutionnelle à la périodisation : réduit à l’état de « période » venant logiquement après le moment moderne, le contemporain peine à devenir un véritable cadre conceptuel pour penser la littérature. Dans la seconde partie de son ouvrage, Pascal Mougin se livre à un examen de ces verrous institutionnels propres à la littérature. L’enjeu est triple : il s’agit de se libérer d’une approche périodisante qui est au fondement de nos études ; d’éviter le piège moderne consistant à penser le contemporain comme une rupture ou un renouveau (ce qui reviendrait à adopter un point de vue finalement téléologique – donc essentialisant – du fait littéraire) ; de reconsidérer enfin le rôle des chercheurs dans la patrimonialisation de la littérature.
Pour penser le contemporain, les études littéraires doivent d’abord s’émanciper du problème de la périodisation, en particulier du découpage séculaire, qui demeure la norme à l’Université. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a d’abord été pensée dans les nombreuses études qui se sont penchées sur le « tournant » des années 1980 (chez Viart, Vercier, Blanckeman, Touret, Dugast-Portes, notamment). Les explorations terminologiques de ces chercheurs témoignent à la fois d’une difficulté à s’extraire de la périodisation et d’un désir d’englober sous un seul label une production hétérogène dont on ne sait trop que faire – « Littérature au présent », « Littérature contemporaine », « Littérature postmoderne » jusqu’à la « Littérature de l’extrême contemporain » qualifiant presque un renoncement face à ce qui ne pourrait être défini… La tentation essentialiste n’est alors jamais bien loin, d’autant plus lorsqu’elle s’allie au piège de la littérarité. Face à une production littéraire foisonnante, hétérogène, la tentation d’un repli sur le style est facile – et Mougin montre bien comment une frilosité (voire une paresse ?) critique nous fait contourner le contemporain, en nous fourvoyant dans un imaginaire littéraire formé de préconçus modernistes : ce que l’auteur appelle la « rémanence moderniste ».
Autre verrou majeur, la fonction patrimoniale de l’université, qui considère la littérature comme une « pratique au-delà de tout apprentissage » (2019, 182). Toutes ces études périodisantes sur le contemporain se contentent en effet de s’intéresser à des écritures prescrites, si l’on peut dire : une littérature déjà institutionnalisée par ses grands éditeurs, dont la littérarité est indiscutable – surtout, un corpus essentiellement livresque. Ces constats sans détour amènent Mougin à livrer un plaidoyer inspirant pour une redéfinition de l’identité des littéraires. En effet, les principaux ennemis de la littérature contemporaine sont sans doute d’abord les littéraires eux-mêmes :
[L]a littérature n’a ni littératologues ni littéraristes, elle n’a que des « littéraires », appellation tout juste commode et fondamentalement ambiguë, puisqu’elle s’applique aussi bien au plus éminent théoricien qu’au lycéen fâché avec les matières scientifiques. […] Le déficit identitaire comme l’indétermination disciplinaire portent par contrecoup à l’absolutisation compensatoire de la littérature elle-même. (2019, 188)
Nous avons oublié d’apprendre et d’enseigner la pratique littéraire – un mouvement initié dès le XIXe siècle avec la suppression des cours de rhétorique. Là où dans d’autres cultures, chez les anglo-saxons notamment, les cours de creative writing ne forment pas nécessairement des écrivains, mais des théoriciens capables de déployer un discozurs critique qui nous fait encore défaut. Que l’on se rassure, l’état des lieux réalisé ici n’est pas totalement noir et Mougin rend à Ruffel, Colard, Jallon, Hanna ou Maingueneau l’hommage qui leur est dû – on regrettera peut-être ici de ne voir mentionnées que des recherches en littérature, là où le corpus impensé du contemporain est déjà à l’étude dans d’autres champs : études théâtrales, études cinématographiques ou info-com, notamment.
Minimalismes et littéralismes : le contemporain, une invention franco-américaine ?
La troisième partie de l’ouvrage opère un retour sur les concepts de minimalisme et de littéralisme, dont l’art et la littérature ont, une fois n’est pas coutume, fait un usage distinct. Aux origines du paradigme contemporain, l’art minimal « défait la relation d’immédiateté à la fois métaphorique et métonymique, entre l’artiste et sa création » (2019, 209). Cette dernière, « impersonnelle, anti-expressive, anti-illusionniste, anti-symbolique, […] décourage l’interprétation qui y chercherait autre chose que ce qui est donné à voir » (2019, 210). Dans la tradition artistique anglo-saxonne, la définition de l’art minimal ne suscite aucun débat, tout juste est-elle soumise à une ambiguïté sémantique, tantôt qualifiée sous le terme de minimalisme ou de littéralisme. La littérature ne parvient pas à un tel consensus : non seulement minimalisme et littéralisme littéraires recouvrent des réalités divergentes mais, en plus, ces deux concepts renvoient eux-mêmes individuellement à une pluralité de courants, dont les usages et les définitions sont débattus. Pascal Mougin plonge dans la généalogie de ces deux concepts littéraires, en superposant à son étude des chassés-croisés entre le monde de l’art et celui de la littérature une analyse documentée et nuancée des échanges entre le continent américain et l’Europe. C’est l’occasion de revenir sur une idée récurrente (et quelque peu fantasmée) : le paradigme contemporain serait-il né de la rencontre entre des littéraires français et des artistes américains ?
Avant même le succès de la French Theory, la critique américaine se montre en effet poreuse aux idées véhiculées par un minimalisme à la française : la notion de « degré zéro » de l’écriture, d’écriture blanche, etc. jusqu’à l’idée barthésienne de mort de l’auteur. Pourtant, là où les Français ont pu jouer un rôle de catalyseur permettant aux Américains de s’affranchir du modernisme greenbergien, ils échouent à transformer l’essai à domicile. Ce paradoxe n’est-il pas l’indice d’une survalorisation de cette synergie franco-américaine ? Sans complaisance, Mougin passe en revue les grandes influences européennes – mais surtout françaises – qui œuvreront à faire émerger le contemporain, via le minimalisme et le littéralisme : Wittgenstein, Merleau-Ponty, Beckett, Robbe-Grillet et Barthes. De manière scrupuleuse, il analyse l’impact effectif de ces penseurs et / ou écrivains, sans hésiter à le nuancer radicalement.
Les pages consacrées à Roland Barthes sont, à cet égard, particulièrement éclairantes. Elles proposent une relecture audacieuse du théoricien dont il réévalue l’apport et le rapport au contemporain. C’est en effet dans la revue américaine Aspen, qui jouera un rôle essentiel dans l’affirmation du paradigme contemporain, que Barthes publie la version originale de « La mort de l’auteur ». Mais plutôt que de voir ici, comme certains ont pu l’avancer, le manifeste du minimalisme, Mougin montre plutôt que la rencontre quelque peu fortuite entre le sémiologue et l’art contemporain restera sans suite. Dissipant un malentendu, il rappelle que Barthes, en fin de compte, était résolument moderne – au sens greenbergien du terme. Avec Barthes et la mort de l’auteur, l’essentialisation du littéraire ne disparait nullement : elle se déplace, plutôt, de l’auteur vers le texte qui, conçu comme une entité autonome, hérite de la tendance sacralisante. Très critique à l’égard de la désartification dans les pratiques contemporaines, ainsi que des perspectives ouvertes par l’industrie culturelle, Barthes se révèle bien plus conservateur qu’on a bien voulu le dire.
Quant au concept de littéralité, il n’est guère plus simple à saisir – quoique peut-être plus convaincant pour servir de terreau à une pensée d’une littérature contemporaine. Mais là où, en art, la littéralité désigne une œuvre ne renvoyant à rien d’autre qu’elle-même, on comprend bien que la notion sera plus problématique en littérature – littéralité s’opposant alors à littérarité (soit à ce qui « fait littérature »). Poursuivant sa relecture de l’œuvre de Barthes, en particulier du concept de « degré zéro » de l’écriture si proche en apparence du minimalisme, Pascal Mougin souligne le fantasme d’une a-littérarité par principe utopique : toute tentative « a-littéraire » finit par relever de la littérature, car elle s’appuie, de facto, sur un écart à la norme créant nécessairement un supplément de sens. Aussi est-ce dans le champ de la poésie, et tout particulièrement des courants de la post-poésie qui se sont attelés à dépoétiser le poétique (Gleize, Quintane, Cadiot, Prigent…), que les littératures littérales sont les plus convaincantes, mais aussi les plus impénétrables et abstraites, flirtant non plus avec l’indicible, mais l’illisible.
De l’œuvre à l’idée d’œuvre : la revanche du texte ?
Pascal Mougin achève son enquête par une exploration des conceptualismes artistiques et littéraires. Surfant sur la vague du minimalisme, l’art conceptuel marque une nouvelle étape dans l’avènement du paradigme contemporain, se permettant une radicalité encore plus forte. Désormais, « l’œuvre est dans l’idée d’œuvre » (2019, 303) et sa réalisation n’est que secondaire.
[Le conceptualisme] se caractérise en particulier par trois aspects distincts plus ou moins imbriqués, souvent complémentaires, parfois plus difficilement compatibles : une tendance à l’allographisation de l’œuvre plastique, à savoir son remplacement par l’énoncé qui la décrit, une tendance inverse à l’effectuation systématique de l’énoncé en question, alors conçu comme un protocole d’action, une tendance plus spéculative enfin, qui consiste à remplacer l’art lui-même dans son ensemble par la réflexion sur l’art. (2019, 305)
En raison même de ce devenir-allographique, l’œuvre d’art tend à se « virtualiser » au sens premier du terme : faire œuvre signifie mettre en place les conditions d’une œuvre, dont les actualisations seront potentiellement infinies. L’œuvre conceptuelle est donc d’abord processuelle, sérielle, itérative. Avec une conséquence majeure en termes de réception et d’expérience esthétique pour celui qui n’est déjà plus le lecteur ou le spectateur mais le « témoin » : « on ne peut véritablement posséder l’œuvre conceptuelle qu’en se souvenant d’elle » (2019, 305).
Dans un tel contexte, on comprend combien le langage est en théorie promis à un brillant avenir : l’art conceptuel est une pratique dont il faut témoigner, faire le récit. Il exige une langue qui favorise la référentialité – par opposition à la fiction. Dans ce contexte, la relation que l’art contemporain entretient avec la littérature ouvre des problématiques passionnantes : l’art conceptuel serait-il d’abord de la littérature ? Comment la littérature se situe-t-elle par rapport à l’approche conceptuelle ? À quel point est-elle sommée de se repenser sous l’influence de ces pratiques artistiques qui théorisent le langage ? Une fois encore, Pascal Mougin nous engage à ne pas trop nous emballer. L’analogie entre art conceptuel et littérature conceptuelle est en effet tout aussi complexe et déceptive que les minimalismes et littéralismes étudiés jusque là. D’abord, parce que l’idéal d’une œuvre entièrement autoréférentielle est utopique, voire naïve. Puisqu’il s’inscrit nécessairement quelque part, le langage n’est jamais totalement dénotatif, ni transitif. Aussi, « en voulant dématérialiser l’art, le conceptualisme [aura] repragmatisé le texte, là où l’avant-garde littéraire du même moment l’insularisait plus que jamais » (2019, 314).
Quelles seraient alors les littératures conceptuelles ? La piste Oulipienne suggérée par Gérard Genette (parmi les premiers à avoir travaillé en France sur la notion de littérature conceptuelle) est vite abandonnée par Mougin. Plus prometteur, le filon américain, sous l’égide notamment de Goldsmith et Dworkin et de leur concept « d’écriture sans écriture » :
En subordonnant la collecte à une procédure automatisée – ou « traitement de texte », comme dit Goldmisth – le conceptual writing neutralise tout subjectivisme . Là encore, le contexte contemporain justifie la démarche. L’existence, dans l’environnement numérique, de masses de données aussi diverses que considérables, mais que leur volume même, l’immédiateté de leur disponibilité et la cadence exponentielle de leur développement rend précisément inappréhendables par les moyens traditionnels de la lecture ou du visionnage, impose l’invention de procédures algorithmiques de frayage, de butinage, de sélection et de mise en forme susceptibles de déboucher sur des représentations et des formes d’appropriation inédites des ensembles en question. Les éléments linguistiques ou textuels sélectionnés, filtrés et éventuellement réaménagés par l’algorithme représentent alors une coupe franche dans l’environnement discursif ou informationnel que constituent les big data sans pouvoir être mis au compte d’une énonciation enchâssante – sinon celle de l’automate – susceptible de leur conférer une signification particulière : ils sont laissés à leur pure nature de documents ou, le cas échéant, à leur pure opacité formelle. (2019, 334‑35)
L’analyse ici proposée est moins convaincante. Non seulement elle porte à confusion sur l’objectivité de la médiation numérique (ni les données, qui n’ont de « donné » que le nom, ni l’algorithme lui-même, ne sont des objets totalement acheiropoïetes, mais bien des constructions humaines qui impliquent la subjectivité de leur codeur), mais, surtout, elle réduit quelque peu le projet esthétique de ces écrivains dont elle ne retient que les productions textuelles. Or chez Goldsmith et Dworkin, mais en vérité chez bon nombre d’écrivain.e.s ayant recours à l’écriture computationnelle, le pré-texte (l’algorithme qui donne l’idée du texte et en propose une modélisation) et le post-texte (les multiples actualisations possibles du texte programmatique) ne sont que des étapes, des parties d’œuvres destinées à être performées lors de lectures publiques et collectives. Autant de caractéristiques, en somme, du paradigme contemporain.
Perspectives sur les impensés de la littérature contemporaine : corpus et méthodologies
Sans rien ôter à la richesse et à l’érudition d’un ouvrage essentiel au renouveau de la théorie littéraire, on pourra s’interroger sur les limites d’un geste théorique visant à ne comprendre le contemporain littéraire qu’à l’aune de son pendant artistique – rejouant, quelques siècles plus tard, la querelle esthétique de l’ut pictura poesis. Car si, pour Goldsmith, la littérature a d’abord pris un siècle de retard sur l’art, ce n’est que pour mieux prendre sa revanche grâce au media numérique qui, fondamentalement, demeure le media de l’écriture, d’une écriture stratifiée – machinique, programmatique, « naturelle ». Ainsi, les principes de recontextualisation, de copié-collé, de mash-up ou de reformulation qui sont au cœur de cette uncreative writing, doivent probablement tout autant, sinon davantage, à une culture informatique (celle des programmeurs, des écrivains du code) qu’à l’art conceptuel. Pour le formuler plus clairement, là où Pascal Mougin parle de « medium » littéraire, il parait indispendable de penser plutôt le media – une dénomination qui, justement, désessentialise le support de l’écriture et permet de penser le fait littéraire comme un ensemble de « conjonctures médiatrices », tel que l’ont récemment proposé Jean-Marc Larrue et Marcello Vitali-Rosati (2019).
En fin de compte, l’ouvrage de Pascal Mougin porte moins sur la littérature contemporaine en soi (comme on peut le retrouver chez Ruffel (2016), Nachtergael (2018) et d’autres, cités dans la bibliographie ci-dessous) que sur les raisons qui ont conduit le paradigme contemporain à devenir un impensé majeur des études littéraires. En ce sens, l’essai ouvre des perspectives théoriques essentielles, parmi lesquelles on retiendra au moins deux chantiers majeurs.
Tout d’abord, celui de l’élargissement et de la structuration de notre corpus d’étude. Mougin dresse une liste très sommaire de ces objets qui, à l’en croire, seraient encore confidentiels : écritures numériques, pratiques intermédiales, transmédiales, littérature exposée, etc. Mais cette littérature est-elle vraiment peu connue ou seulement peu reconnue ? Si l’on prend le cas précis des écritures numériques (blogues, réseaux sociaux et même vidéo Youtube), on s’aperçoit en effet très vite qu’elles bénéficient d’un public que nombre d’éditeurs traditionnels rêveraient de fédérer. Le petit compteur automatique que François Bon, par exemple, a placé en bas de chacune de ses pages, en donne un aperçu.
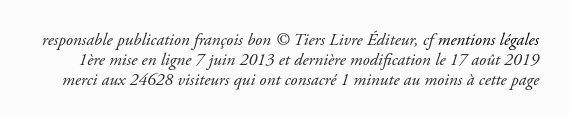
Que le public ayant lu, écouté ou visionné ces textes, ces podcasts ou ces vidéos, en reconnaissent la portée littéraire, cela ne va en revanche pas de soi. Du côté de l’institution, la situation est parfois pire encore, puisque ces formats peu conventionnels sont par principe ignorés en raison même des connotations d’a-littérarité que leur media leur confère. L’impensé de la littérature contemporaine s’est érigé, comme le montre bien Pascal Mougin, sur une critique violente des nouvelles écritures, investissant un discours de la fin, de la décadence, qui a « refroidi » pour quelques années les ardeurs des chercheurs, quand il n’a pas mis à la marge les quelques récalcitrants. Ce problème est capital à l’heure où, justement, le contemporain littéraire pose des défis en termes d’établissement, mais aussi de conservation de corpus. Face à la fragilité (notamment médiatique) de ces explorations littéraires contemporaines, la communauté savante a pourtant un rôle essentiel à jouer pour garantir la sauvegarde du patrimoine littéraire de demain. Cela implique de poursuivre la réflexion épistémologique : quelles frontières accordons-nous au fait littéraire ? Quelle légitimité donnons-nous à ces nouvelles pratiques, et sur quels critères ? Comment parler et comment analyser ce corpus ?
L’impensé de la littérature contemporaine est en effet aussi un problème méthodologique – c’est le second chantier qui s’ouvre à nous. Car ce défaut du corpus est à l’image des limites des outils de prédilection des études littéraires depuis les années 1990 : le sacre de la narratologie mais aussi celui de la poétique, ont contribué à fermer la porte à des objets qui ne pouvaient s’y plier. Ouvrir le domaine de la littérature implique donc de faire le ménage dans notre boîte à outils. Car force est de constater que ces nouveaux corpus ont intéressé, bien avant nous, d’autres approches disciplinaires : les media studies, visual studies, humanités numériques, la sémiotique, l’info-com… À ce propos, on regrettera peut-être que le paysage des études littéraires dessiné par Pascal Mougin soit très franco-français, là où la recherche francophone comprend de nombreuses initiatives pour l’étude de ces nouveaux corpus : dans le domaine des pratiques numériques, le travail du NT2 de Bertrand Gervais, de la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques de Marcello Vitali-Rosati au Québec ; dans le domaine des écritures texte/image, l’école belge de Myriam Watthee-Delmotte ou de Jan Baetens, mais aussi le vaste champ des études photolittéraires (Jean-Pierre Montier, Marta Caraïon, David Martens, Anne Reverseau) ; dans le champ des études intermédiales, les travaux développés notamment à l’Université de Montréal depuis quelques dizaines d’années… Ces approches ont déjà toutes opéré un travail de désessentialisation du media – une notion plus riche que celle de médium – permettant ainsi de dépasser le débat esthétique sur la correspondance entre les arts et de liquider le spectre de l’ut pictura poesis encore très présent dans l’ouvrage de Pascal Mougin. Évidemment, l’objectif n’est pas d’abandonner les outils traditionnels de la littérature, mais plutôt de les réinventer, de les hybrider, comme l’a tenté il y a peu Gilles Bonnet en esquissant une « poétique numérique » (2017). En somme, faire en sorte que nos méthodologies prennent elles aussi le tournant contemporain.
Bibliographie
Auclerc, Benoît, Olivier Belin, Olivier Gallet, Laure Michel, et Gaëlle Théval. 2019. « Pour une poésie extensive ». Elfe XX-XXI. Études de la littérature française des XXe et XXIe siècles, nᵒ 8 (septembre). https://doi.org/10.4000/elfe.1418.
Blanckeman, Bruno. 2000. Les récits indécidables : Jean Echenoz, Hervé Guibert, Pascal Quignard. Première édition. Perspectives. Villeneuve d’Ascq Nord: Presses universitaires du Septentrion. http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100194410.
Bonnet, Gilles. 2017. Pour une poétique numérique : Littérature et Internet. Paris: Hermann.
Bonnet, Gilles. 2018. « Fabula, Atelier littéraire : LitteraTube ». https://www.fabula.org. https://www.fabula.org/atelier.php?LitteraTube.
Gefen, Alexandre, et Claude Perez. 2019. « Extension du domaine de la littérature ». Elfe XX-XXI. Études de la littérature française des XXe et XXIe siècles 8. https://doi.org/10.4000/elfe.736.
Goldsmith, Kenneth. 2011. Uncreative Writing: Managing Language in the Digital Age. Columbia University Press.
Guilet, Anaïs. 2013. « Pour une littérature cyborg : l’hybridation médiatique du texte littéraire ». Thèse ou essai doctoral accepté, Montréal (Québec, Canada): Université du Québec à Montréal. http://www.archipel.uqam.ca/6010/.
Larrue, Jean-Marc, et Marcello Vitali-Rosati. 2019. Media do not exist: performativity and mediating conjunctures. Institute of Network Cultures. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/22937.
Marion, Philippe, et André Gaudreault. 2000. « Un média naît toujours deux fois ». In La croisée des médias.
Monjour, Servanne, Marcello Vitali-Rosati, et Gérard Wormser. 2016. « Le fait littéraire au temps du numérique. Pour une ontologie de l’imaginaire ». Sens Public, décembre. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/16362.
Mougin, Pascal. 2019. Moderne / contemporain. Paris: Les Presses du réel. https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=7310.
Nachtergael, Magali. 2018. « Littératures expérimentales - Présentation ». Itinéraires. Littérature, textes, cultures, nᵒˢ 2017-3 (juin). http://journals.openedition.org/itineraires/3876.
Ruffel, Lionel. 2016. Brouhaha. Les mondes du contemporain. Lagrasse: Verdier.
Saemmer, Alexandra. 2019. « La littérature informatique, un art du dispositif ». In Connaître et valoriser la création littéraire numérique en bibliothèque, 28‑39. La Boîte à outils. Villeurbanne: Presses de l’Enssib. http://books.openedition.org/pressesenssib/10141.
Théval, Gaëlle. 2015. Poésies ready-made, XXe-XXIe Siècle. Paris: L’Harmattan. http://www.editions-harmattan.fr/index_harmattan.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=48235.
Vitali-Rosati, Marcello. 2016. « What is editorialization? » Sens Public, janvier. https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/12972.
C’est à cette époque que l’ut pictura poesis horacien devient un argument pour marquer la séparation entre les arts – une séparation qui sera enterinée par Lessing, dont les travaux influencent encore notre imaginaire critique.↩