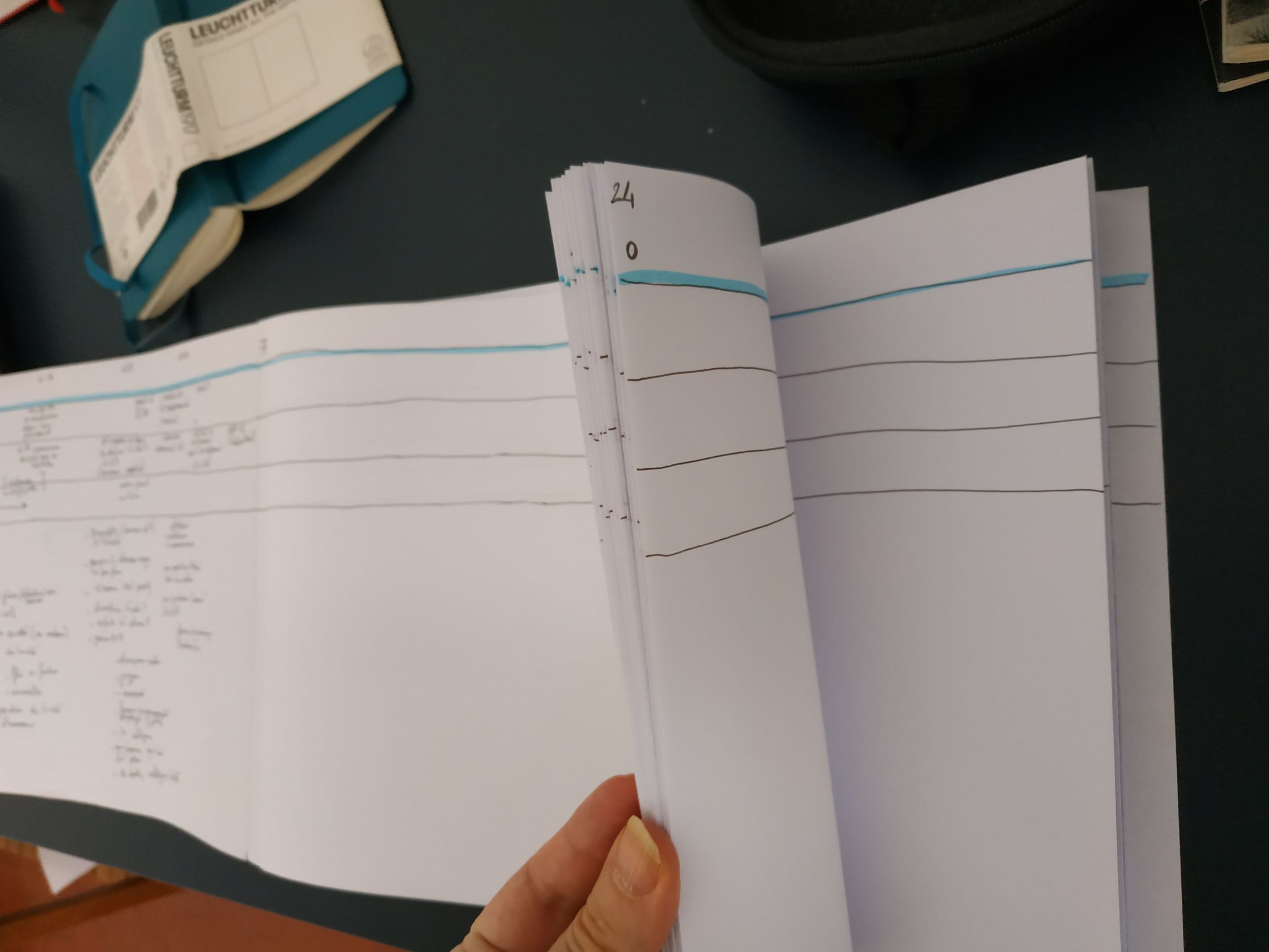Servanne Monjour : Le web est devenu pour toi un espace d’écriture dès 2007, à l’occasion de la rédaction de ton livre Fenêtre Open Space, qui a également donné son nom à ton site (ou préfères-tu dire ton blogue ?). Lors d’une précédente conversation, tu as notamment déclaré à propos de cet espace d’écriture numérique, « Enfin, voilà une machine qui pense comme moi ». Pourrais-tu revenir sur cette phrase, et expliquer en quoi ce passage en ligne a pu changer – libérer ? – ton écriture ?
Anne Savelli : Ce qui a changé mon rapport à l’écriture, c’est d’abord le traitement de textes, ce qui paraîtra incroyable à qui n’a pas connu les machines à écrire : pouvoir créer des liens hypertexte, insérer du texte, etc. C’est en passant au traitement de textes que, soudain, dans les années 1990, j’ai eu l’impression de découvrir quelque chose qui « pensait comme moi » : par arborescences, ou peut-être plus exactement, par rhizomes (le mot arborescence laisse penser que les branches ont une fin. Or non, tout circule). L’insertion d’un texte enchâssé dans un autre texte, elle aussi, m’a donné des ailes. Je me souviens qu’à l’époque, l’édition était très frileuse. On se moquait de ces auteurs qui fonctionnaient par copiés collés. Cela paraît ridicule, aujourd’hui. Le blog est en effet arrivé en 2007, à la parution de mon premier livre, Fenêtres. Je l’ai utilisé durant plusieurs années, puis je suis passée au site. Ce sont deux espaces différents.
Servanne Monjour : À l’époque, il me semble que tu avais déjà fait le choix d’écrire sur le CMS SPIP, très utilisé par la communauté littéraire francophone (François Bon, Guillaume Vissac, Arnaud Maïsetti, par exemple, utilisent également cet outil). Le CMS a l’avantage d’offrir une solution de publication pérenne, sans en passer par une étape souvent fastidieuse de codage from scratch – je pense ici au témoignage livré par Philippe de Jonckheere, « Le Désordre dans tous ses états », à propos de la genèse complexe de son site Désordre.net. Il y a quelques années, Arnaud Maïsetti déclarait « Pour ma part, je n’aurais fait du code que pour effacer l’impression de la technique ». Quel est ton rapport à cet outil ? Plus largement, comment envisages-tu ton rapport à la technique, et en particulier au code informatique ?
Anne Savelli : J’ai commencé par ouvrir un blog sur Blogger, ce qui ne demandait aucune compétence technique. J’étais journaliste pigiste dans la presse magazine grand public, à l’époque. Mon rôle était, précisément, d’apprendre aux gens à utiliser internet sans se servir du code. Je testais tout ce dont j’avais à parler (on me commandait les sujets des articles, je ne choisissais pas), et parfois le détournais pour l’écriture. C’est ainsi que j’ai ouvert mon blog ou, plus tard, créé le personnage Dita Kepler sur Second Life. Certains auteurs continuent à utiliser Blogger (Claro, par exemple), et ont l’air de s’en porter très bien. Moi, après plusieurs années de bons et loyaux services, j’ai eu envie de passer au site, afin d’obtenir un outil un peu moins linéaire (verticalement, s’entend). Sur les blogs, un article chasse l’autre et j’avais envie d’un site avec des onglets, que je pourrais sous-catégoriser à ma guise. J’avais déjà découvert un peu Spip avec remue.net (je me souviens d’une réunion où Philippe de Jonckheere avait formé les membres du collectif). C’est Joachim Séné, avec lequel je travaille régulièrement, qui m’a proposé de passer à Spip en ouvrant ce qui est devenu mon site, site dont il est le webmaster. Je sais, grosso modo, utiliser l’interface de Spip, dont nous nous servons également avec mon collectif, L’aiR Nu. Par contre, je ne sais toujours pas coder, en dehors d’une ou deux bricoles. Dès qu’il y a un problème technique, j’appelle Joachim. Je pense que c’est idiot, que je ferais mieux d’apprendre une fois pour toutes, mais je ne peux pas tout faire : j’écris, j’anime des ateliers, je fais du podcast… Lorsqu’un problème survient, je sais qu’il faut commencer par aller chercher de l’aide en utilisant les tutoriels, autrement dit, faire exactement ce que je proposais à mes lecteurs quand j’étais journaliste. Mais je n’ai pas toujours cette patience (je n’ai aucune patience, en général, et surtout pas face aux machines).
Servanne Monjour : Ton dernier ouvrage, Musée Marilyn, publié chez Inculte, est le fruit d’un chantier littéraire et iconographique qui a duré plus de sept ans. Pour ce projet, tu as investi de nombreux espaces numériques : ton propre site, bien sûr, mais également la revue littéraire numérique Remue.net, et surtout les réseaux sociaux : d’abord Facebook, puis Twitter et Instagram. Qu’est-ce que les réseaux sociaux apportent à ton travail ? J’ai l’intuition que la dimension collective est particulièrement importante, mais j’ai également l’impression que ces réseaux te permettent de tenir un journal d’écriture qui va soutenir – maintenir à flot – un projet de longue haleine.
Anne Savelli : Oui, les choses sont relativement imbriquées, en particulier sur cette question du soutien. Artistiquement, on ne peut pas comparer les 430 pages de Musée Marilyn et la tenue d’un compte Instagram tel que je l’envisage (c’est-à-dire sans recherche artistique particulière). Par contre, il est certain que j’ai toujours été sensible à la dimension collaborative, que j’ai même provoquée, par moments : par un appel à cartes postales sur Twitter qu’on retrouve dans un de mes livres, Décor Daguerre, par la création de L’aiR Nu ou, en ce qui concerne Marilyn, par celle d’un groupe Facebook, Marilyn everywhere, qui compte maintenant plus d’une centaine de membres sans que je l’aie cherché. Au départ, il s’agissait de me donner de l’élan alors que j’écrivais, en effet. Je crois que c’est très fréquent. Un grand nombre d’auteurs a besoin, pour s’aider à progresser, de dire en ligne ce qui lui arrive. Simplement, moi, j’aime bien créer des formes, même minimales (ouvrir des groupes, utiliser des hashtags, proposer un podcast mensuel…). Je me méfie des posts Facebook, par exemple, qui, ensuite, disparaissent. Je comprends bien l’intérêt de communiquer immédiatement quelque chose, d’avoir un retour immédiat ou presque, sur ce qui nous arrive (une joie, une déception, etc). Mais je me réfrène pour plusieurs raisons, entre autres parce que susciter perpétuellement des commentaires me paraît toxique.
Servanne Monjour : Depuis plusieurs années, tu as investi la forme du podcast grâce à L’aiR Nu, une radio littéraire numérique, qui te permet d’explorer un autre mode d’expression : la voix, le son, et peut-être même le bruit – une thématique qui est au centre de ton tout dernier projet. Pourrais-tu dire un mot sur ces projets et sur ton rapport à l’oralité ?

Anne Savelli : J’ai toujours été très sensible aux voix, à leur tonalité, à leur grain et donc, forcément, à la radio. Je lis mes textes en public depuis le début, je le fais avec grand plaisir et je pense que cela se sent. Il n’est donc pas très étonnant que je me sois mise au podcast et entourée de gens qui aiment, eux aussi, le média radio (j’ai même fait des études d’audiovisuel, pour tout dire, à une époque : quelle joie d’avoir, aujourd’hui, des outils gratuits et faciles d’accès !). Quand j’étais enfant, en maternelle ou au CP, je voulais être écrivaine, déjà, mais également bruiteuse (j’avais vu un reportage à la télévision, qui m’avait fascinée). A la vingtaine, j’ai été choriste dans un groupe de rock, ce qui m’a amenée à faire de la scène. Je crois que tout converge, aujourd’hui. L’aiR Nu (Littérature Radio Numérique) est un collectif d’auteurs que nous avons monté en 2015, mus par le désir de faire de la création sonore avec les moyens du bord. Avec nos capacités et nos incapacités. Le site a abrité différentes rubriques, de la création proprement dite aux entretiens avec des professionnels du livre, en passant par de simples lectures. Nous sommes en pleine effervescence, en ce moment, avec l’arrivée de Christine Jeanney parmi nous, et je pense que nous proposerons bientôt de nouvelles formes. Bruits, quant à lui, est un projet de fiction que je porte depuis vingt ans et dont il va falloir vraiment que je vienne à bout maintenant – au lieu de répondre à ces questions ! Il s’agit d’un roman divisé en 1440 fragments correspondant aux 1440 minutes qui s’écoulent de 6 heures du matin à 5h59 le lendemain. Durant ces 24 heures, une petite fille, désignée par la lettre F, fuit le bruit qui l’empêche de grandir. Je tente de mettre dans ce livre à peu près tout ce qui m’intéresse : questions liées au son, à la ville, à la place des femmes dans la ville, au désir de liberté… Bruits sera également un site, légèrement différent du livre, dans lequel je tenterai de présenter le texte en pensant sa lecture et le parasitage éventuel de celle-ci.
Servanne Monjour : Tout récemment, tu as investi Patreon, qui se définit d’abord comme un site Web de financement participatif, et que des écrivains investissent de plus en plus pour y publier des travaux sonores ou audiovisuels. Pourquoi avoir choisi cette plateforme ? En quoi te permet-elle d’acquérir une nouvelle indépendance, notamment financière ?

Anne Savelli : C’est tout récent, mais je viens en effet de me lancer et je suis déjà extrêmement contente du résultat. Mon idée, c’est de créer une communauté de personnes intéressées par l’écriture désireuses de s’aider les unes les autres. Bien sûr, il s’agit de me soutenir, moi, financièrement. Mais au-delà, à travers une newsletter hebdomadaire (Les nouvelles du dimanche) et un podcast créé spécialement pour le Patreon, Faites entrer l’écriture, j’espère vraiment que nous allons fonctionner par rebonds et nous permettre, les uns les autres, d’avancer. L’idéal, bien sûr, et j’espère y parvenir à terme, serait de pouvoir devenir, grâce à cela, autonome financièrement. Contrairement à ce qu’on imagine, être écrivain, c’est principalement courir à travers la France pour animer des ateliers, participer à des rencontres, monter des projets de résidence, etc. Je l’ai beaucoup fait, le ferai sûrement encore, mais j’ai envie de « centrer » davantage mon travail, maintenant ; de moins m’éparpiller, tout en faisant profiter les autres de mon expérience.
Servanne Monjour : La plupart de tes chantiers initiés sur le web ont fait l’objet, à un moment, d’une publication sous forme imprimée. Quelle place tient le livre – à la fois comme objet symbolique, mais également comme support du texte – dans ta pratique ? Quelle relation as-tu pu tisser avec des éditeurs (tu as notamment collaboré avec Claro, mais également Brigitte Giraud), et quel regard ces éditeurs ont-ils porté sur ta pratique numérique ?
Anne Savelli : Certains de mes livres ne sont que numériques et, quand c’est le cas, c’est souvent parce que leur forme ne « tiendrait » pas dans un livre imprimé. Ainsi, Laisse venir, que nous avons écrit avec Pierre Ménard, et dont la circulation de lecture est à la fois horizontale et verticale, n’aurait pas du tout le même sens s’il devait être imprimé. Cela le réduirait beaucoup. Cependant, je suis moi-même une grande lectrice (et acheteuse !) de livres imprimés. Par ailleurs, on le sait, les livres nativement numériques et non homothétiques ne marchent pas, ou très peu, pour de multiples raisons (prix prohibitifs des ouvrages, séduction très relative des liseuses, entre autres). Nous avons tenté beaucoup de choses, il y a dix ans, mais sans forcément beaucoup d’échos, en tout cas en France (c’est différent au Canada, par exemple, ou même en Italie, en ce qui me concerne). Je continue donc à penser à ce que j’écris sous forme imprimée, sauf quand il s’agit de travailler avec L’aiR Nu, qui a sa propre collection de livres numériques, Les villes passagères. Je n’ai jamais beaucoup discuté de ces questions avec Claro (qui a son blog et intervient sur Twitter, principalement) ni avec Brigitte Giraud. Je me souviens juste qu’elle me disait, il y a plus de 10 ans, que « j’avais ça », cette possibilité-là d’expression, grâce au numérique (autrement dit, que je n’étais pas entièrement attachée au milieu traditionnel du livre, ce qui est vrai). Bien sûr, si « j’ai ça », c’est que je suis allée le chercher. Je me souviens lui avoir dit, par ailleurs, que la place, sur internet, était extensible : on ne prend pas celle d’un autre en mettant en ligne du contenu. Simplement, là encore, il faut aller chercher – son lectorat, cette fois. Par contre, j’ai plus d’une fois parlé de tout cela avec Philippe Aigrain, qui a dirigé publie.net jusqu’à sa mort, en 2021.
Servanne Monjour : C’est sans doute la contrainte majeure de l’écriture en ligne, à laquelle personne n’échappe : il est difficile d’assurer la pérennité de tous les contenus publiés en ligne. Aussi, certaines de tes publications ont déjà disparu (je pense au site web qui accompagnait le projet d’écriture Franck), ou sont un peu plus difficiles à trouver (c’est le cas, tout simplement, de publications un peu anciennes sur les réseaux sociaux) : as-tu constitué ton propre fonds d’archives ? Quel est ton ressenti face à la disparition de ces écrits ?
Anne Savelli : Quand le site lié à Franck a brutalement disparu, Dans la ville haute, j’ai tout de suite décidé de laisser faire, de ne pas chercher à récupérer les données pour le remettre en ligne – plus vraisemblablement, il aurait fallu tout recommencer. Pourtant, ce site était vraiment une extension de mon livre et j’y avais consacré des centaines d’heures. Mais je n’ai pas voulu me focaliser sur cette perte, et je crois que j’ai eu raison. En règle générale, je ne réutilise jamais ce que j’ai déjà fait, écrit ou construit, une fois que je m’en suis servie (c’est valable également pour les propositions d’atelier d’écriture). Il y a, de toute façon, quelque chose de désespérant, lorsqu’on publie des livres. Jamais, rien n’est à la hauteur de ce qu’on y a mis. Les livres, à nos yeux, ne sont jamais présents dans suffisamment de librairies, suffisamment longtemps. D’où, sans doute, cette expression de nous-mêmes sur les réseaux sociaux (sans compter que nous sommes devenus nos propres attaché.es de presse). Pourtant, il vaut toujours mieux publier que de garder son texte dans son ordinateur. Avec le temps, je vois bien qu’au moment même où je me sens le plus isolée, quelqu’un est en train de lire un de mes livres. Simplement, il est important de le savoir ! Quant à l’archivage : depuis peu, la sauvegarde de ce que je fais est automatique, dans un cloud que je partage. Je n’ai donc pas à m’en occuper. Par ailleurs, je crois avoir, chez moi, le manuscrit imprimé de chacun de mes livres (en plus des livres eux-mêmes). En réalité, je suis une grande accumulatrice de livres, de carnets, de cahiers. Il me faut énormément de « matériau » pour le moindre de mes textes. Je vis donc entourée de papiers, même en passant mes journées devant un écran. Quant à la difficulté d’accès à mes textes, bien sûr, ça me désole. Mais qu’est-ce que je peux y faire ? Je préfère espérer que quelqu’un se chargera de les faire connaître, tandis que j’écris les suivants.