Il est légitime d’ouvrir ce rassemblement de nos rencontres romaines sur « l’écrivain et la machine » par un propos sur François Bon, précurseur des activités littéraires sur Internet et qui en demeure l’infatigable militant.
Inutile de présenter l’écrivain, bien connu depuis son premier roman, Sortie d’usine, paru en 1982. C’est plutôt son activité numérique qui nous intéresse ici. François Bon fonde en 1997 un premier site internet, puis crée le site remue.net, qui fut d’abord un site personnel avant de devenir une revue collective1. Il s’en retire en 2005 et ouvre le site tierslivre.net, demeuré depuis son site personnel, espace d’une richesse extrêmement foisonnante, qui s’accroît chaque jour2.
Avec tierslivre.net, l’enjeu littéraire se modifie : « [I]l ne s’agit plus seulement d’une méditation du livre via le réseau, mais d’une présence tierce du livre, un livre à côté des livres », écrit-il en rémunérant par cette allusion à une « présence tierce » la formule rabelaisienne retenue pour intituler ce site. Quatre ans plus tard, en 2009, l’écrivain déclare son « impression pour la première fois d’avoir définitivement basculé dans une écriture qui ne pourrait pas être accueillie par le livre » (2009). Il crée alors la coopérative éditoriale publie.net et commence à y publier ses propres ouvrages3.
En 2011, convaincu que « le contemporain s’écrit numérique », François Bon publie Après le livre (2011), ouvrage dont la dernière phrase semble sonner la fin du codex imprimé tel que nous le connaissons : « Nous sommes déjà après le livre », écrit-il. Mais l’écrivain ne cesse cependant pas de publier des ouvrages papier, tissant entre les deux univers des liens de plus en plus complexes. On peut mentionner notamment :
Autobiographie des objets, Paris, Seuil, 2012 ;
Proust est une fiction, Paris, Seuil, 2013 ;
Fragments du dedans, Paris, Grasset, 2014 ;
Fictions du corps, Strasbourg, L’Atelier contemporain, 2016 ;
Où finit la ville, Nantes, Joca Seria, 2020.
C’est à ces articulations entre livre-papier et livre numérique, à ces combinatoires si l’on veut, aux possibilités qu’elles offrent et aux problèmes qu’elles posent, que je voudrais m’intéresser. Celles-ci sont extrêmement nombreuses et variées. Je propose de concentrer mon propos sur deux livres-expériences numériques : Tumulte et Autobiographie des objets. Le premier de ces deux ouvrages, Tumulte, est une expérience d’écriture web, mené comme écriture quotidienne de mai 2005 à mai 2006 sur un site créé ad hoc : tumulte.net. Il s’agit d’une « écriture sans préméditation et immédiatement disponible sur internet » (2006), dit François Bon. Les textes sont de nature variable : bribes de fiction, d’autobiographie, d’observation du réel, passages oniriques, commentaires sur le monde comme il va. La forme « livre » de cet ensemble paraît en 2006 chez Fayard. Le second, Autobiographie des objets également issu d’une écriture directe sur Internet, est publié en 2012 aux éditions du Seuil, dans la collection « Fiction & Cie ». Il réunit 64 textes consacrés à des objets remémorés, à partir de chacun desquels l’écrivain revient sur ses jeunes années et sur l’univers qui l’entourait alors.
Tumulte
La contrainte constituée par l’exigence d’écriture quotidienne postulée par Tumulte n’est pas propre à l’univers numérique : la même contrainte peut se développer sur le papier. Toutefois François Bon s’imposait d’écrire directement chaque jour sur le site. « Tumulte n’a pas d’autre existence que la base de données de mon hébergeur, écrit directement sur mon navigateur Internet », explique-t-il ; « Je n’en ai pas de copie sur ma machine ni de pages imprimées. Une dérive, juste une dérive : laisser faire, et voir devant quoi cela met face » (2006, 47). Le dispositif ainsi créé court-circuite la réflexion, interdit la correction et la reprise. La 4e de couverture du livre publié expose le projet en ces termes :
Le 1er mai 2005, venu de nuit à ma table de travail pour cause d’insomnie, j’imagine une sorte de livre fait tout entier d’histoires inventées et de souvenirs mêlés, ces instants de bascule dans l’expérience du jour et des villes, écriture sans préméditation et immédiatement disponible sur Internet. Même, je le voulais anonyme.
Je découvrais progressivement qu’il s’agissait pour moi d’une étape importante, d’un renouvellement. Finaliser chaque jour un texte oblige à ce que les censures qu’on ouvre, les pays fantastiques qu’on entrevoit, on les laisse aussitôt derrière soi. Alors naissait un livre fait de ces chemins accumulés, un défrichement imprévu, soumis à la friction du monde et des jours. Est-ce que ce n’est pas aussi tout cela, le roman ?
De cette exigence, proche de l’expérience de la parole libre sur le divan de l’analyste, l’écriture garde la trace. Le texte s’y fait révélateur de pensées immédiates, de rêveries impromptues. Le net aura ici reçu la fonction d’actualiser, en la contraignant, cette immédiateté de la parole : « [C]hambre d’enregistrement non pas d’un texte isolé » (2011, 251), écrit l’auteur, mais du combat qui s’y livre, qui y devient livre. On sait que cette spontanéité constitue l’une des caractéristiques actuelles des réseaux sociaux où l’on peut twitter spontanément une réflexion, une remarque, sans y réfléchir plus avant. Au risque parfois de la regretter à peine propulsée sur le Web.
Mais l’expérience nous intéresse surtout pour ce qui en demeure aujourd’hui : les deux réalités « déposées », qui en témoignent : soit, d’une part le livre, d’autre part l’espace numérique, transféré sur le site tierslivre.net, sous le titre global « La plongée Tumulte ». Force est de constater que si les textes y sont, peu ou prou, les mêmes, les deux univers et la lecture que l’on peut en faire diffèrent considérablement.
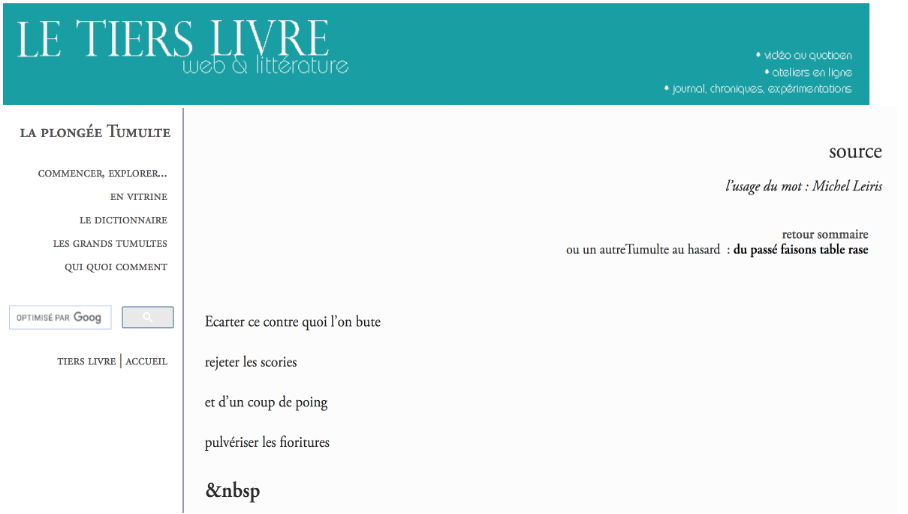
Soit d’abord le livre, qui est, je le rappelle, non l’objet premier, mais l’émanation concrète de l’expérience d’écriture : 227 textes de longueur différente, chacun d’une demi-page à sept maximum, livrés dans l’ordre de l’écriture, de « Rien n’avait changé » jusqu’à « Ce dont on se souviendra », sous-titré « non pas fin, mais ». L’ensemble est complété d’une annexe « liste des articles à écrire » (des notes qui n’ont pas donné lieu à développement), de plusieurs index : index des thèmes, des écrivains cités, des peintres, acteurs, musiciens et autres noms propres, des villes et d’une page de remerciements, puis d’une table des entrées. Ces index fonctionnent comme une invitation à deux lectures possibles : linéaire ou buissonnière, selon que l’on cherchera les textes correspondant à tel thème, tel écrivain, telle ville.
À noter, mais cela n’apparaît pas dans la table des matières, que chaque chapitre ou article porte, outre son intitulé propre, un sous-titre catégoriel, certains récurrents : « De l’écriture », « Vie des gens », « De la boutique obscure », « Suite autobiographique », d’autres n’apparaissant qu’une fois. C’est sur ces catégories qu’est fondée l’apparence du livre sur le net. A l’onglet « Tumulte », qui invite à « commencer l’exploration, s’y perdre », un clic propulse le lecteur connecté sur la page « commencer, explorer », qui recense ces rubriques récurrentes. Se proposent ainsi, sous forme de lecture interactive, différentes circulations possibles dans le livre par le jeu des sous-titres des fragments.

Cliquer sur l’une fait apparaître la liste des textes qui la constituent avec une photo en épingle. Il suffit de cliquer une nouvelle fois sur le titre ou sur la photo pour que le texte concerné s’ouvre, précédé de la photographie agrandie.
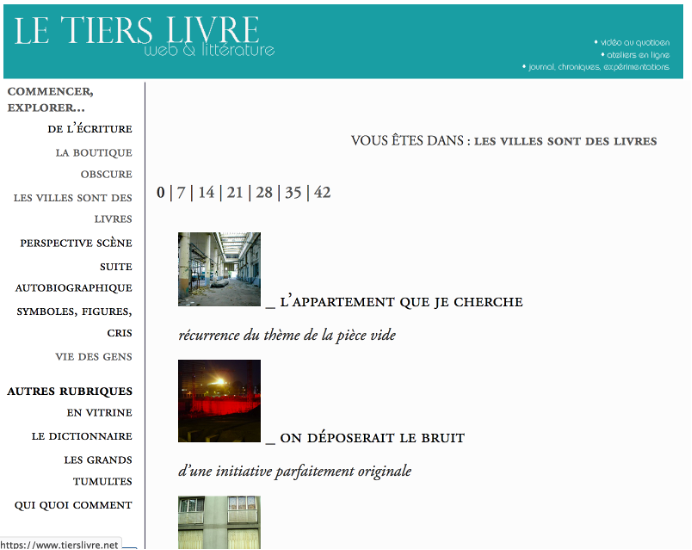

Au fer à droite sont ensuite offertes deux possibilités, une fois la lecture accomplie (ou non), celle de revenir au sommaire (liste des catégories), soit de poursuivre la lecture « au hasard » produisant ainsi une lecture aléatoire (un hasard qui n’en est d’ailleurs pas tout à fait un puisque, d’une fois sur l’autre, chaque texte vous envoie au même suivant).
La version numérique multiplie donc, et diffracte, les possibilités de lecture. Plus encore : elle empêche même la lecture linéaire du livre, puisqu’on ne peut retrouver, sous forme numérique ordonnée, la version publiée dans l’ordre où elle l’est.
Elle accroît aussi le livre puisqu’aux textes qu’il comprend, elle ajoute d’autres rubriques :
« En vitrine » qui produit une sélection des textes du livre ;
« Le dictionnaire » qui propose des mots, dont, lorsque vous cliquez dessus, apparaît non pas la définition, mais un emploi dans un vers, une phrase, une formule d’un écrivain ;
« Les grands tumultes » qui fonctionnent sur le même principe mais élisent des fragments de phrases plutôt que des mots pour renvoyer, eux aussi, à un bref propos d’écrivain ;
et « Qui quoi comment » qui annonce : des échos et résonances du livre lors de rencontres qu’il a pu susciter, lectures, musicales ou non, un index du dictionnaire, la définition du mot « Tumulte » dans le dictionnaire Littré et un retour sur la présentation du projet.
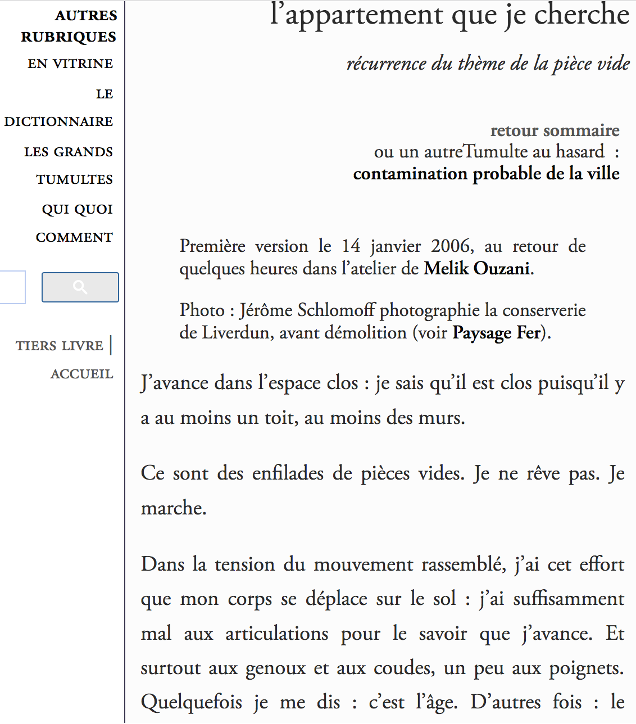
Cette version numérique comprend encore, je l’ai dit, des photos qui ouvrent chaque texte. Elle ajoute également des lectures-performances orales solitaires de l’écrivain (voix et électronique) ou accompagnées au violon électrique par Dominique Pifarély.
Que penser de l’ensemble ainsi présenté ?
Ce dispositif n’est possible que pour un livre fait de fragments ou de texte brefs, indépendants les uns des autres, dont la succession est sans importance. Le livre numérique met à mal la linéarité générale de la narration ou du discours ; il empêche toute progression suivie et favorise au contraire la lecture erratique. Le livre n’est plus un vecteur, c’est un espace à plusieurs dimensions au sein duquel le lecteur est invité à se promener.
François Bon souhaite échapper ainsi à « la structure reliée, numérotée du livre, induisant généralement un processus de lecture linéaire » (Saemmer 2010, 250). « Je programme pour que l’affichage d’un texte provoque aussitôt changement de son environnement, sa proximité, ses marges, qui elles sont actives », explique-t-il. « Le contexte se déplace à mesure de la navigation, et la consultation est donc une réorganisation permanente du chemin de lecture » (2006, 47). Le livre numérique sera forcément un livre rompu, fait de morceaux autonomes entre lesquels le lecteur pourra circuler à sa guise. Aux 227 entrées de Tumulte répondent ainsi les 64 micro-textes d’Autobiographie des objets. L’œuvre de François Bon, depuis Limite, son deuxième roman, portait l’écrivain vers cette forme brisée, qui se prolonge récemment avec l’abécédaire de Fragments du dedans (2014), mais il s’agissait d’un choix esthétique, or la structuration hypermédiale de la circulation dans le livre en impose désormais la nécessité.
Cette lecture dispersée induit pour le lecteur une perte de conscience du volume de l’ouvrage. Contrairement à celui que l’on tient en main, le volume du livre numérique échappe : le lecteur ne peut plus avoir la claire conscience de ses limites. Non seulement à cause du démembrement du codex qu’impose sa fragmentation, mais parce qu’il assiste, ainsi, à la prolifération d’un livre sans bords, dont l’extension est elle-même potentiellement infinie. La structuration impalpable du livre sur le net en modifie considérablement la lecture. Elle produit un effet d’égarement. Le site web est un espace variable, mouvant, toujours en mouvement, dont il convient sans cesse de reconfigurer l’arborescence. « Il ne se donne jamais en entier n’ayant pas d’épaisseur. Il n’est lisible et il n’est forme qu’en tant que mouvement, circulation, navigation » (2011, 265), reconnaît François Bon.
Dès lors la lecture n’est plus progression mais circulation. Dans Fragments du dedans, François Bon revendique ce « défi d’interdire la continuité de lecture » vers lequel il tend. Le livre désormais, dit-il, est « aperçu de loin, avec ses galeries, ses rampes, ses escaliers, passerelles, balustrades » (2014, 16). Perdant son volume et sa linéarité, le livre perd aussi sa complétude. La recherche ordinateur par mot-clé permet, depuis une « position extérieure au livre [de] pouvoir rejoindre immédiatement le fragment précis qui correspond à l’intuition. […] Quelque chose avait commencé, que vous venez de rejoindre. Quelque chose continuera, après que vous l’ayez laissé » (2014, 16). Autrefois le lecteur se trouvait « absorbé dans sa lecture » ; le voici désormais absorbé par l’espace du livre numérique dans lequel il se déplace sans jamais avoir la perception claire de ses limites.
L’illimitation du livre numérique procède aussi des ajouts que permet le site Web. Non seulement la version en ligne d’Autobiographie des objets se distribue, comme celle de Tumulte, dans un ordre qui n’est plus celui de l’ouvrage publié, mais elle y adjoint des « compléments ». Ceux de François Bon lui-même sont de deux ordres : d’une part des photographies d’objets retrouvés après la fin du livre et qui en illustrent les articles, d’autre part des textes évoquant d’autres objets. Ces derniers, souvent très brefs, sont à ce jour au nombre de quarante et un, soit presque autant de textes en sus que de fragments dans le livre publié. À la fin de l’un d’eux, on lit : « La série continuera discrètement, les textes accueillis ici complètent ceux du livre » (2012b). Certes, continuations et reprises ne sont pas nées avec le net : on connaît les ajouts pratiqués par Montaigne à ses Essais, dont les éditions actuelles font précéder tel ou tel passage de la lettre A, B ou C selon la version dans laquelle ce passage prend place. De même les fameuses « paperoles » de Proust ne cessaient d’accroître le manuscrit initial. Mais le site va encore plus loin. Il recueille une revue de presse : articles de journaux, de sites ou de blogs, podcasts d’émissions radio. Le livre numérique est ainsi en situation d’intégrer sa propre réception et sa postérité (figurent aussi quelques traductions d’extraits en anglais). François Bon précise : « Il n’y a donc pas – délibérément et définitivement – d’édition définitive ou référente de ce livre, recherche à jamais ouverte ». L’extension textuelle numérique ne se produit donc pas seulement dans l’espace : elle absorbe le temps.
Plus encore, la version numérique du livre fait place à des contributions de lecteurs, à égale dignité avec le travail de l’écrivain lui-même. Par exemple celle intitulée « Autobiographie des objets pour soi-même » (2012) de Jérémy Liron ; ou encore cette autre, signée Etienne Arlot, écrite sur le modèle du Je me souviens de Georges Perec (2012). L’espace numérique favorise ainsi une quintuple dissolution des limites : en amont, il permet d’en suivre la gestation ; en aval, il offre la possibilité d’en continuer le cours bien après parution ; en surplomb, il affiche les commentaires que l’écrivain produit ou reçoit de son œuvre inachevée ; en images, venues à chaque chapitre s’ajouter au contenu verbal enserré dans l’ouvrage publié ; en écho, avec d’autres, auteurs, lecteurs, qui prolongent et complètent, apportant leurs propres objets remémorés. C’est ce que François Bon appelle « grandir le livre » (2011, 200).
Un tel accroissement produit une inversion hiérarchique. Ce n’est plus le livre publié qui constitue le « centre » autour duquel graviteraient les activités, préparations et prolongations du site, mais, à l’inverse, l’œuvre-web qui est centrale et dont le livre paru en librairie n’est qu’un prolongement stabilisé, quelque chose comme une excroissance ponctuelle et provisoire, matériellement figée.
On pourrait à cet égard parler de « socialisation du livre » : l’espace internet est accueillant aux compléments, aux commentaires. « Tout y fonctionne par partage » (2011, 190), écrit Bon. Le livre devient un objet commun, dont témoignent aussi les « fan-fictions » où les lecteurs s’emparent des personnages et de leur histoire pour en inventer les épisodes suivants. Il s’agit toutefois d’une socialisation paradoxale : le sujet est enclos dans le seul contact avec son écran et son clavier, quoique installé dans une communauté qui partage ses intérêts. Cet usage socialisé et partagé du livre numérique tendrait, lorsqu’il est porté à sa limite, à dissoudre la figure de l’auteur avec majuscule, seul responsable et maître d’œuvre de son ouvrage, déjà contestée par Barthes et Foucault. Mais c’est une illusion : la signature ne s’estompe pas vraiment : tierslivre est bien, et demeure, l’espace de François Bon. Son nom y figure dès l’accueil du site. Tumulte et Autobiographie des objets ont bien paru sous le seul nom de François Bon et sans aucun des prolongements permis par l’échange numérique. Du reste l’écrivain a pris toutes les précautions juridiques pour s’assurer la pleine propriété et maîtrise de son activité Internet.
Circumtextualité, hypertextualité
Dans Après le livre, François Bon souhaite « que naissent depuis l’intérieur de nos nouveaux usages de lecture, les propres formes denses que ces usages sont susceptibles d’engendrer, et qui ne se révèleront à notre imaginaire qu’à mesure que nous les expérimenterons » (2011, 15). Or, si son matériau principal est le texte, cet imaginaire n’est plus seulement textuel. Étudiant la « nouvelle matérialité » du livre proposée par Tumulte, qui se déplace, selon elle, du livre traditionnel à la base de données, Alexandra Saemmer montre que « les caractéristiques formelles du dispositif et de l’interface (l’hypertexte, la structure de base des données, l’image, le son et le contenu des textes) s’interpénètrent et font sens ensemble, inextricablement » (2010, 251). Si bien que l’attention se déporte. Elle est « basée moins sur la lecture approfondie d’un texte précis que sur les connexions que celui-ci entretient avec d’autres éléments d’un environnement hypertextuel ou multimédia » (2010, 255).
François Bon s’interdit toutefois pour Tumulte le recours aux liens interactifs sur lesquels il suffit de cliquer pour être envoyé sur une autre fenêtre, un autre site. Inviter le lecteur à cliquer sur un mot au beau milieu de sa lecture, c’est à la fois modifier l’accommodement de son attention et, surtout, risquer de le perdre. Se produit alors une désagrégation syntagmatique au profit de l’élément lexical surligné : « Je n’insère dans Tumulte, écrit François Bon, aucun de ces liens hypertexte qui font un trou dans le texte en indiquant que tel mot appelle une autre fenêtre : c’est aussi moche que les appels de note qui défigurent les éditions universitaires de Rabelais ou Rimbaud » (2006, 47). Le lien, dès lors qu’il est activé, institue en effet une dispersion, un effet centrifuge qui égare la lecture.
En introduction au colloque Fins de la littérature tenu à l’École normale supérieure de Lyon, j’évoquais ce risque, qui est aussi un enrichissement, puisqu’il permet de faire advenir dans le livre tout ce dont il parle qui lui est extérieur (2012). Je proposais d’appeler « devenir-opéra » la mutation induite par de tels renvois, qui augmenteraient potentiellement le texte d’images et de sons. Face à ce devenir-opéra et à la menace centrifuge qu’il produit, l’écrivain privilégie plutôt un effet-rhizome qui permet certes au lecteur de circuler mais le maintient dans le livre, par le jeu des seuls renvois internes que sa version numérique induit. Il proscrit en revanche les liens exogènes, qui enverraient ailleurs. Le « chemin de lecture » doit bien se garder de perdre le lecteur.
Disparitions
Comme le remarque François Bon, « […] Internet devient outil d’écriture, puisqu’on écrit tout de suite dans le système de boucles constamment mobiles » (2006, 47‑48). L’écrivain ouvre ainsi son atelier aux yeux du lecteur, qui voit véritablement l’œuvre s’accomplir au jour le jour. On lit comme par-dessus l’épaule de l’auteur en train d’écrire.
Cette possibilité désacralise l’acte d’écriture et ôte aux brouillons et aux états antérieurs la valeur fétichisée qui fait le bonheur des collectionneurs et le bénéfice des salles de ventes. C’est aussi une perte de revenu pour les écrivains qui avaient coutume de vendre les manuscrits de leurs œuvres à succès. On peut s’en réjouir ou s’en désoler, selon l’intérêt que l’on y porte, mais le brouillon du texte final ne conserve plus la trace physique, manuscrite, de l’écrivain, dont témoigne sa calligraphie. En se virtualisant, l’œuvre littéraire désincarne aussi le corps écrivant, qui se trouve lui-même comme virtualisé. Cette émotion que l’on peut avoir à tenir entre les mains une page calligraphiée où s’affiche quelque chose de la « présence » effective de qui l’a écrite nous est désormais ôtée.
La virtualisation engage ainsi une forme de disparition. Et ce n’est pas la seule. Une autre est liée à la caducité des matériels : à ces « composants de plastique si vite obsolètes, et l’enfermement dans les logiciels » (2011, 104) que constate François Bon dans Après le livre. Autobiographie des objets évoque ainsi « ces objets à obsolescence programmée qui ont remplacé la vieille permanence » (2012a, 7). L’écrivain confie en plusieurs occasions qu’il conserve sur ses étagères des disques durs désormais illisibles. « Nous voilà donc confrontés à l’instable » reconnaît-il au seuil de Après le livre. « Il concerne aussi bien les supports, chaque nouvel appareil condamnant le précédent, là où le livre, résultat d’une considérable histoire industrielle d’une ergonomie complexe tolérait que chaque strate acceptât les anciennes » (2011, 10).
Or cette caducité n’est pas seulement liée aux appareils et aux logiciels utilisés, elle est produite par la technique elle-même. Nous savons bien, utilisateurs de traitements de textes, que chaque nouvelle version écrase les précédentes, sauf à multiplier les enregistrements ponctuels. Plus encore : chaque nouveau texte déposé sur le blog d’un écrivain relègue un peu plus les anciens dans les fonds obscurs de l’hébergeur. C’est ce que, en empruntant ce terme à l’archéologie, François Bon appelle « la fosse à bitume » (2017). Lorsque ces sites cessent d’être actifs, les textes demeurent mais ne sont plus accessibles, sauf à être archivés par quelque institution ou bibliothèque. Il y a là une déperdition considérable de contributions diverses, les unes sans doute sans grande pertinence mémorielle, mais d’autres qui seraient précieuses, non seulement pour établir une histoire des pratiques numériques, mais pour leur contenu propre.
Caractéristique de cette déperdition, la perte d’un élément important de Tumulte. Sa version numérique comportait autrefois deux espaces disjoints, une « face blanche », qui accueillait les textes toujours disponibles aujourd’hui sur le site, et une « face noire » (Saemmer 2010, 254) réservée à des notes plus marginales, esquisses, humeurs, commentaires, désormais inaccessible. On y trouvait un ensemble de « registres des activités », « registre des lectures », « registre des écoutes », « registre des notes sur écrire », « registre de la vie numérique » et « registre des improvisations ». Ainsi que les « haines, dédains, colères », les « rêves, étrangetés », les « guerres, louanges, deuils », […] parfois inavouables de l’écrivain. Cet « espace suffisamment fluide pour accueillir l’imprévu de la forme » (2011, 252), selon François Bon, est certes un espace privé, mais qui fut, durant toute une période, accessible à qui s’y intéressait. Cela aussi a disparu, signe supplémentaire de l’impermanence du net.
« Nous avançons désormais sans traces » (2011, 101), reconnaît l’écrivain. On peut associer ce phénomène à l’historicité de notre époque diagnostiquée par l’historien François Hartog sous le nom de « présentisme » (2003). La bibliothèque en effet porte témoignage des temps passés par l’accumulation d’ouvrages qui la constitue. On peut s’y référer. Sur le net, le temps risque de s’effacer ou de se perdre. Nous sommes toujours plus ou moins « au jour le jour ». À la notion d’accroissement de la « vitesse », par laquelle Paul Virilio (1977) (1995) caractérisait, pour s’en désoler, l’affolement de notre temps, il convient ainsi d’ajouter le souci d’une immédiateté toujours réactualisée, au mépris d’une conscience historique qui s’estompe peu à peu. Comme l’a bien montré Bruno Latour, la machinerie numérique constitue un objet-actant, qui modifie nos usages, nos comportements, notre rapport au monde et au savoir ; elle introduit une césure dans l’Histoire humaine, au risque de la perte et de l’oubli (2012).
Mélancolie
Une telle problématique pose la question de la mémoire et de la nostalgie. C’est le paradoxe de François Bon. Car si l’écrivain, militant du net et de ses possibilités toujours accrues, passe allègrement d’un matériel à un autre, plus performant, s’il se porte volontiers sur de nouvelles méthodes de programmation, ses livres ne cessent de témoigner du passé. Auteur d’ouvrages consacrés à la fin de l’ère industrielle et à la disparition des savoir-faire ouvriers, comme Temps machine qui en appelle à « inscrire pour mémoire » la fabrication des alternateurs et ce « monde emporté vivant dans l’abîme » (1993, 74 et 93), il amplifie cette anamnèse d’un temps disparu dans ses livres travaillés sur le Web : Tumulte comme Autobiographie des objets en reviennent tous deux aux premières années, à la période d’avant Internet. Ouvrage militant s’il en est, Après le livre s’ouvre sur le souci, si étonnant de sa part, de savoir ce qu’il est possible de « sauver » : « À quoi alors s’accrocher, sur quoi se fonder pour s’ouvrir, et sauver si on peut, sauver quoi, le sauver comment ? » (2011, 7). On croirait lire la page finale des Années, où Annie Ernaux énumère des images et des moments qu’elle aussi aimerait « sauver » (2008).
De François Bon, on s’attendrait plutôt à une projection enthousiaste dans la ferveur de l’innovation et des possibles qu’elle offre. Or l’écrivain se montre très attaché aux objets qui l’ont entouré : il évoque souvent son premier ordinateur, un Atari 1040 (2011, 53), conserve de vieux matériels, rappelle avec émotion sa découverte du Mac Classic ou du PowerBook 145. Plus encore, comme son titre l’indique, Autobiographie des objets témoigne non seulement d’un attachement au passé, mais à la concrétude de ces choses, que l’écrivain oppose au monde virtuel dans lequel il s’est installé. Il les évoque, dit-il, « selon la curiosité que j’ai de les tenir, quand nous sommes tant requis par l’ordre immatériel » (2012a, 23, je souligne). Il insiste, en exergue du livre, sur « ce que la mémoire des objets vous livre d’un moi-même perdu » (exergue de Autobiographie des objets sur le site). Le paradoxe est donc redoublé, qui oppose non seulement le passé à la frénésie technologique, à laquelle on consent pourtant sans réserve aucune, mais aussi la matérialité du monde à sa virtualisation sur le Web.
Plus encore, d’entre tous ces objets qui requièrent la mémoire de l’écrivain, deux dominent largement : les machines et instruments technologiques d’abord, du pied à coulisse du lycée, règle à calcul, transistor, Atari 1040 (2012a, 44), Ordinateur (2012a, 82)… et, étrangement, les livres, dont la présence prégnante, surgit presque à chaque texte. L’ouverture du livre, du reste, le signale : « [A]u bout, tout au bout, on le sait, rien que les livres. Parce que cela aussi serait en danger, où on a tant appris ? » (2012a, 8). Dès son milieu, le livre oriente son avancée : « Je venais chercher l’armoire aux livres, dont je sais depuis longtemps qu’elle sera l’aboutissement de ce texte. » (2012a, 167).
Il ne cesse d’y revenir, de manière obsessionnelle jusqu’au pénultième chapitre, intitulé « Du premier livre » (2012a, 237), puis à cette fameuse « armoire aux livres » (2012a, 241). Et parmi les textes ajoutés sur le site à Autobiographie des objets après publication, l’un s’intitule à nouveau « L’armoire aux livres ». Accompagné cette fois de 7 photos, il commence par cette phrase : « La fin de cette Autobiographie des objets est un lent chemin vers l’armoire aux livres du grand-père maternel » (2013a).

L’extension et l’ouverture que cet espace sans bornes du site numérique propose semblent ainsi faites pour reconduire au livre. « On n’a pas de nostalgie », précise pourtant François Bon dès les premières pages, « l’idée d’une mélancolie est plus riche, plus subversive même, à la fois quant au présent et au passé » (2012a, 8). Or la mélancolie, en psychanalyse, est une relation à l’objet qui ne s’origine que de la perte. On connaît la formule de Lacan : « L’objet est de sa nature un objet retrouvé. Qu’il ait été perdu, en est la conséquence – mais après coup. Et donc, il est retrouvé sans que nous sachions autrement que de ces retrouvailles qu’il a été perdu » (1986, 143).
« J’appartiens à un monde disparu, écrit François Bon, et je vis et me construis au-delà de cette appartenance » (2012a, 38) : telle est donc la relation de François Bon au livre : un effort pour le retrouver en tant qu’il est perdu, en tant que le monde numérique le lui a fait perdre.
Conclusion
À l’issue d’un chapitre particulièrement tonique contre les « écrivains imperturbables » qui continuent d’œuvrer hors du net, sinon pour la promotion de leurs publications, François Bon conclut : « [C]’est le mot même d’écrivain qui ne nous sert plus tellement, pas plus d’ailleurs que le mot livre » (2011, 222). Est-il écrivain, en effet, celui qui n’écrirait que sur le net ? Est-ce le livre, la matérialité du livre, qui fait l’écrivain ? Est-ce le texte ou le codex ? L’avenir peut-être tranchera, ou peut-être les autres interventions du présent ouvrage. En attendant, non seulement François Bon continue de publier des livres, mais il en commente, il en lit dans des vidéos de plus en plus longues, il les exhibe devant sa caméra, y compris parfois en plusieurs versions (par exemple une vidéo sur Traces de Marc Bloch). À cet égard, il demeure un lecteur et, incontestablement, un écrivain.
Bibliographie
Notamment à la faveur de la vente aux enchères de l’appartement d’André Breton. Voir (Bon 2011, 63)↩︎
François Bon a ouvert un certain nombre d’autres sites (krnk.net ; ouvertlanuit.net ; oeilnoir.net ; habakuk.fr), sur lesquels il produit des essais de fiction, réunit des images, mais qu’il abandonne par la suite. Il possède aussi d’autres noms de domaines qui demeurent inusités. « J’aurai certainement, à moi seul, peuplé le Web de beaucoup d’inutilité – il est si grand qu’elle y reste invisible. » (2011, 66)↩︎
Il s’en retire en 2016 pour fonder Tiers Livre Editeur, qui accueille désormais tous les textes dont il a repris ou gardé les droits. La coopérative publie.net fonctionnera jusqu’en 2021, date de sa mise en liquidation.↩︎
