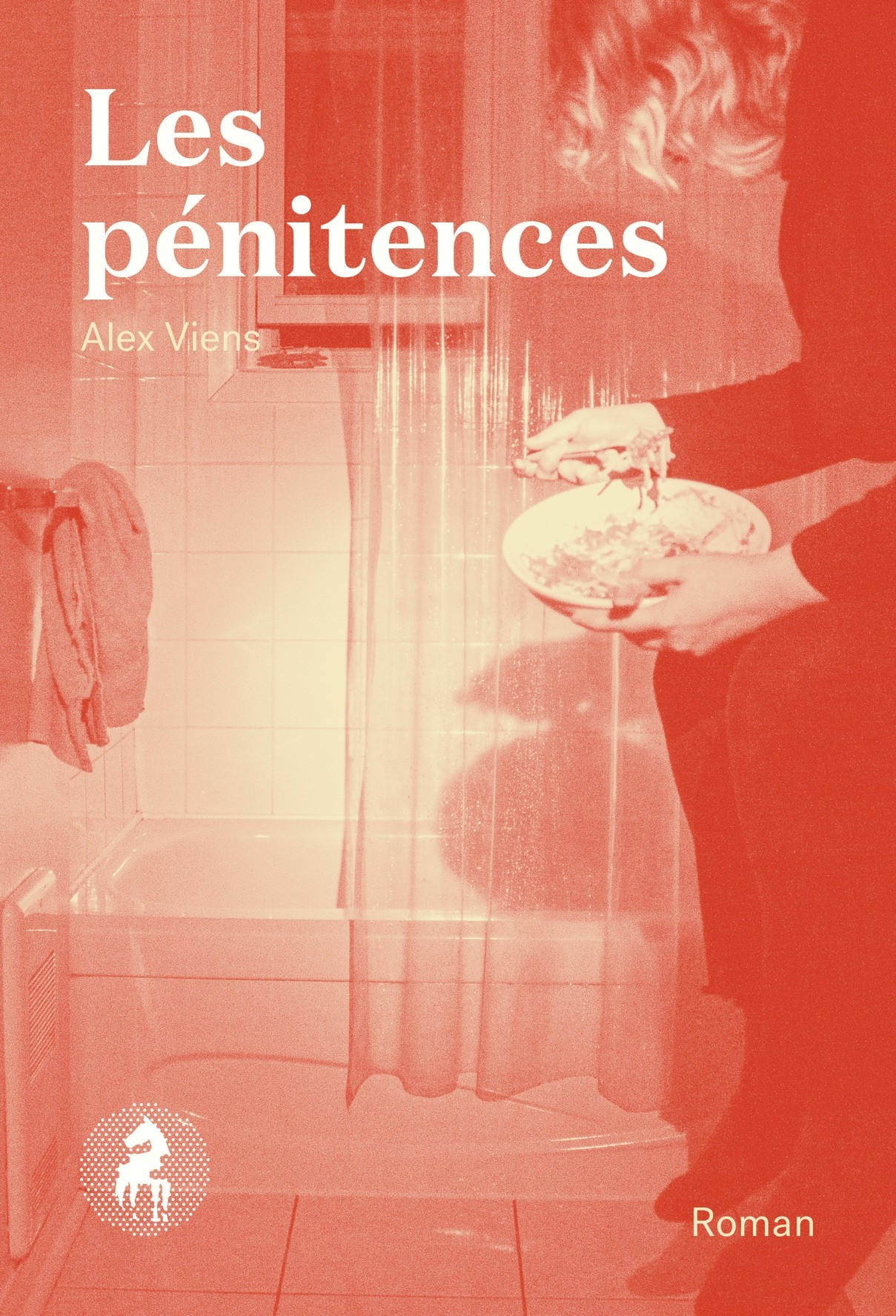
Kiev Renaud : Nous sommes en mai 2022 et cela fait maintenant un an que ton roman Les Pénitences est paru, chèr·e Alex. Nous avons fait notre connaissance autour de ton manuscrit, et notre relation s’est développée dans ce dialogue en marge du document Word. Cela m’impressionne à quel point la confiance s’est rapidement installée entre nous deux.
C’était ma première expérience de direction littéraire « solo » et, avec du recul, je réalise à quel point j’ai eu de la chance de travailler avec toi. Même si ton texte est dur, inspiré en grande partie de ta propre expérience, tu as tout de suite accepté qu’on le travaille comme un objet littéraire à parfaire. Mes commentaires étaient pointus, parfois assez directs, mais j’étais certaine qu’ils ne te blesseraient pas. C’est énorme. Le temps que nous sauverions si nous pouvions compter sur une telle assurance dans nos liens sociaux ! À quoi ce passe-droit était dû ? À ta maturité et au grand amour que j’avais pour ton texte, et que tu sentais ?
Nous avions un but commun : faire des Pénitences le roman le plus percutant possible, faire ressentir aux lecteur·ices l’enfermement de Jules, leur transmettre son angoisse grâce à la tension du thriller psychologique. Pour cela, n’importe quel passage pouvait être sacrifié s’il n’était pas parfaitement efficace. Nous étions d’accord là-dessus et, en suggérant des coupes, je n’avais pas l’impression d’entailler ta prise de parole. Dans la première version que je t’ai renvoyée, il y avait tellement de commentaires et de suggestions que Word avait du mal à fonctionner, et cela ne t’a jamais fait peur. Trois semaines après, tu me renvoyais le document en ayant pris le temps de réfléchir à tout ce que je t’avais dit. Notre dialogue se poursuivait.
Malgré toute la douleur et la sincérité que tu as mise dans ce texte, ou peut-être grâce à elle, tu réussissais à le voir comme quelque chose de détaché de toi. Cela ne me semble pas donné à tout le monde ; on voit bien dans les ateliers de création à quel point il s’agit d’un apprentissage de bien accueillir les commentaires des autres sur nos textes. Plusieurs étudiant·es trouvent ça difficile ; je dirais même la plupart. C’est au cours de leur formation qu’elles et ils apprennent à considérer les textes soumis comme des documents de travail. Car, même si on écrit « bien », un premier jet n’est jamais parfait. La beauté de la langue littéraire, c’est qu’elle nous résiste, alors que la langue courante se laisse plus facilement maîtriser. En cela, dans mon travail sur Les Pénitences, la plus grande qualité de mon regard était d’être extérieur.
Dans mes ateliers de création, je reçois fréquemment des récits d’agression sexuelle. Mon pari a toujours été de traiter les récits d’expérience traumatique « comme les autres », de les considérer comme des textes et non des témoignages. Je crains cependant de paraître insensible en signalant par exemple que, même si la scène est bouleversante, la syntaxe gagnerait à être variée pour que toutes les phrases ne débutent pas par « je ». Il y a bien sûr une façon de dire les choses, je suis une adepte de la succulente « méthode du sandwich » : « Ouf, quel passage percutant. Cela dit, ce verbe transitif s’emploie avec un complément ». Selon toi, ces textes doivent-ils être traités différemment ? Il me semble qu’il faut adresser le problème si un texte ne fonctionne pas ; que c’est peut-être pire de ne pas le dire, de réserver à ces textes sensibles un traitement différent. Qu’en penses-tu ?
***
Alex Viens : Depuis sa sortie, Les Pénitences m’a donné une nouvelle vie ; ma trajectoire s’en est trouvée complètement bouleversée et les possibles, qui me semblaient autrefois gardés dans une boîte de verre, me sont soudain si accessibles et nombreux. Écrire ce texte avait quelque chose d’une mission personnelle : celle de mettre mon écriture à l’épreuve – apparemment de la manière la plus brutale possible. C’était aussi une manière pour moi de me réapproprier mon vécu. Outre le fait de me replonger dans mes traumas, l’écriture du manuscrit a été violente parce qu’elle m’a confronté·e aux limites de mon talent, de mon vocabulaire, de mon imagination. J’ignorais si ce que j’avais réussi à écrire avait une valeur littéraire ; j’ai voulu amener le texte le plus loin possible par moi-même, mais j’avais hâte que ce travail solitaire devienne une collaboration avec des gens plus lettrés et expérimentés que moi. Puis mon texte s’est ramassé entre tes mains and the rest is history.
Dès notre première rencontre, j’ai senti que tu avais compris mon texte et tout ce que j’avais essayé d’évoquer. Tu voyais non seulement du bon dans la matière première, mais tu voyais aussi son potentiel et j’ai su tout de suite que tu serais dans mon corner jusqu’à la publication de cet objet suffocant. Tu me proposais déjà tellement de solutions brillantes pour pallier les manques dans le texte, en parfaire la langue et le rythme. C’était un gros soulagement de savoir que je n’avais plus à porter ce texte seul·e, que je pourrais me reposer sur toi quand ça deviendrait difficile. À partir de ce moment-là, tu avais déjà toute ma confiance.
C’était peut-être lors de cette première rencontre, ou dans une discussion subséquente, mais tu m’as vite fait comprendre que c’était à toi que revenait la responsabilité de faire ressortir mon style. Ça m’a ouvert les yeux sur la véritable nature du travail d’une directrice littéraire – ou du moins de ta propre philosophie en la matière ; reconnaître ce que le texte a de plus unique et amplifier ce qui est déjà là, tailler la pierre pour révéler la voix de l’auteur·e. C’était un gros morceau pour une personne autodidacte comme moi, parce que ce dont j’avais le plus peur, c’était probablement de me planter en publiant un roman qu’on dirait mal écrit. Tes conseils m’étaient précieux parce qu’ils représentaient un gage de qualité. La plupart de tes commentaires martelaient aussi le fait que je n’avais pas à en faire autant pour que mon écriture soit belle ou qu’on la prenne au sérieux. On pouvait défricher, rendre plus simple et clair, je n’avais pas à show off. On pense souvent qu’en écrivant plus, on écrit mieux. Erreur de néophyte. Heureusement, je n’avais plus à faire mes preuves avec toi.
J’aimerais ajouter aussi qu’il y avait une grosse partie de cette confiance qui reposait sur un taste level réciproque. Il me semble que c’est un élément important de la réécriture d’un texte, de le faire avec goût, surtout pour un texte comme Les Pénitences qui réclamaient une équipe capable de comprendre que l’humour était indispensable à cette histoire, que ça faisait partie de la couleur des personnages et de leur culture. Je t’ai toujours trouvée tellement confiante en tes goûts, même s’il s’agissait de ta première direction littéraire. Tu savais précisément comment naviguer sur cette fine ligne du comique/trash/touchant. Comment trouves-tu la ligne du bon goût pour les textes que tu diriges ?
Avant de travailler avec toi, j’avais peur qu’on n’ose jamais me dire que le texte était mauvais parce qu’il était justement très personnel. J’en aurais été tellement embarrassé·e. C’est une chose à laquelle j’ai beaucoup réfléchi, en tentant de déterminer si l’histoire des Pénitences valait la peine d’être écrite. Y a-t-il une valeur littéraire au-delà de la violence que je veux dépeindre ?
On parle beaucoup de cette fameuse écriture du trauma que certains – des hommes, surtout – catégorisent comme une banale écriture de journal intime. On sait bien sûr que c’est de la misogynie déguisée, et c’est précisément à ça que je m’attaque en revendiquant le travail de révision que nous avons fait. Je l’aurais mal pris que tu n’oses pas toucher à mon texte parce qu’il s’agissait d’un récit personnel. Je voulais sentir que ce que j’avais à dire était important, oui, mais que l’écriture valait le détour aussi. La partie thérapie du texte, je l’avais fait de mon côté avec ma psy. Je voulais être sûr·e qu’on lirait mon livre pour autre chose que de la curiosité malsaine. Et pour que mon texte ait de la valeur au-delà de la confession initiale, on se devait de le parfaire et de n’épargner aucun détail.
Le processus de réécriture demande beaucoup d’humilité. Peut-être y est-on mal préparé·es à l’école ou dans les ateliers de création. Il faut être prêt·e à laisser d’autres personnes entrer dans le texte, il faut être prêt·e à faire confiance. Tout le monde n’en est pas là, je crois, y compris des auteur·es publié·es. J’ai reconnu la valeur de notre travail d’édition impitoyable en lisant des livres dans lesquels je reconnaissais tout de suite la résistance de l’auteur·e ; des passages inutiles, des personnages mal développés, un rythme mal peaufiné. Je me demande comment une équipe éditoriale vit avec un texte qui a résisté à ses améliorations ? Est-ce qu’on reste avec l’impression que le livre est inachevé, imparfait ? Ou alors t’arrive-t-il de trouver que les auteur·es ont eu raison de te résister ?
L’une des plus grandes leçons que j’ai apprises, c’est à quel point ton travail impliquait une écriture active et généreuse : tu arrangeais des phrases complètes pour moi, tu me suggérais trois mots pour en remplacer un, tu trouvais des solutions narratives aux murs qu’on rencontrait. Si la réécriture était une période intense et difficile, je n’ai jamais senti que ce serait impossible. Tu m’accompagnais à chaque étape, tu me prêtais main-forte dans l’épuisement. Mon livre porte tellement de tes contributions créatives, et c’est pourtant moi qui reçois les fleurs, qui bénéficie de ton génie discret. Est-ce difficile de donner autant de soi-même, de ses idées, de son talent d’écriture aux projets des autres ? Comment traces-tu la limite entre ce que tu donnes et ce que tu dois garder pour toi ?
***
Kiev Renaud : Tu dis que tu avais achevé la partie thérapeutique du processus de création avant de soumettre ton manuscrit à une maison d’édition, et que tu voulais alors qu’il soit considéré comme un objet purement littéraire. C’est très touchant parce qu’il me semble que tu mets le doigt exactement sur le mandat que je m’étais donné, et que tu devais m’avoir accordé tacitement pour que je me l’approprie si facilement. Je voulais que le texte soit inattaquable. Je me suis fait un devoir d’être impitoyable, avec bienveillance, pour qu’ensuite, un regard qui ne le serait pas ne trouve aucune prise : pas de passage trop appuyé, pas de facilité de style. Pas de longueurs ni de répétitions inutiles. Ce mandat était d’autant plus important étant donné le sujet traité et ta prise de risque pour ce projet, ton premier roman qui plus est. Même si tu es caché·e derrière ton personnage Jules, tout le monde t’a quand même reconnu·e. Il y avait une mise en danger. Mon devoir, c’est que quiconque ouvrirait le livre pour une curiosité malsaine serait plutôt impressionné·e par la force de tes images, la qualité de tes dialogues, le rythme angoissant de la structure narrative – bref, se laisserait embarquer.
De cette façon, lors de nos rencontres, je t’ai très peu demandé de me parler de ton expérience réelle. C’est un des apprentissages que les étudiant·es en création doivent faire : ce n’est pas parce que ça s’est « réellement passé comme ça » que c’est crédible, ou même qu’il s’agit de la manière la plus efficace de faire comprendre l’intensité de l’expérience. Ce n’est souvent pas la « vérité » (de toute façon complètement subjective) qui sonne le plus « vrai » ; il faut la traficoter pour qu’elle se révèle.
Transformer le texte en objet littéraire, c’était pour moi m’assurer que ton texte ait la force nécessaire pour faire comprendre la violence dont il témoigne. C’était aussi, à ma façon, protéger ce témoignage.
Ton texte m’est arrivé complet, déjà un peu détaché de toi et prêt à être transformé en livre. Ce n’est pas le cas dans les ateliers de création, où les étudiant·es terminent l’écriture bien souvent la veille ou le jour même de la remise ; c’est leur cœur, ensuite, qu’on dissèque sur la table, si tant est que le sujet dont elles et ils ont choisi de traiter soit un peu sensible. Dans le processus de création, je pense que le temps est notre plus grand allié. Les différentes étapes du retravail éditorial prennent souvent plus d’un an et permettent de se libérer de plusieurs couches d’affectivité, d’atteindre une certaine distance, de manière à ce que le livre qui paraisse ne soit plus aussi brûlant que lors de l’écriture. C’est une des richesses de la littérature, je trouve, cette temporalité toujours un peu décalée, dans notre monde instantané, pris dans une spirale d’actualité – ces projets sont longuement décantés, réfléchis, ce qui leur permet aussi de durer plus longtemps, de continuer de circuler dans les mains et l’imaginaire des lecteur·ices.
Pour répondre à ta question, je ne suis pas du tout offusquée quand un·e auteur·e résiste ou rejette mes propositions. Les commentaires que je fais visent à ouvrir le dialogue autour des points de résistance ou de passages flous, de nœuds syntaxiques à défaire. Si toutes mes propositions étaient retenues telles quelles, je trouverais ça risqué que les solutions ne soient pas « mises à la main » de l’écrivain·e, ne s’intègrent pas bien dans son écriture. Il faut respecter l’énergie du texte. On sent parfois qu’on a porté le texte le plus loin possible ; qu’il n’est pas parfait, mais que poursuivre serait un acharnement, car il y a derrière tout ce processus aussi – et surtout – une relation humaine, et un certain rapport d’autorité qu’il ne faut jamais oublier. C’est nous qui pouvons dire que le texte est prêt à passer aux prochaines étapes et, si la lenteur du processus éditorial est bénéfique dans la décantation qu’il permet, garder trop longtemps un texte dans les limbes peut engendrer de la souffrance.
Je vais dire quelque chose d’un peu gros et l’expliquer par la suite : tous les textes n’ont pas besoin d’être aussi parfaits que le tien. Je veux dire par là que, pour faire ressentir l’asphyxie de la violence psychologique, il ne pouvait y avoir aucun temps mort dans Les Pénitences.
Il y a aussi des textes rugueux, imparfaits, et c’est ce qui fait aussi leur charme ; on sent que des passages nous résistent. Il y a d’autres textes trop léchés, trop parfaits, si « bien écrits » qu’ils ne sont presque plus « vivants ». C’est vraiment une question d’équilibre et, surtout, cela dépend du projet ; il n’y a pas une « recette » à suivre pour la direction littéraire (à part peut-être de régler les questions de fond avant de s’attaquer à la langue), chaque manuscrit invitant à son propre protocole. Le défi me semble être de ne pas projeter sur le projet le texte qu’on aimerait lire, ou encore pire : qu’on aurait voulu écrire. Quand il y avait une phrase à reformuler, je tâchais de te faire des propositions déjà latentes dans le texte, et non pas de l’écrire « comme je l’aurais écrit ». Mon cauchemar serait d’insuffler mes propres tics de langage à un texte que j’édite. Je suis heureuse et soulagée de lire que tu as eu l’impression que je « dégageais » ton style, que tout était déjà là, mais je cherchais simplement comment le mettre en valeur.
C’est un tel investissement, l’édition, que je ne crois pas que je pourrais éditer des textes que je n’aime pas passionnément. Pour préserver mon écriture, j’ai aussi besoin de ne travailler dans les projets des autres qu’à petites doses ; si c’était mon travail à temps plein, je finirais par me sentir « contaminée ». Cela dit, c’est aussi une expérience extrêmement formatrice. J’ai l’impression que chaque accompagnement est une leçon d’écriture, l’occasion d’une réflexion inédite sur la création, la structure narrative, la langue elle-même ; je suis aux premières loges de ce laboratoire de création où tout est possible, où on peut retourner un texte comme un sablier, déplacer la fin au début, faire apparaître de nouveaux personnages, changer la voix. C’est de la création pure. Et l’occasion d’échanges riches, comme j’en ai rarement eu dans ma vie. Pas de small talk, pas de médisance ; pouvons-nous parler de création plus souvent, s’il vous plaît ?!
***
Alex Viens : La relation éditoriale en est une tellement privilégiée et ce que tu dis sur cet espace d’échanges riches résonne beaucoup pour moi. L’écriture est une démarche très solitaire par moments, et ce repli est bien sûr nécessaire à l’écriture, mais le partage l’est tout autant. C’est ce dialogue exclusivement créatif qui a donné tout son sens à ton accompagnement éditorial. Nos conversations me permettaient non seulement de mettre à l’épreuve mes intentions d’écriture, de verbaliser mes préférences, mon fil de pensée, mais elles prenaient aussi la forme d’un workshop dans lequel j’apprenais concrètement à mieux écrire. Grâce à ton accompagnement, ma prise de parole n’était pas une dénonciation ; avec toi, elle devenait une démarche.
En parallèle du sérieux de ces échanges, je dois dire que ce qui m’a le plus surpris c’est à quel point le travail éditorial était capable de dédramatiser l’écriture. Nos rencontres se passaient dans la bonne humeur, les maladresses ou les images clichées dans le texte étaient corrigées avec humour, et j’ai rapidement senti que je n’avais pas à craindre d’être à la hauteur de l’aide que je recevais. Parler de création n’a pas à être englué de lourdeur ; c’est un dialogue si rare et intime, parce qu’il parle de la manière dont on s’approprie la langue, de tout notre historique avec elle, et pourtant j’ai trouvé que rien n’était plus facile. Ce sont des choses qui en disent long sur notre manière de percevoir le monde à travers le langage et qu’on connaît finalement par cœur, instinctivement.
Tu as raison que le temps est un allié précieux dans ce processus. J’ai écrit des choses incendiaires qui me semblaient autrefois nécessaires au message du livre, et qui ont finalement été tassées par la maturité de notre révision ensemble. C’est à travers les longs mois de l’écriture du roman, et particulièrement grâce à la distance permise par le travail d’édition, que j’ai su qu’il existait une distinction entre les choses qu’on a besoin d’écrire, mais pas nécessairement de publier.
Il y a aussi des moments où le texte pose des questions auxquelles on n’a pas les réponses. Je me rappelle notamment cet échange sur la mère, qui n’avait jusque là presque aucune incidence sur l’histoire, comme un moment marquant de notre travail ensemble. Ce nœud particulièrement tenace a été important pour moi aussi, parce qu’il traduisait mes propres limites par rapport au texte. J’ai eu besoin de ton regard extérieur pour surmonter ce blocage et trouver des solutions narratives concrètes à des moments où mes propres sentiments interféraient avec la logique de l’histoire.
Pour les besoins de la fiction, nous avons répondu à des questions toujours irrésolues pour moi, mais c’était intéressant aussi de laisser planer quelque chose, de ne pas y répondre entièrement. La violence et la négligence sont rarement logiques. C’est ce nœud qui a inspiré l’ultime question dans le texte, qui synthétisait pour moi toute cette logique inaccessible de la violence et des doutes qui persistent quand l’enfant demande à sa mère :
« Est-ce qu’on a fait tout ce qu’on pouvait pour empêcher que ça finisse de même ? »
Toute la force de ton accompagnement s’est déployée dans ce moment. Ta capacité à poser les bonnes questions, à chercher des solutions créatives, mais à accepter aussi que certaines failles doivent rester ouvertes pour que le texte respire et qu’il ne perde pas sa capacité d’évoquer. T’entendre parler du travail éditorial et de la délicatesse qu’il requiert, tant dans le texte que dans les relations humaines, évoque pour moi la démarche sensible de la restauration d’une peinture. Par touches, les coups de pinceau harmonisent l’œuvre, redonnent un sens à l’image et permettent d’en apprécier l’ensemble sans que l’œil ne s’accroche à une fissure. C’est un exercice d’équilibriste périlleux que d’inférer dans le texte sans le dénaturer.
L’édition d’un livre est une entreprise singulière et puissante qui embrasse les imperfections d’emblée, puisque la réécriture est une étape nécessaire à tous les manuscrits. Quand on est chanceux ou chanceuse, on peut s’appuyer sur la présence solide d’une directrice littéraire comme Kiev Renaud, qui a coupé ses propres délais de livraison pour me donner plus de temps avec le texte. Cette même Kiev Renaud qui parsème ses 3 000 commentaires éditoriaux de blagues, de bravos et de bonhommes sourire à côté d’un sacre bien placé dans une phrase. Et c’est peut-être ça, la plus grosse leçon. Quand on passe sa vie à se convaincre que demander de l’aide est un signe de faiblesse, le travail du texte nous apprend qu’il est non seulement souhaitable, mais préférable de se laisser aider. De repousser les frontières de sa seule imagination en y ajoutant celles qui nous sont généreusement prêtées.

