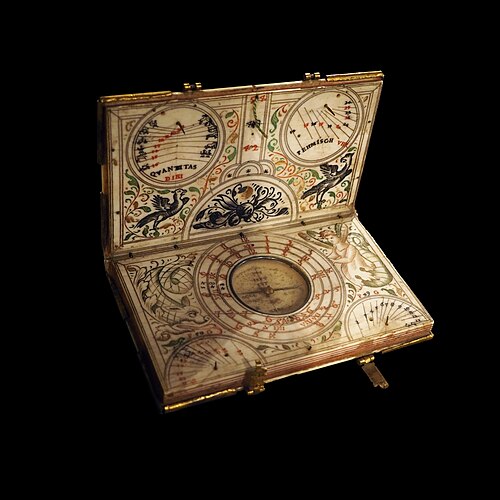La littérature propose-t-elle des formes d’accompagnement, lesquelles, et interroge-t-elle les façons d’accompagner ? Longtemps, les grands textes servirent surtout à diriger les humains, en les encadrant, au profit de valeurs transcendantes, ou de collectifs pour lesquels il s’agissait de s’oublier. Les Lumières et le libéralisme, en tant qu’expression d’une liberté de penser individuelle, ont fait avancer de manière décisive un programme lancé à la Renaissance : certaines œuvres semblent alors accompagner les lecteurs, de façon plus horizontale, avec moins d’aliénation par quelque autorité. Le sujet individuel, mis en crise en plusieurs moments du XXe siècle, revient depuis quelques décennies sur la scène livresque, en quête d’accompagnements pour se situer dans des collectifs toujours plus vastes : décolonisation et critiques des visions du monde occidental se trouvent complétées, à l’heure de l’anthropocène, par la nécessité de prendre soin des autres qu’humains. Le panorama historique qui suit propose un découpage un peu nuancé en interrogeant ce qu’accompagner signifie et implique.
Des lecteurs accompagnés par des autorités du sacré ou de la Cité
Ancien et Nouveau Testaments content des histoires et proposent des énoncés spirituels visant à « réparer le monde » (tikkoun olam juif), dont l’unité a été brisée, et à suivre des préceptes pour s’assurer le salut. Repères, les grands textes sacrés accompagnent aussi au sens où ils dictent des comportements, jusque par des systèmes législatifs, ceci étant particulièrement vrai du Coran. Guides spirituels et censeurs en cette vie, les grands textes religieux, par le biais d’institutions variées, ont pourvu les croyants en saints et en directeurs de conscience, eux-mêmes au fondement de textes hagiographiques (ainsi de la Légende dorée de Jacques de Voragine), de littératures exemplaires et autres exercices spirituels (parmi les plus célèbres, ceux d’Ignace de Loyola) : un ordre catholique comme celui des Jésuites a ainsi fondé de remarquables écoles. La littérature d’inspiration spirituelle (comme les Contes de sagesse de Rabbi Nahman de Braslav (2014)…), des formes de poésie amoureuse (L’Interprète des désirs d’Arabi (2012)…) et autres vers, prières, sermons ont pour fonction principale de soutenir les mortels dans leur cheminement mondain, en les guidant. D’autres religions polythéistes ont bien sûr fait de même, ainsi que de nombreuses sectes, productrices d’institutions, de cultes et de représentants comme de textes de témoignage et de codes. Saint Augustin inaugure le genre autobiographique au IVe siècle, mais son histoire invite surtout le lecteur à, comme lui, se détourner d’une vie illusoire au profit de Dieu. Bergson (1932) a vanté le charisme des saints, qu’il met en parallèle avec les génies susceptibles de soulever des foules et d’orienter des sociétés entières. Le théâtre est issu des mystères qui enseignent à aimer le Christ, en même temps qu’il réunit des fidèles heureux de se retrouver en communauté, et le spectacle divertit toujours plus. L’Antiquité grecque et latine accompagne-t-elle hommes et femmes au moyen de littératures analogues ? Si Foucault (1984) a vu en elle la naissance du souci de soi (dans son Histoire de la Sexualité), Pierre Hadot (2012) précise que le « plaisir mis en soi-même », la construction de soi par la méditation ou une technique comme celle des hypomnèmata (recueils de pensées d’autrui susceptibles de servir à la transformation du lecteur) visent surtout une façon de se transcender et de s’oublier comme individu dans l’universel – ce qui diminue la crainte des dieux et de la mort. Littérature encore spirituelle, donc, mais orientant également les lecteurs vers la Cité. Ce qui n’est pas toujours le cas des philosophies antiques, comme l’épicurisme, qui met en garde contre les habitudes laxistes communes, ni du stoïcisme, qui invite à se méfier de ce qui ne dépend pas de soi, quitte à se retrancher dans une citadelle imaginaire (l’image, si l’on ose un grand écart, fait songer au « château intérieur » de la mystique Thérèse d’Avila). Les Écrits pour lui-même de Marc-Aurèle (1998), hérités d’Épictète, révèlent cependant un souci authentique de responsabilité par rapport à autrui. Les Anciens ont-ils préféré accompagner les lecteurs d’autorités politiques et d’une certaine façon, de valeurs transcendantes moins « verticales », au profit de collectifs ? Socrate est parfois cité comme celui qui envisage l’individu singulier : même l’esclave peut apprendre qu’il ne sait rien mais que, bien questionné, il sait retrouver des vérités admirables (Ménon). Il s’agit toutefois d’Idées et c’est Apollon qui est censé avoir envoyé l’homme de la maïeutique aux Athéniens pour punir leurs excès…
Théologies et philosophies, pendant des siècles ont cependant servi à faire communauté, ce qui constitue un « accompagnement » propre à la culture humaine, quel que soit l’intérêt des puissants allant avec ces pratiques. C’est encore la pensée qui aide très concrètement Boèce, vers 524, à supporter la torture (« Pouvais-je t’abandonner, répondit [la Philosophie], toi, mon élève, et ne pas réclamer ma part du rude fardeau sous lequel on t’accable, en haine de mon nom ? Quelle honte si la Philosophie désertait la cause d’un innocent ! Quoi ! je craindrais la calomnie ! Est-ce un malheur si nouveau que j’en doive frissonner de peur ? Crois-tu donc qu’avant toi la sagesse n’ait jamais été persécutée par le vice ? » dans Consolation de philosophie), et bien des prisonniers après lui se sont rappelés des mots et des vers pour mieux endurer leurs tourments, y compris dans les camps de la mort. Confidents et conseillers des Princes, jusqu’à la Renaissance et à aujourd’hui, rédigent des textes pour guider les guides, si l’on peut dire. Moins élitiste, et moins suspect de servir des intérêts privés, Castiglione (1991), dans le Livre du courtisan, établit des règles du vivre ensemble ; que celles-ci ne s’appliquent pas encore à tout un chacun n’ôte pas à l’ouvrage sa qualité d’accompagnement de ceux et celles qui veulent pouvoir se fréquenter sans agressivité. Rappelons que la cour du Grand Turc y est citée parfois à titre d’exemple à suivre (en II), et que, toujours selon Castiglione, « les mêmes règles données pour le Courtisan peuvent encore s’appliquer à la Dame » (II). La préciosité fera un style de cette idée de respect codifié de l’autre.
Il faudrait d’ailleurs distinguer entre types d’accompagnements « verticaux » : entre aliénation programmée auprès d’un pôle transcendant sévère et référence à des valeurs qui valent pour d’autres que pour soi, s’étend une gamme variée. L’exemplarité n’intime pas nécessairement l’obéissance aveugle, d’une part, et les réceptions de ces littératures plus ou moins prédictives, au nom de formes de soin, varient selon les personnes et les cultures, d’autre part. Ainsi, nul besoin d’être stoïcien ni d’interroger les intérêts de Sénèque auprès de l’Empereur pour être aujourd’hui encore ému à la lecture de ses conseils pour se remettre d’un deuil (par exemple dans sa Consolation à Marcia, au Ier siècle). L’écriture de l’histoire des événements, des hommes et des femmes, magistra vitæ, ne ressortit pas qu’à des stratégies de manipulation. Anagnorisis et catharsis tragiques, dans les tragédies grecques étudiées par Aristote dans sa Poétique, et lues par Vernant et Vidal-Naquet (1972), servent-elles à faire éprouver au public combien celui qui se croit supérieur aux autres citoyens est en fait le plus indigne – sur un mode très conservateur – et qu’il fait bien de se crever les yeux et de devenir mendiant ? Le chœur chante peut-être cela, mais Freud a reconnu dans Œdipe-Roi ce qu’il observait chez ses patients en souffrance et en a déduit des théories plus libératrices.
Accompagnements horizontaux des sujets lecteurs
Les accompagnements littéraires que l’on dira moraux, dans un sens large, ont ainsi progressivement cédé davantage de place à l’individu et à la réalisation de son bien-être sur terre. Cette histoire se développe à la Renaissance, avec quelques grands noms européens comme ceux de Montaigne, de Copernic, ou de Galilée. Le schisme protestant, au sein de l’Église chrétienne, en a été l’adjuvant, avec de grands humanistes, courant qui pourrait se caractériser par son souci de l’humain compris comme construction à toujours soutenir, entretenir et raffermir (« l’homme ne naît pas homme, il le devient », écrit Érasme dans De pueris instituendis, en 1519). La figure du penseur-précepteur s’établit d’une certaine manière avec Rousseau qui, en préromantique, écrit ses propres Confessions, sur un autre mode que celui d’Augustin et qui veut penser le commun dans le siècle, même de façon très personnelle. Diderot, plus optimiste quant aux vertus transmises par la fiction, félicite l’auteur de Pamela de savoir rendre ses lecteurs moraux par son maniement des émotions, et ceci bien mieux que s’il recourait à des maximes philosophiques. Ce penseur des Lumières procède même à une défense en règle de la fiction romanesque dans son Éloge à Richardson (« Tout ce que Montaigne, Charron, La Rochefoucauld et Nicole ont mis en maximes, [il] l’a mis en action. Mais un homme d’esprit qui lit avec réflexion les ouvrages de Richardson refait la plupart des sentences des moralistes et, avec toutes ces sentences, il ne referait pas une page de Richardson. [En lisant ses romans], j’étais devenu spectateur d’une multitude d’incidents, je sentais que j’avais acquis de l’expérience », 1762). Selon Ian Watt (1957), le libéralisme naissant promouvait ainsi le réalisme dans la littérature, gagnée par le genre romanesque : mettant en scène des individus pris dans le quotidien social et contemporain, le grand roman tendait un miroir aux lecteurs et lectrices, toujours plus nombreux et nombreuses à chercher auprès des héros, chanceux ou pas, susceptibles de vivre des « initiations » (genre du Bildungsroman), des exemples « exemplifiants » et non plus « exemplaires ». Rousseau demeure méfiant, après La Fontaine, quant aux pouvoirs des fables (« Le monde est vieux, dit-on ; je le crois, cependant / Il le faut amuser encore comme un enfant », 1678) : un mauvais esprit saura toujours tourner une histoire dans un mauvais sens et l’émotion morale ne dure parfois que le temps de la lecture ou de la représentation qui auront éveillé son empathie (Lettre à D’Alembert, 1758). Accompagnement vain, voire manipulation, donc ? Une lecture critique faite au moins à deux pourrait arranger la chose : c’est ce qu’il fait dire au tuteur de Julie dans La Nouvelle Héloïse (« peu lire, et beaucoup méditer nos lectures, ou, ce qui est la même chose, en discuter bcp entre nous, est le moyen de les bien digérer », 1761). C’est là rejouer le topos de la scène de lecture entre Abélard et Héloïse, ou entre Paolo et Francesca, rejouant eux-mêmes ce qui arrive à Lancelot et Guenièvre, que commente en ces termes Brian Stock (2005) : « Lire, en particulier dans le dolce stil nuovo, donne aux amants une meilleure conscience d’eux-mêmes. ». L’historien américain des perceptions du monde antique et de la Renaissance fait en outre « du dilemme antique de la force des représentations émouvantes dans un contexte spirituel le dilemme du lecteur dans toute la civilisation occidentale ». La littérature – discours, conte, théâtre, roman – émeut et, en cela, convainc, informe, oriente et peut donc soigner, voire libérer, c’est-à-dire accompagner de façon très active : cela n’est plus condamnable, sauf selon Rousseau. Après Diderot, Simone de Beauvoir a dit la capacité de la littérature à faire entrer les lecteurs dans un autre univers, sans qu’ils cessent pour autant d’être eux-mêmes (« Que peut la littérature ?»), Iris Murdoch (2005) a vanté l’attention au monde que développe le roman, par le jeu de l’empathie, et l’aristotélicienne Martha Nussbaum (1995) a prolongé encore la chose, en voyant même dans la littérature une école du citoyen démocrate. Cependant, le storytelling, les techniques de développement personnel se souviennent parfaitement de cette puissance de l’histoire (réaliste dans leur cas) à concerner celui ou celle qui lit, dans un but pas toujours si libérateur (voir Boltanski et Schiaparello (2011) qui, militants, disent dans Le nouvel esprit du capitalisme la façon dont l’entreprise récupère une soi-disant révolte issue de mai 1968 à son profit, en promouvant l’accomplissement de soi au travail). Ces pratiques d’accompagnement visant l’épanouissement, venues des États-Unis, héritent à leur manière de l’évangélisme et du perfectionnisme moral des transcendantalistes… Mais convoquer Emerson et Thoreau permet surtout une transition vers la dernière partie de ce très vaste panorama : l’intérêt de ces deux grands auteurs post-romantiques pour la nature – intérêt fondé en philosophie et en récit, sinon en fiction – coïncide en effet avec les nouveaux enjeux des accompagnements par la littérature.
Accompagner le sujet dans le monde entier et sur Gaïa
La littérature, fiction ou non-fiction, peut donc accompagner en guidant ou en aliénant, de haut en bas, comme de manière transversale, des sujets lecteurs considérés ou pas comme autonomes. Après avoir été accompagné par de grands textes vers le transcendant, ou vers le mieux-être de la Cité, et, dans une dernière étape, surtout vers soi-même, le lecteur lambda, non nécessairement membre d’une élite cultivée, et mis en crise en différents moments de la littérature occidentale au XXe siècle (stream of consciousness et Nouveau Roman, entre autres), découvre toujours plus, ces dernières décennies, que d’autres individus très divers ne partagent pas sa culture : la « République des lettres » s’est mondialisée et, si des invariants demeurent, la soif de singularités et le besoin de communautarismes a également compliqué l’idée d’accompagnement du sujet par les littératures. La distinction de communautés de religions, de genres, d’origines culturelles, d’orientations sociales diverses, entraîne parfois des effets de censure (cancel culture), de protection des sensibilités (sensitivity readers) et autres prescriptions qui accompagnent de façon active, sinon contraignante, des accès aux livres et à leur interprétation. La culture étendue des langues et les travaux des différents passeurs permettent d’heureuses découvertes de l’autre et de profondes réjouissances comparatistes depuis toujours, mais jamais autant qu’à l’heure de la toile. Littératures postcoloniales et décentrement ont par exemple conduit à la réécriture du Robinson de Defoe (2018) en Foe par J. M. Coetzee (1986), roman dans lequel le héros s’avère être une femme, puis par Patrick Chamoiseau (2012), dans L’Empreinte à Crusoë, qui fait de lui un homme de couleur ancien esclave. Aujourd’hui, Coetzee pourrait sans doute être accusé d’avoir changé le genre du naufragé sans être lui-même une femme. Après les race studies, les gender studies, les disabled studies, entre autres, découpent encore et toujours plus les singularités que les livres doivent accompagner, voire servir, tantôt au nom d’individus à qui l’on refusait la parole, tantôt au nom de dogmes inquisiteurs et censeurs. Le réalisme magique et ses variantes avaient fait de croyances africaines et latino-américaines des éléments non seulement esthétiques, mais encore des ouvertures indirectes dans des anthropologies ignorées du grand public, soudain mises en circulation pour changer la perception du monde, ce que les contes ni le fantastique n’avaient réussi dans la même mesure. Disant parfois les blessures de l’histoire avant et en même temps que le postcolonial et le décolonial, récupérant l’inconscient, ce type d’imaginaire a influencé non seulement la considération de toujours plus d’humains, uniques et différents, mais encore l’attention portée aux autres qu’humains. Le sujet cartésien se trouvait non plus seulement accusé d’européocentrisme phallocrate : il menaçait aussi de perdre toute réalité, en se dédoublant, en s’incarnant en des animaux ou des végétaux, en mourant et en ressuscitant à la surface de Gaïa ! Le grand jeu de la fiction le permet, qui ne corrige pas tant « la réalité » qu’elle ne la nuance sur des modes expérimentaux qui nous font revenir sur nous-mêmes, sur les autres, et sur nos relations à eux. À l’heure de l’anthropocène, la littérature peut nous guider de manière « classique » : Rachel Carson (1962) a joué le rôle de ce qu’il convient maintenant d’appeler une lanceuse d’alerte avec Silent Spring ; d’autres auteurs s’apparentent davantage à des « influenceurs », visant plus le profit qu’un idéal. La non fiction se développe, s’entremêlant à la fiction, quand l’auteur s’interroge lui-même sur ce qu’il vit – ainsi de Nastassja Martin (2019) qui se fait arracher la mâchoire par un ours, comme ses amis gwich’in le pressentaient, et qui relate l’événement et ses suites sur le mode de l’initiation d’une occidentale dans un monde animiste plus respectueux de la nature. Joan Tronto avait défini le care comme une « activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer “notre” monde de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tous éléments que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie » (cité par Liane Mozère (2004)). Une manière de réalisme magique caractérise le roman français récent d’une admiratrice et lectrice de Nastassja Martin, également anthropologue de formation : dans Zizi Cabane, Bérengère Cournut (2022), délaissant les Autochtones d’Amérique (mis en scène dans Née contente à Oraïbi (2017)) conte la disparition d’une mère qui chante, entre deux chapitres en prose réservés à sa famille, sa métamorphose en toutes sortes d’eau (humidité dans les murs, source, rivière, pluie, mer…). La considération pour des cultures non monothéistes, où le sujet n’est pas passé par les filtres de la Renaissance et du libéralisme philosophique, à côté des interrogations anxieuses et parfois brutales sur l’identité, semble correspondre à une réinjection de transcendance dans les perceptions du monde et donc dans de nombreuses littératures. Chamoiseau cite le panthéisme de Parménide, le terme de Gaïa a été repris de la mythologie grecque par Lovelock, sur la suggestion du romancier William Goding et la vie elle-même ne se définit plus de façon évidente. Parmi les autres qu’humains, la littérature contemporaine revoit ainsi de façons multiples le personnage du fantôme : non plus utilisé comme outil d’épouvante, morale ou pas, mais comme signe du passé qui fait partie de la vie de ceux et celles qui restent. Il n’est ainsi pas surprenant que la philosophe Vinciane Despret (2021), qui étudie nos relations aux animaux, jusqu’à s’essayer à la fiction, ait également écrit Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent (2015). Les revenances, en notre période de présentisme, nous ramènent peut-être à la nécessité de nous faire accompagner par des vivants très divers, qui aident à penser autrement le rapport à des êtres invisibilisés jusqu’en nous-mêmes, à éprouver un sacré non obscurantiste, et aller à la rencontre d’altérités toujours et encore à mieux considérer, ce que l’œuvre de l’autrice Catherine Mavrikakis montre aussi brillamment. La littérature peut cela – mais ne le fait pas nécessairement, ni ne se laisse toujours lire en ce sens.
Ce très vaste panorama de l’idée d’accompagnement par la littérature fonctionne évidemment par approximations – dans sa lettre à Marcia, qui a perdu son fils, Sénèque parle déjà des mœurs des étrangers et des animaux, avant l’heure d’une ouverture aux autres très étendue : mon « histoire » relève d’une chronologie bien approximative, car la littérature échappe toujours en partie au temps de sa création, et les lecteurs de siècles ultérieurs savent la goûter à leur manière, selon leurs désirs et leurs souffrances. Mais ces références qui disent quelques soucis d’écrivains, de lecteurs, de spectateurs (et j’aurais pu convoquer bien des orateurs) justifient sans prétention clinique alarmante le terme de bibliothérapie, à quoi il conviendrait d’ajouter l’efficacité de formes de spectacle comme le théâtre-forum, celle des ateliers d’écriture et, sans doute encore, celle de la recherche-création.