Local et mondial : chevauchements entre le capital économique, les institutions et le peuple
Cela commence comme un conte de Jorge Amado. Un village indigène brésilien perdu sur la côte nordestine, dont le nom signifierait le « mont aux fourmis », Mataraca, a prospéré un temps grâce aux emplois liés à l’exploitation d’un gisement de titane. La fermeture de l’usine assombrit son avenir : les emplois sont rares, l’argent ne circule plus que chez les petits trafiquants qui recrutent et s’abritent dans cette localité isolée. Pour assurer sa réélection, le maire fait publier par les journaux locaux qu’un projet portuaire pourrait relancer la commune. Cela semble curieux. L’arrière-pays est sans débouché ; Natal, Cabedelo ou Recife ne sont pas engorgés…
Mais voici qu’un an après l’élection de Lula, on signale un vaste projet d’investissement touristique, effectivement conçu autour d’un port, porté par des investisseurs chinois. Inspiré des villes artificielles récemment créées dans les Émirats d’Arabie, cette infrastructure serait conçue pour accueillir 250 000 habitants et touristes à l’horizon 2035 (2023a).
On ne comprend pas ! Sauf à construire un aéroport sur place, les aéroports internationaux sont à plus de deux heures de route, et celui de João Pessoa, le plus proche, devrait être totalement repensé. Écologiquement dévastateur, un tel projet percuterait la micro-économie de subsistance locale, même si Mamanguape, non loin de là, dispose d’une population disponible et qualifiée. Il faudrait autoriser la destruction de mangroves et de zones d’habitat indigène protégées, ou bien affecter une partie des investissements à la requalification de toute une région. Jusqu’ici, toute cette zone demeure sous la coupe des planteurs de canne à sucre qui exploitent sans vergogne un peuple misérable d’ouvriers agricoles. Mais quel élu s’opposera à un tel projet quand les habitants rêvent des futures aménités d’une microrégion oubliée du Brésil ? Son coût énergétique ? Les promoteurs en feront un argument pour développer des parcs solaires ou éoliens à proximité… Face à un mur de difficultés matérielles, cette histoire dit les attentes inassouvies de la population.
Et si cela se faisait vraiment ? Cela dirait alors la puissance internationale d’un colonialisme contemporain hors-sol, capable d’implanter ex nihilo d’immenses installations pour extraire de la valeur. C’est finalement presque pareil de forer l’océan à la recherche de pétrole1 ou de créer une zone de consommation addictive. Les forages océaniques mobilisent des armées d’ingénieurs et d’opérateurs fort bien rémunérés, le pétrole extrait fait la fortune des actionnaires et contribue au maintien de modes de vie dont on nous dit qu’ils sont indispensables au petit peuple : au Brésil comme ailleurs, les subventions aux transports sont considérables et rien ne serait pire qu’une grève des camionneurs. Sur le versant de la consommation, l’histoire qu’on nous raconte est tout autre. Elle est scénarisée par des compagnies de croisiéristes et d’aviation, des tours opérateurs, des promoteurs immobiliers, des organisateurs de spectacles, des agences de publicité et des groupes de médias. Il nous est dit que la planète est belle, qu’elle nous appartient, que nous pouvons en jouir, que nous sommes faits de nos rêves de découverte…

On murmure que la vie est courte, nous recevons quantité de messages promotionnels, des photos à la séduction stéréotypée évoquent les confins de tous les continents et nous incitent à découvrir Venise avant la montée des eaux, le Machu Picchu devenu un parc d’attractions, les fjords de Norvège et le soleil de minuit, les tramways pittoresques de San Francisco ou Lisbonne, les malls ventilés d’Abou Dhabi, le célèbre Ayers Rock d’Australie… Ces lieux ont en commun d’être comme des îles poétiques parsemant le globe et propices à l’euphémisation des difficultés planétaires. Leur marchandisation a le mérite d’effacer leur histoire séculaire quand bien même les descendants des peuples originaires vivent encore à proximité, fournissant au besoin le personnel subalterne requis par ces bases touristiques. Même au sein des capitales de la modernité – Paris, Londres ou New York – ont été créées des zones exclusives faites de galeries marchandes et de musées, des restaurants internationaux et de clubs privés. Pourquoi pas le Brésil ? Nombre de prédateurs veulent ponctionner légalement les comptes bancaires de familles riches à millions. Créés par un demi-siècle de mondialisation, des centaines de groupes industriels ou financiers, immobiliers ou agricoles, de cliniques privées ou d’informatique, dont le capital est entre les mains de quelques associés généralement familiaux, cultivent un imaginaire dynastique et sont disposés à déverser des sommes faramineuses à Dubai ou Miami, Courchevel ou Porto-Cervo, Ibiza ou Monaco. Il s’agit de se montrer et de côtoyer ses pairs internationaux. La pointe orientale de la côte brésilienne est donc une cible de choix. Visible sur toutes les photos de satellites, d’un marketing facile, située sur des routes maritimes accessibles, elle abrite des populations soumises de longue date aux élites étrangères. L’idéal.
La réalité brésilienne de 2024 est plus terre à terre. C’est celle d’une transition paisible et d’une normalisation. Les tensions apparues lors des manifestations de 2013 ont connu des soubresauts jusqu’à l’émeute du 8 janvier 2023 qui a clos ce cycle erratique2. En vieux sage de la politique, Lula mise tout sur la concorde civile, d’autant que le Parti des Travailleurs est institutionnellement minoritaire. Après son retour sur la scène internationale en 2023, l’année 2024 est une année électorale. Le gouvernement écoute les entreprises par son vice-président Alckmin, également ministre de l’industrie, et son ministre des finances Haddad. En contrepoint, Lula intronise Guilherme Boulos, venu de la gauche brésilienne, comme candidat à la mairie de São Paulo et a nommé successivement son avocat et son ministre de la justice au Tribunal fédéral suprême.

Le Brésil est redevenu un acteur mondial. Membre des BRICS, il fait le pari de l’alliance chinoise, son premier partenaire économique, contribuant avec l’Inde et la Russie à former une coalition anti-impérialiste au G20. Cette vision stratégique présente l’avantage de la clarté : on ne dira pas l’Amérique latine inféodée aux États-Unis. Mais elle a aussi ses limites. Les partenaires régionaux du Brésil ne la partagent pas nécessairement, elle rend difficile la conclusion d’un accord entre le Mercosur et l’Union européenne. Mais pour l’essentiel, après des années de divisions partisanes, les Brésiliens ont retrouvé leur fierté patriotique.
Marqué par le souvenir des plans d’ajustement du FMI de la fin du siècle dernier, le Brésil fait de la stabilité de sa monnaie et du contrôle de sa dette publique le pivot de ses échanges et des investissements internationaux — dont la montée est encourageante. Nul n’aura l’indécence de rappeler que c’était la volonté des partisans du coup d’État parlementaire de 20153. La reprise de la croissance dope les bénéfices des acteurs économiques et conforte la trajectoire budgétaire. Jamais le pays n’a exporté autant de soja, le patrimoine des régions les plus riches explose : on applaudit le pragmatisme gouvernemental.
De fait, ce sont les secteurs exportateurs qui contrôlent l’État. Ils créent les emplois, organisent les bases régionales de production, et stipendient les administrations qui dépendent totalement des taxes sur les exportations et les importations. À l’exception de l’entreprise publique Petrobras, les grandes compagnies privées des secteurs agricoles, miniers ou de travaux publics décident des investissements, commandent les subventions (au secteur automobile, au transport aérien, aux réseaux électroniques ou d’énergies vertes) et pilotent les évolutions idéologiques orchestrées par les médias.
Les lobbies agricoles et des entreprises de São Paulo (FIESP) dominent plus que jamais le pays. Sur ce plan rien de nouveau : la stabilité domine. Les détenteurs du pouvoir économique ayant massivement voté pour Bolsonaro, le gouvernement est tenu de composer avec eux. Il poursuivra ce chemin de composition tranquille avec les milieux d’affaires. Si le pouvoir de Brasília cessait de les servir, ils se tourneraient immanquablement vers les caciques de la droite ultralibérale et gagneraient les élections. Lula est donc sous surveillance dans un contexte marqué par l’émergence mal comprise d’une demande démocratique par le bas captée par les églises évangélistes. Ces dernières ont cautionné le mixte d’ultralibéralisme et de conservatisme idéologique du gouvernement Bolsonaro. Mais leur développement répond à des évolutions d’une complexité rarement étudiée. Jean-François Bayart comprend le puritanisme comme une figure de style, qui est souvent une figure de la réussite. Une figure de style que portent généralement les « classes (moyennes) bourgeoises alors économiquement ascendantes […], les couches qui sont seulement en voie d’ascension » (selon Max Weber, l’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme), et dont les groupements communautaires de croyants sont les ateliers, les laboratoires de subjectivation (Bayart 2022, 550).
Qu’est-ce qu’une révolution conservatrice ?
Sans être spécialiste du Brésil, cet auteur propose une analyse particulièrement pertinente de ce qui s’y déroule. Il est en effet un expert des révolutions conservatrices et aussi de ce qu’il nomme après Gramsci, révolutions passives. Sa thèse est double. Il constate d’une part que dans nombre des cas observables depuis deux siècles, les épisodes révolutionnaires furent orientés par le désir d’arrêter le mouvement et de restaurer des dominations connues de longue date plutôt que de s’engager à de périlleuses novations. Cette thèse recouperait le travail de François Furet sur la Révolution française, et convient exactement à la situation des indépendances latino-américaines qui ont partout renforcé le pouvoir des élites locales, et explique la transformation des esclaves brésiliens en une large population durablement discriminée. Par ailleurs et dans ce même ordre d’idées, il saisit la fréquence avec laquelle la population se soumet et accompagne toutes sortes de régressions qui lui sont objectivement défavorables, en raison de la prévalence d’imaginaires sociaux justifiant la résignation et la soumission comme des vertus morales opposables aux actes violents de minorités activistes dont la répression peut compter sur l’acquiescement des groupes sociaux dont ils se démarquent par leur opiniâtreté à troubler le jeu habituel des pouvoirs et de la domination. Si ce type d’attitude a été souvent décrite pour parler de la condition des descendants d’esclaves au Sud des États-Unis, il est peu commun d’en faire le filtre d’une analyse de la situation brésilienne. Une vulgate de gauche a même eu plutôt tendance à valoriser le caractère d’avant-garde libératrice de quelques groupes révoltés contre les pouvoirs dominants – ainsi de Zumbi de Palmares, héros du XVIIe siècle ou de Tiradentes et de ses compagnons au XVIIIe siècle – et de projeter cette vision sur les minorités actuelles au risque de pouvoir guère expliquer le conservatisme dominant de la population brésilienne en général malgré les innombrables discours l’incitant à s’affranchir des hiérarchies traditionnelles.

L’autre thèse de Jean-François Bayart est structurale. Cet exceptionnel connaisseur des mondialisations survenues à toutes les époques historiques s’efforce de montrer que la modernité associée à l’État-nation tient à la manière dont cette formulation politique a nourri un discours national qui s’est abstrait tant des visions impériales, adossées à des considérations mondiales et parfois même liées au prestige divin, que des multiples liens de proximité qui ont toujours structuré la socialisation politique, même lorsque celle-ci ne s’exprime pas dans ce vocabulaire et se réfère préférentiellement à des catégories lignagères d’appartenance à des territoires, à des ancêtres, à des symboles totémiques ou magiques. Le propre de l’État-nation serait de veiller toujours à combiner une idéologie nationale qui fait disparaître autant que possible le répertoire des petites patries d’allégeance naturelle des citoyens avec la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour fabriquer les inégalités sans lesquelles le pouvoir étatique serait incapable de s’exercer.
L’État-nation moderne est donc le propagateur et le régisseur des inégalités sociales et territoriales, auquelles ses desservants les plus zélés doivent leurs postes de pouvoir et qu’ils s’emploient à diffuser au sein de la population enfermée dans ses frontières. Cette thèse entend expliquer pourquoi les logiques de pouvoir qui se sont succédé depuis un peu plus de deux siècles se voient consolidées ou affaiblies en fonction des combinatoires des trois facteurs que sont leur rapport à la mondialisation (tendanciellement impériale), aux formes institutionnelles stratonationales (le parlementarisme est le cœur de la formation des inégalités internes à un espace national) et aux identités subjectives des citoyens et de leurs réseaux de proximité, toujours prompts à réitérer des gestes d’invention de traditions à travers lesquelles ils revendiquent des particularismes que l’État a beau jeu de réprimer tout en leur conférant de la sorte une légitimité nouvelle et dialectique. De même, et sur l’autre volet, l’État-nation tire sa force de son opposition à la dilution de l’espace national dans un sans-frontiérisme liquide qui va de pair avec les diverses formes de la mondialisation.
Au long de son travail, Bayart montre pourtant quelques-uns des liens qui indiquent comment ces trois pôles font système. Par exemple, la circulation actuelle des musiques ethniques, en grande partie réinventées et synthétiques, opère le lien entre des diffuseurs mondiaux (Apple Music, Spotify…) et des marqueurs forts d’identités électives pour les individus. D’une autre manière, les associations humanitaires s’inscrivent dans un cadre qui a la plupart du temps été déjà formé par les dominations coloniales, en sorte que leur présence s’appuie sur des formations hiérarchiques auxquelles les populations cibles ont consenti anciennement et qui sont paradoxalement remises en place par ces organisations postcoloniales. À rebours, les populations minorisées et dépendantes savent fort bien instrumentaliser les émissaires venus de la sphère stratonationale en conditionnant leur allégeance à l’opérationnalisation par ces derniers des distinctions et des hiérarchies locales : les caciques et les anciens, les meneurs et les chefs de bande obtiennent le plus souvent une complète reconnaissance de leur autorité pour permettre à l’État de passer les compromis sans lesquels il ne serait jamais reconnu. De là vient que les hiérarchies traditionnelles, fussent-elles notoirement abusives, sont le plus souvent cautionnées par l’État qui en fait cas au point d’accorder à leurs représentants toutes sortes de fonctions supplémentaires qui renforcent leur autorité d’administrateurs des inégalités au point de faire disparaître toute instance de contestation ou d’arbitrage — si ce n’est, au risque de subir la pire violence et la mort, au travers des organisations de trafiquants qui recrutent essentiellement au sein de populations déshéritées qui ignorent parfois totalement la dimension politique de leur marginalité. Ces groupes éphémères et sans cesse renouvelés sont pourtant la forme première d’une contestation politique de l’État-nation et des inégalités qu’il protège. De là, constate Bayart, que ces réseaux se greffent sur toutes sortes d’imaginaires transnationaux et accréditent autant que possible en même temps la singularité de leurs expressions culturelles. L’État-nation peut bien canaliser les émotions footballistiques et sportives en détournant les attentes politiques des supporteurs, folkloriser autant que possible et rendre artistiques les expressions corporelles ou musicales de la contestation (la capoeira par exemple et les arts martiaux en général ou le reggae et le rap) ce type de phénomène revient toujours et la culture des favelas, y compris une religiosité prophétique et mystique, réinvente sans cesse des rituels et des styles contestant aux pouvoirs d’État leur prétendue légitimité. Bayart montre ainsi que l’État, loin d’exercer, comme le veut l’adage, le monopole de la violence légitime, se nourrit sans interruption d’une violence périphérique exacerbée par ses propres agissements (Bayart 2022, 584). La répression qui s’abat invariablement sur ceux qui s’y livrent pose concomitamment la puissance des deux régimes d’autorité : l’État y trouve ce dont il a besoin pour justifier la révolution passive, la soumission des masses apeurées, et les marginalités y puisent leur vivacité et leur dynamique adaptative dans la débrouille que leur impose la misère et la relégation.

La démocratie coexiste avec la pauvreté et le néolibéralisme
L’impôt ne pèse guère sur les grandes fortunes du pays et la réforme engagée se fait à moyens constants. Cela montre bien comment l’économie relève de la constitution des pouvoirs, puisque la mondialisation permet de renforcer le pouvoir sur l’État d’élites qui seraient autrement reléguées à des vestiges passéistes. Tant la Révolution française que les indépendances nationales ou postcoloniales ont montré la capacité des groupes dominants à perpétuer leur ascendant social à travers un changement complet du modèle leur assurant jusqu’alors une supériorité incontestée.
Ainsi, au Brésil, les familles bénéficiaires de la prospérité urbaine du dernier siècle ne se mélangent guère au peuple métis. Elles cultivent leurs origines européennes, l’entre-soi ; elles se séparent du menu peuple. C’est particulièrement visible dans les métropoles que compte le pays ainsi qu’à Brasília, et cette option est confortée par l’influence des super-riches capables de déplacer leurs capitaux au gré des opportunités financières : cela préserve l’ensemble des groupes dominants de toute réforme virulente. L’immobilisme institutionnel va de soi. D’ailleurs l’opposition tient tous les pouvoirs hormis le gouvernement central et capte l’électorat des principaux États. Pour preuve, alors même que le Tribunal fédéral suprême a consacré les droits des populations indigènes sur leurs terres, le Congrès fait tout pour que cet arrêt ne se traduise pas sur le terrain. Cette situation encourage les exactions et les meurtres frappant ces communautés dispersées. Selon le modèle proposé par Bayart, le jeu des institutions permet surtout de distribuer les inégalités et de conforter les dominations.
Avec Lula, le soutien aux bourses universitaires et aux programmes sociaux a repris, le salaire de base a été augmenté. Mais les transferts entre les régions du pays sont loin de compenser le différentiel des investissements et des politiques de développement — tant en milieu urbain que rural. Le coût de la vie est prohibitif pour les plus pauvres dans les centres urbains. Pour sa part, la population rurale affronte le coût disproportionné des transports, le rationnement des prestations de santé publique, et les systèmes locaux d’éducation sont calamiteux. La paix sociale repose donc sur un consentement avéré aux inégalités, géographiques autant que sociales et ce sont bien les divisions entre populations et régions qui permettent de consolider le pouvoir d’État. En fin de compte, le consensus limité dont bénéficient les gouvernants fait le jeu des institutions. Paradoxalement, plus elles sont faibles, plus elles laissent s’exprimer les contestations. Ce qui paraît tenir de la tautologie renvoie en réalité à la complexité que permet la triangulation : le faible contrôle exercé par le gouvernement sur les orientations sociales de base se compense en partie par un appel au sentiment patriotique à chaque fois que c’est possible, et par la mention du cadre mondial pour tout le reste. L’impuissance publique est ainsi le meilleur garant de la pérennité des pouvoirs, pour peu qu’on parvienne à éviter la sécession. La vieille fable romaine des membres et de l’estomac est plus que jamais en vigueur.
À propos d’estomac, les enquêtes constatent l’aggravation croissante des écarts de revenus. Dans plusieurs États, et particulièrement dans le Nordeste, les 3/4 de la population vivent avec moins de 300 dollars par mois. Misère : des millions de Brésiliens vivent dans une absolue précarité. La majorité de la population descend des paysans métis et des esclaves présents dans le pays avant 1900 : sans la moindre marge économique, elle subsiste en ne dépensant quasiment rien. Si la conjoncture est meilleure, la consommation populaire est en berne pour longtemps. La réforme fiscale ne vise nullement à des transferts sociaux ni à une quelconque décentralisation administrative. Dès lors, la consommation populaire patine. Le célèbre réseau des Lojas Americanas est en faillite, incapable d’honorer une dette que ses actionnaires ont creusée. Des chaînes d’ameublement (Tok Stok) aux groupes de distribution de fournitures scolaires et de livres (Saraiva) ont fermé ou réduit le nombre de leurs points de vente. Le passage est ainsi direct des réseaux de proximité aux réseaux mondialisés. Amazon, Alibaba ou Mercado livre font loi. La vente et les paiements par téléphone rythment le quotidien brésilien et irriguent jusqu’aux emplois informels du commerce et des services et les emplois statutaires de la grande distribution sont fragiles.

Il nous faut donc parler d’une économie duale. Il existe un Brésil dont la propension à la dépense fait vivre les petites classes moyennes des employés en tout genre, ceux des entreprises privées de santé (on annonce la vente d’Amil par son propriétaire United Health), des concessionnaires d’automobiles, des fonctionnaires, des services juridiques, de l’immobilier et du tourisme. Après avoir démultiplié les circuits d’échanges, la mondialisation a substitué la segmentation commerciale aux classes sociales. À chaque consommateur est assigné un profil type auquel ses transactions électroniques le destinent. Cela ne laisse plus guère de place à la critique politique. Nombreux sont les jeunes à se bercer des illusions d’une mobilité ascendante, mais celle-ci exige de se conformer à des normes comportementales rigoureuses, de respecter tous les codes, de ne traverser aucun coup dur. Même en exerçant une vigilance permanente, seul un contingent réduit de la population pourra échapper, en l’absence de protections familiales, aux plafonds de verre vraiment étanches.
S’émanciper ? Cet horizon recule en permanence et dans le monde entier. Pourtant, le Brésil serait un gisement presque infini de prospérité. Ses ressources sont parmi les plus considérables de la planète, ses atouts géographiques immenses. Pourquoi n’engage-t-il pas sa mutation ? Idéalement, il faudrait renforcer le marché intérieur et rehausser les qualifications de la population. Et aussi, rééquilibrer les bases productives en privilégiant l’amélioration du bien-être là dans les grandes conurbations, et l’investissement décarboné dans les centres de moindre taille au long des côtes atlantiques. Au vu des changements climatiques prévisibles, limiter l’urbanisation des régions de l’intérieur serait bénéfique. Mais l’objection vient immédiatement. Le projet d’une politique sociale plus équitable se solderait par une levée de boucliers. Les grands médias anticiperaient une fuite des capitaux qui aurait lieu bien avant un quelconque renforcement de la consommation populaire. Ils évoqueraient l’hypothèse d’un scénario de type argentin. En résumé, on ne change rien : le boom du soja transgénique dans le Mato Grosso ou au Paraná règle d’avance la question. On ne refuse pas une croissance effrénée, le renforcement de l’agronégoce et des réseaux bancaires, et une lune de miel avec la Chine, fût-ce au prix de la déforestation du Cerrado, de l’emploi incontrôlé de pesticides et des milliers de camions nécessaires pour transporter les récoltes jusqu’aux zones portuaires4.
Dans l’autre sens, on ne discute pas non plus des prélèvements disproportionnés que représentent les frais de transport, de communication et de santé des plus pauvres. Toute prestation universelle serait tenue pour du collectivisme et la subvention des transports populaires, pour autant qu’elle puisse avoir lieu, relèverait essentiellement d’une approche clientéliste. Il n’y a donc pas de majorité de rechanges à celle qui appuie l’orthodoxie financière et le soutien aux industries exportatrices. En pratique, des millions de Brésiliens sont hors de situation d’améliorer leur sort. Sauf à démontrer une détermination farouche et tenace pour obtenir un diplôme, passer des années à consolider un commerce ou un emploi de routine, sans oublier de protéger sans cesse sa réputation face aux médisances des jaloux, de préférence en émigrant loin de son quartier de naissance, c’est peine perdue. Troisième ensemble de population des BRICS après la Chine et l’Inde, le Brésil a conforté son positionnement au prix de la pérennisation de la grande pauvreté. On pourrait voir sous cet angle la reprise par le principal groupe papetier du pays, Suzano des unités de fabrication et de distribution jusqu’ici possédées par Kimberly Clark : les marges sont réduites sur le papier-toilette, mais les volumes sont tels qu’il est avantageux de dominer son marché national. Cela renforce un groupe industriel revendiquant un savoir-faire international dans l’exploitation des eucalyptus et de ses dérivés. Sa capacité de production a pratiquement doublé depuis le rachat en 2019 de son principal concurrent brésilien, il peut fêter une histoire industrielle centenaire !
C’est là constater le chevauchement permanent du mille-feuille institutionnel national créé par les subtilités juridiques, des investissements économiques renforçant toujours plus les acteurs dominants, surtout s’ils sont en prise avec la mondialisation, et des existences individuelles ou de communautés locales, dont les pratiques culturelles et de socialisation renforcent la cohésion en même temps que les réseaux sociaux les connectent à la rumeur du monde et des événements nationaux.

À cette aune, avoir fait voter une réforme fiscale, fût-elle limitée, donne du crédit au gouvernement Lula. La relance des budgets de la santé populaire et le contrôle partiel de la déforestation ou de l’orpaillage illégal, tout comme les engagements en vue d’un verdissement progressif de la production énergétique vont dans le même sens. Reste que le contrôle sévère du déficit budgétaire interdit pratiquement toute politique d’aménagement du territoire. Les investisseurs privés décident de tout et dictent sa politique économique au gouvernement à qui incombe principalement l’accompagnement technique requis pour suivre le développement urbain et productif. Les transferts sociaux et entre régions sont insuffisants pour susciter des changements véritables.
Il n’y a d’ailleurs guère de débats à ce propos. Une planification à long terme supposerait de rapprocher les instances de décision des bénéficiaires potentiels. On pourrait certes s’appuyer sur les statististiques fiables produites par divers organismes de bonne qualité, dont l’IBGE, qui est au Brésil ce que le GIEC est au climat. On voudrait voir se renforcer les capacités des jeunes générations par l’octroi de « crédits » en matière d’éducation et de formation et de transport. Une compensation forfaitaire des frais de connexion devenus indispensables pour exister comme citoyen serait aussi appréciable, tant ces frais fixes pèsent différentiellement selon les revenus de chacun.
Mais le pays s’en remet à de simples formes traditionnelles de ruissellements. Outre les emplois informels de proximité, le tourisme adressé aux consommateurs fortunés et les investissements immobiliers sont l’exemple type d’une espèce de colonisation intérieure du Brésil par les Brésiliens eux-mêmes. Que d’opportunités recèle leur pays ! Le financement de très nombreux complexes touristiques ou résidentiels sécurisés donne certes de l’emploi à une multitude. Mais leur financement souvent opaque et très peu imposé, s’il garantit la rentabilité du secteur, ne déconcentre pas la fortune. Ainsi s’explique probablement, sur fond de rumeurs impossibles à confirmer jusqu’ici, le mirage de cet éventuel investissement chinois gigantesque pour le bourg côtier de Mataraca. Pour l’heure, si le maire du lieu a reçu une délégation de l’entreprise porteuse du projet, basée à Belo Horizonte, le consulat de Chine à Recife met en garde les autorités : il s’agit peut-être d’un miroir aux alouettes, à la suite de quoi le gouverneur de l’État n’a pas donné suite au rendez-vous prévu avec les porteurs du projet. Le seul résultat concret pour l’heure est dans les journaux : au lendemain de la réunion à la mairie, celle-ci a été cambriolée et des ordinateurs dérobés5.
Aperçus méthodologiques
Aller plus loin, c’est aborder le domaine théorique de la subjectivation politique. Inspiré de sa lecture de Mille Plateaux de Deleuze et Guattari, Jean-François Bayart rappelle que l’opposition d’une intériorité subjective et d’une réalité institutionnelle objective est parfaitement illusoire. Toute subjectivation opère dans un cadre collectif qui détermine l’essentiel de ses formes. Sans cela, comment comprendre que les réseaux sociaux et groupes WhatsApp aient servi de catalyseur aux récents mouvements d’opinion de la sphère conservatrice ? Ces services de communication personnelle sont autant de vecteurs propices à structurer d’un même mouvement des attitudes subjectives et des rapports à des incarnations tierces (leaders d’opinion, stars des médias et du sport, influenceurs, pasteurs…) capables de prescrire à tout à chacun le registre stylistique de ses modes de vie. Notre subjectivité est ainsi très largement factice — telle est la découverte centrale d’une approche qui substitue une observation factuelle aux présupposés idéologiques.
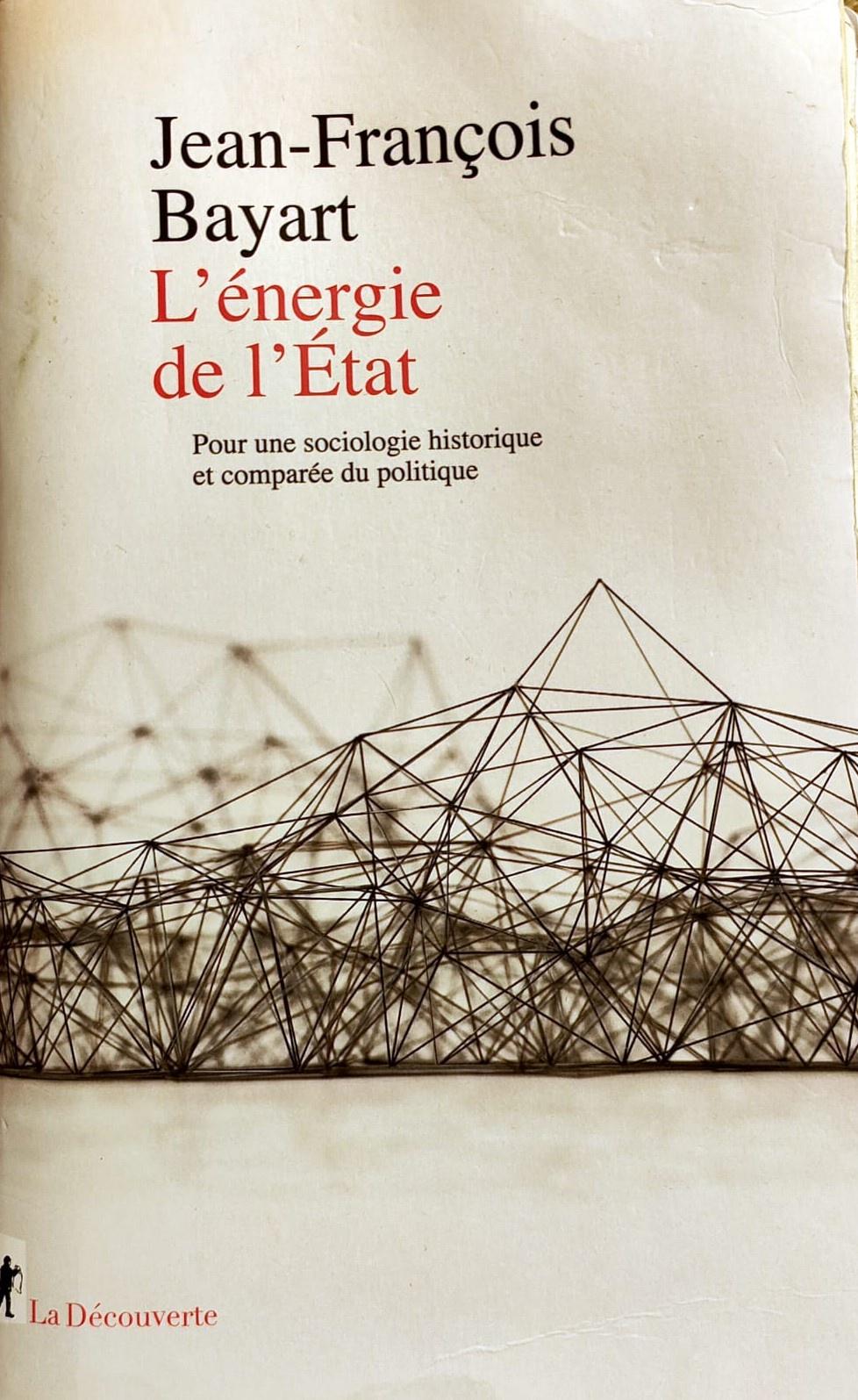
Les groupes de pairs constituent un indispensable étayage de la position personnelle de toutes sortes de « sans » (est-ce d’ailleurs si différent ailleurs ?). Les adeptes de ces églises évangélistes sont en quelque sorte des transclasses, le tiers état délaissé des démocraties libérales. Celles-ci se sont structurées en agrégeant des castes nouvelles de possédants aux anciennes élites issues d’une décolonisation faite au vingtième siècle au profit des couches dominantes, quand bien même satisfaire les besoins du peuple en matière de logement ou de santé a permis d’éviter des soulèvements perturbateurs et donné bonne conscience aux rentiers. La position ambiguë des réseaux sociaux tient donc à ce qu’il s’y joue dans le même mouvement une réassurance individuelle, la soumission à des impératifs externes de type magique et une ouverture calibrée aux représentations dominantes dont l’adoption conditionne toute ascension sociale. Dans le même mouvement par lequel les populations périphériques préfèrent avoir affaire à un tyranneau local prévisible jusque dans les discriminations et injustices qu’il pratique (mais dont on peut toujours espérer une faveur), plutôt qu’à un émissaire incontrôlable venu de loin et qui repartira vite, elles lorgnent sur toutes les pratiques valorisantes aux yeux des proches qui peuvent leur parvenir depuis un extérieur en partie imaginaire. Ici se combinent un réalisme pratique dont Pierre Bourdieu a bien décrit les ressorts, une subjectivation sociale indispensable à la constitution d’une identité personnelle, et l’adoption de styles irrationnels et magiques inséparables des espérances mystiques qui structurent les croyances et les espérances tant matérielles que spirituelles. Cette dernière ressource, pour peu qu’elle vienne à dominer les autres, peut conduire certains à des actes révolutionnaires qui les mettront parfois au ban de leur groupe d’appartenance, mais leur offriront peut-être une gloire éphémère ou l’intégration à des structures collectives plus ou moins messianiques.
Mettant en échec les éléments de validation scientifique qui montreraient l’impropriété de ces attitudes à résoudre le moindre problème collectif, cette approche que nous faisons nôtre permet de mieux saisir le paradoxe des révolutions conservatrices que la persistance du soutien aux héritiers du bolsonarisme oblige à prendre en compte. En effet, tout laisse penser que les termes selon lesquels ce phénomène collectif lui-même transclassiste a été abordé ne permettent pas d’en saisir le ressort. Par quel mystère une bourgeoisie urbaine traditionnelle a-t-elle pu passer alliance avec des milieux populaires marqués par l’évangélisme militant, avec des climatosceptiques et des apôtres de la violence sociale dans un pays traditionnellement loué pour son pacifisme (certes démenti par le taux de violence constaté à Rio et dans d’autres villes) ? Les analystes doivent choisir : s’ils supposent un sens de l’histoire, ils se doivent d’indiquer en quoi cet irrationalisme radical relève d’un avenir possible. Et si l’on doit se résoudre à isoler les facteurs du conservatisme social comme un trait pérenne de la socialisation politique brésilienne, il convient d’abandonner le messianisme historique à ceux qui le pratiquent à titre religieux. Jean-François Bayart est très clair à ce sujet.
L’orientation révolutionnaire conservatrice d’une telle religiosité peut choquer, écrit-il, d’autant plus qu’elle tend à légitimer les pouvoirs autoritaires les plus recuits. Mais elle pourvoit simultanément des conceptions neuves de la citoyenneté que les démocrates libéraux peinent à concurrencer, empêtrées dans les miasmes de l’iniquité étatique et de sa « politique du ventre ». Un paradoxe dérangeant que ne devraient pas éluder les spécialistes de l’Amérique latine, en particulier du Brésil. (Bayart 2022, 549)
Notre auteur va plus loin et insiste sur l’importance de la double conscience, de l’automystification et du mensonge constitutifs de la conscience publique. Il en conclut que la démocratie par le bas contribue à faire perdurer le pouvoir des bandes locales et des réseaux familiaux. Il ferait son miel de la démission, en février 2024, de la gouverneure de la banque centrale turque, financière certes hautement qualifiée pour servir l’intérêt national au vu de son expérience dans la finance globale ; mais elle a été rattrapée par un scandale familial : elle a outrageusement favorisé son père, exposant sans fard le secret d’un système où la famille domine les institutions. Mais il n’est pas donné à tous de bénéficier de protections suffisantes pour pratiquer ce népotisme. Vu sous cet angle, porter sur le Brésil un regard inspiré par l’étude des réseaux familiaux qui tiennent l’essentiel des leviers économiques et régionaux serait très pertinent. L’évolution du pays répond certainement au schéma de triangulation proposé par Bayart, entre le mondial, le stratonational et le local. Telle serait bien la démarche à suivre pour comprendre de quoi sera faite la succession de Lula à la tête du pays.
Bibliographie
La zone controversée entre le Guyana et le Venezuela ne devrait-elle pas devenir une zone protégée de tout forage plutôt que la source de millions de tonnes de CO2 supplémentaire pour le seul profit de compagnies pétrolières, puisque la région est à peu près inhabitée, et qu’aucun acteur local n’a les moyens par lui-même d’exploiter cette manne ?↩︎
Voir l’article Lula-le-Miracle, aussi publié en portugais.↩︎
Les tenants de la rigueur budgétaire l’ont emporté en 2015 au prix d’un retournement d’alliance au Congrès, un psychodrame si mal expliqué qu’il s’est soldé par une bien inutile radicalisation idéologique. L’actuel gouvernement fait tout pour se faire oublier cette séquence.↩︎
Voir l’article de Bruno Meyerfeld (2023) paru en septembre dernier.↩︎
Voir les articles, en portugais, « Vice-cônsul da China diz que projeto futurista em Mataraca é duvidoso: “temos motivo de acreditar que é uma fraude” » (Nunes et Cerqueira 2023) ; « João Azevêdo cancela audiência com grupo chinês que promete investimentos de R$ 9 trilhões para ‘cidade futurista’ em Mataraca » (2023b) ; « Prefeitura de Mataraca é invadida e computadores são roubados após empresários da China divulgarem investimento de R$ 9 trilhões na cidade » (2023c)↩︎
